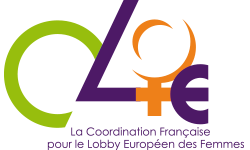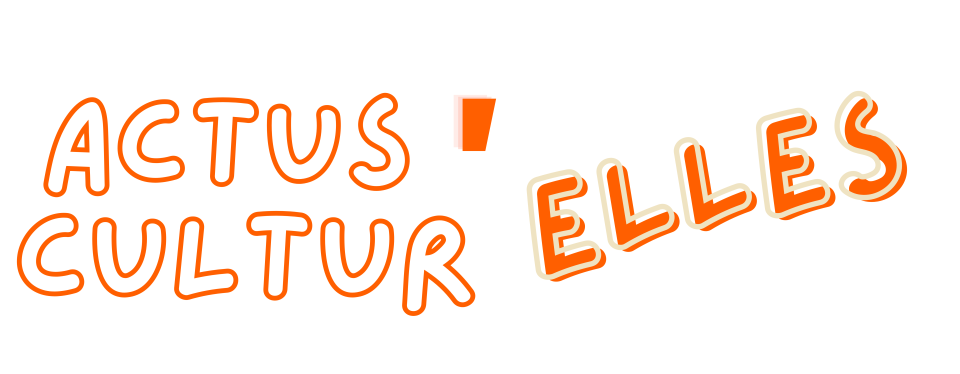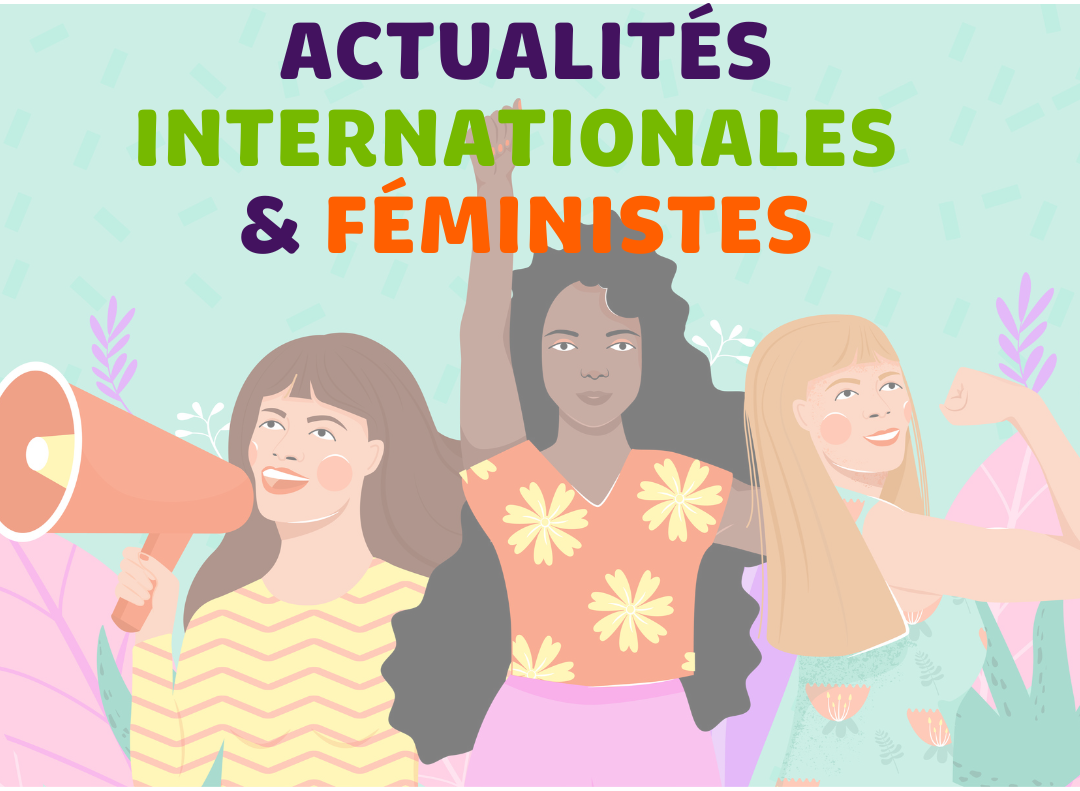
Revue de presse féministe & internationale du 24 novembre au 1er décembre
1 décembre, 2023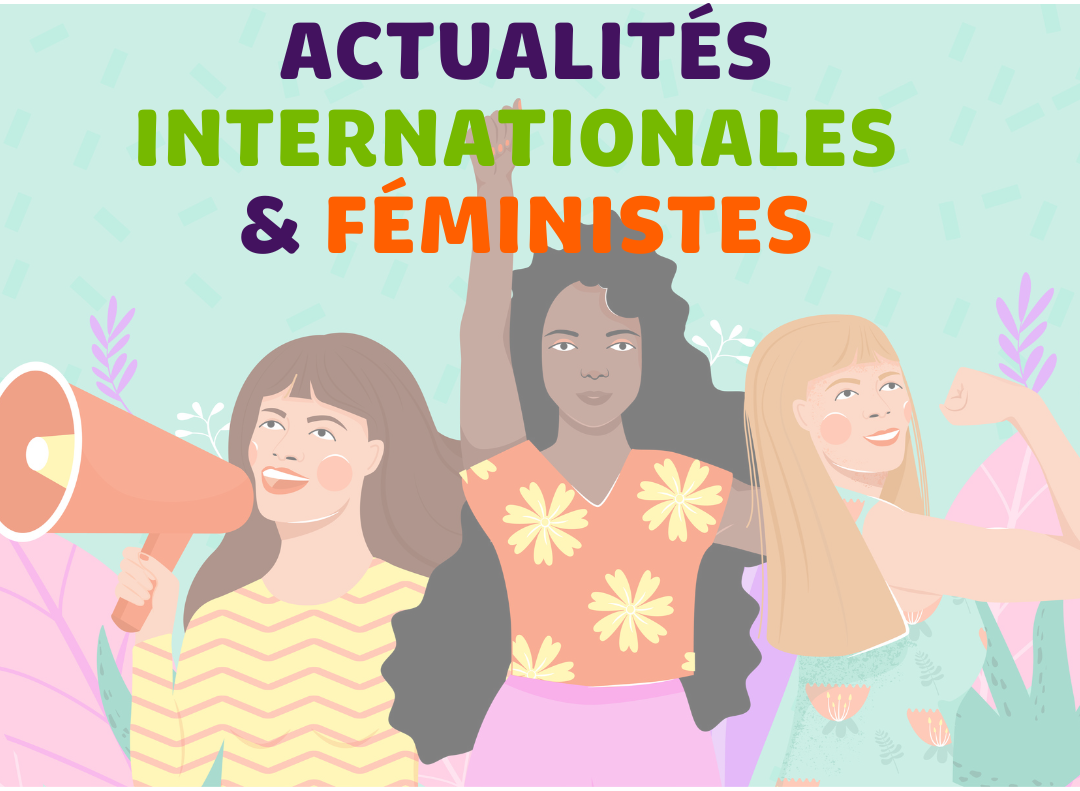
Revue de presse féministe & internationale du 8 au 15 décembre
15 décembre, 2023Revue de presse féministe & internationale du 1er au 8 décembre

ANDORRE
Le procès contre l’avortement
Lundi 4 décembre s’est ouvert le procès de Vanessa Mendoza Cortès, défenseuse des droits des femmes qui milite pour la dépénalisation de l’avortement dans la principauté d’Andorre. Le gouvernement, farouchement opposé à l’IVG, l’a attaquée en justice pour diffamation.
Psychologue et militante, Vanessa Mendoza Cortés est surtout la présidente de Stop Violències (Stop Violences), une ONG andorrane qui lutte contre les violences faites aux femmes et milite pour la dépénalisation de l’avortement dans la principauté. C’est en tant que présidente de cette organisation, qu’elle participe au Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), lors de l’examen du bilan du pays en matière de droits des femmes en 2019. Elle soumet ses observations, notamment concernant l’accès à l’IVG, encore criminalisé.
Vanessa entre dès lors dans le viseur du gouvernement qui commence à la traquer. En juillet 2020, le procureur général l’inculpe de trois accusations de diffamation pénale : « diffamation avec publicité », « diffamation contre les coprinces » et « délit contre le prestige des institutions ». La décision provoque un tollé international et deux des trois accusations sont abandonnées. Après plus de trois ans d’attente, Vanessa Mendoza Cortés a finalement été jugée le 4 décembre, pour « délit contre le prestige des institutions ». La décision est attendue pour le 17 janvier 2024. Si elle est jugée coupable, la militante encourt une amende de 6 000 euros, 6 000 euros supplémentaires de dommages et intérêts, ainsi qu’une interdiction d’exercer une fonction publique pendant six mois. Avant son procès, l’accusée avait dénoncé « le pays oppressif dans lequel nous vivons », qui n’est « pas une démocratie ». Elle a cependant reconnu que l’acharnement du gouvernement contre elle a exposé cette situation « aux habitants d’Andorre et aux étrangers ».
La principauté d’Andorre, micro-État coincé entre la France et l’Espagne de 80 000 habitants, est aujourd’hui le seul pays en Europe où l’avortement est interdit en toutes circonstances. L’accès à l’IVG est en effet prohibé y compris en cas d’inceste, de viol ou de mise en danger la vie de la mère. Une femme qui avorte encourt jusqu’à six mois de prison, et un·e médecin qui pratiquerait un IVG s’expose à une peine de trois ans d’emprisonnement. Le gouvernement de centre-droit, dirigé par Xavier Espot Zamora, n’a montré aucun signe d’évolution de cette loi archaïque, bien au contraire, puisqu’il est à l’origine du procès de Vanessa Mendoza Cortés. Toute tentative de dépénalisation de l’avortement porte en effet le risque de plonger la principauté dans une crise institutionnelle : l’évêque d’Urgell, co-prince d’Andorre, a menacé d’abdiquer si l’avortement était autorisé, en 2014.
De son côté, le deuxième co-prince d’Andorre, le président de la République française Emmanuel Macron, ne s’est jamais exprimé publiquement sur le sujet. En août 2023, l’ex-sénatrice Laurence Cohen et plusieurs députées ont interrogé le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à propos du cas de Vanessa Mendoza Cortés. Le ministère avait réaffirmé sa « diplomatie féministe » et « son action résolue en soutien des défenseurs et défenseures des droits de l’Homme », sans pour autant agir. Laurence Cohen a dénoncé l’hypocrisie d’Emmanuel Macron, dont « La fonction symbolique (…) lui offre la possibilité d’intervenir favorablement » mais qui reste silencieux alors qu’il souhaite constitutionnaliser le droit à l’IVG en France.
Face au silence gouvernemental, la société civile et les féministes ont apporté un soutien massif à Vanessa Mendoza Cortés. Plusieurs militantes se sont déplacées lundi afin d’assister à son procès. De plus, une pétition lancée par Amnesty International réclamant l’abandon des charges contre la défenseuse des droits des femmes a récolté plus de 70 000 personnes, notamment en Belgique, en France et en Irlande. Il faut désormais attendre le 17 janvier.
TV5 Monde, « On me traite comme une sorcière: Vanessa Mendoza, militante pour le droit à l’avortement en Andorre », le 4 décembre 2023.
Amnesty international, « Andorre. Une militante jugée pour avoir fait part de son inquiétude quant à l’interdiction totale de l’avortement lors d’une rencontre de l’ONU », 1 décembre 2023.
EMIRATS ARABES UNIS
COP 28 : où sont les femmes ?
Ce lundi 4 décembre, cinquième jour de la COP 28 à Dubaï, renommé le « Gender Day », a été consacré à la place des femmes et aux inégalités femmes-hommes du changement climatique. Pourtant, la COP28 est doublement critiqué par les organisations féministes pour la sous-représentation de femmes parmi les leaders et la manque de prise en considération de l’impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et les filles.
La COP28, édition 2023 de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, a débuté à Dubaï jeudi 30 novembre et se terminera le 12 décembre. Pendant ces deux semaines, les négociations se poursuivent dans le but d’adopter un accord maintenant en vie l’objectif de contenir le réchauffement climatique à +1,5 degré. Si l’emplacement de la COP28, qui se tient aux Emirats Arabes Unis, a été largement critiqué par la société civile, un autre aspect de la conférence internationale a été pointé du doigt par les organisations féministes, à savoir le manque de considération des femmes et des filles, qui sont pourtant disproportionnellement impactées par les phénomènes climatiques.
En effet, la crise climatique actuelle, comme pour toute autre crise, exacerbe les inégalités déjà existantes dans nos sociétés, et notamment les inégalités de genre. L’impact de ce phénomène est tel qu’il menace d’effacer tous les progrès réalisés ces dernières années en matière de droits des femmes et des filles, selon l’ONG Plan International. Actuellement, le changement climatique prive 4 millions de filles d’école et, selon l’UNICEF, il pourrait en priver 12 millions de plus chaque année d’ici à 2025. Comme le rappelle l’ONG Care, « le changement climatique est sexiste », et s’attaque à tous les droits des femmes. Ainsi, il existe une corrélation entre les mariages forcés et les catastrophes climatiques : au Bangladesh, pendant une vague de chaleur d’un mois, le nombre de mariages de (très) jeunes filles a augmenté de 50%. Autre impact sur les femmes et leurs droits : les phénomènes climatiques entraînent des déplacements de population et la séparation des familles, dont les femmes et les filles sont les premières victimes, puisque plus vulnérables aux violences durant ces changements. Dans certains pays, à l’instar du Botswana, les filles sont responsables d’aller chercher l’eau potable. Mais celle-ci se faisant de plus en plus rare, elles doivent parcourir de plus en plus de kilomètres pour remplir cette corvée.
Il y a donc un réel impact genré du changement climatique, qu’il faut adresser dans toutes ses dimensions. (In)égalité femmes-hommes et changement climatique sont intrinsèquement liés. Comme le précisait le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 2022, « il y a de nombreuses preuves et un large consensus que l’autonomisation des femmes profite à la fois à l’atténuation et à l’adaptation » au réchauffement climatique. L’égalité femmes-hommes représente ainsi un levier d’action pour agir contre le changement climatique. Par exemple, plusieurs recherches ont montré que si toutes les agricultrices avaient accès aux mêmes ressources que les agriculteurs, les rendements augmenteraient, 100 à 150 millions de personnes pourraient manger à leur faim, et les émissions de dioxyde de carbone pourraient être réduites grâce à l’amélioration des pratiques agricoles…
Pourtant, il apparaît difficile d’adopter des mesures sur les droits des femmes et le climat… sans femmes. En effet, plusieurs organisations, dont Care, ont dénoncé le manque flagrant de femmes dans les espaces de négociation et de décision autour du climat, notamment à la COP28. Sur les 133 leaders mondiaux devant intervenir lors de la conférence, seuls 15% sont des femmes. Les femmes sont aussi sous-représentées dans les délégations des Parties, puisqu’elles ne représentent que 38% des délégué·es… Fanny Petitbon, responsable plaidoyer pour Care France, déplore : « Comment allons-nous parvenir à des politiques climatiques efficaces et durables sans tenir compte de la moitié de la population sur terre ? Les femmes et les filles sont les plus touchées par le changement climatique, mais elles sont réduites au silence. Elles sont invisibles. Il faut que cela change ». Il est urgent d’intégrer davantage les voix des femmes, notamment celles des pays dits du Sud, à tous les processus de négociations et de décisions climatiques.
Cependant, une bonne nouvelle a permis de dégriser ces polémiques autour de la COP28 : lundi 4 décembre, Razan Khalifa Al Mubarak, membre du Comité de haut niveau des Nations unies sur le changement climatique, a annoncé le lancement d’un partenariat visant à assurer une transition juste et une action climatique sensibles au sexe, et soutenir l’autonomisation économique des femmes. Ce nouveau partenariat s’articule autour de trois axes : des données de meilleure qualité pour soutenir la prise de décision dans la planification des transitions, des flux financiers plus efficaces vers les régions les plus touchées par le changement climatique, et l’éducation et le renforcement des capacités pour soutenir l’engagement individuel dans les transitions. Les 60 parties signataires devront mettre en œuvre ces mesures et rendre compte de l’évolution à la COP31, dans trois ans.
Plan international, « Pas d’action climatique sans droits des filles », 29 novembre 2023
RFI, « Comment le réchauffement climatique affecte plus les femmes ? », 4 décembre 2023.
CARE France, « COP28: 15 femmes parmi les 133 chefs d’Etat. réaction de l’ONG CARE », 1 décembre 2023.
IRAN
L’utilisation de la violence sexuelle comme arme de silence
Mardi 6 décembre, Amnesty international a publié un nouveau rapport alarmant intitulé « They violently raped me : sexual violence weaponized to crush Iran’s Woman Life Freedom uprising » (« Ils m’ont violé : les violences sexuelles utilisées comme armes pour écraser le soulèvement Femme Vie Liberté »).
En 120 pages, l’ONG détaille 45 témoignages de détenu·es s’étant opposé·es à la politique d’oppression du pays. Certain·es des victimes sont mineur·es, d’autres ont subi des viols collectifs et des violences en tout genre. Le chef de l’Etat iranien, appelé aussi Guide suprême, justifie d’ailleurs leur utilisation en ceci que « si ces femmes anti-islam étaient exécutées vierges, elles entreraient au paradis ». Les hommes aussi sont sujés au viol et à la torture, comme en démontre la récolte de paroles poignantes par Amnesty.
Le rapport met notamment l’accent sur le silence autour de ces violences sexuelles : le silence voulu par les atrocités et le silence tenu par la justice. Les plaintes des victimes ayant eu le courage de s’en remettre à la « justice » seraient en effet étouffées par le système institutionnel afin que les forces de l’ordre et de la sécurité, auteurs des crimes, puissent jouir d’une totale impunité.
Dans toutes conventions internationales traitant des droits humains comme la DUDH (Déclaration universelle des droits humains), l’interdiction des traitements inhumains et dégradants se trouve en tête de liste (article 5 de la DUDH). Pourtant, le régime iranien utilise la torture, le viol et les agressions en toute impunité afin de faire respecter leurs lois liberticides. leur but : intimider les plus téméraires.
Il y a plus d’un an, le 16 septembre 2022, Mahsa Amini mourrait dans sa cellule de détention sous les coups de la police des mœurs. Depuis, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU rapporte une augmentation des cas de violence disproportionnée et arbitraire dans le pays. Les réelles conditions du décès de Mahsa Amini n’ont jamais été avouées par les autorités étatiques et la famille reste, à ce jour, endommagée. L’oncle de la victime et l’avocat de la famille ont d’ailleurs été interpellés pour “propagande” ainsi que deux journalistes ayant couverts l’affaire. Malgré les vagues de colère du pays tout entier, les dispositions législatives en vigueur restent inchangées. Pire, le Parlement a adopté fin septembre 2023 une loi visant à renforcer les amendes et les peines de tout·es celles et ceux qui enfreindrait les règles qui les oppressent.
Ainsi, la politique souhaite clairement attiser la peur de la population. La Mission indépendant d’établissements des faits sur la République islamique d’Iran, mandatée par le Conseil de sécurité de l’ONU, note qu’à ce jour « quiconque participe au mouvement « Femme, vie, liberté », notamment en manifestant ou en partageant publiquement son soutien risque d’être arrêté, détenu, torturé et maltraité, ainsi que poursuivi pour des crimes graves pouvant conduire à l’imposition de la peine de mort ». Le gouvernement iranien bafoue une multitude de normes de droit international et malgré plusieurs appels par l’ONU ou Amnesty international, ce dernier n’a pas pour projet de changer son comportement. La mission indépendante devrait fournir un rapport complet en mars 2024 et d’ici là, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, demande une réaction de la part de la communauté internationale afin d’obtenir une justice véritable. Elle appelle les Etats à faire usage de leur compétence universelle afin d’enquêter sur les crimes et de punir les responsables.
Amnesty international, « Iran. Les forces de sécurité ont eu recours au viol et à d’autres formes de violences sexuelles pour écraser le soulèvement « Femme Vie Liberté » en toute impunité », 6 décembre 2023.
ONU info, « Premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini en Iran : des experts dénoncent la répression accrue contre les femmes « , 14 septembre 2023.
France 24, « En Iran, le viol utilisé pour réduire au silence les prisonniers après la mort de Mahsa Amini », 6 décembre 2021.
FRANCE
L’instrumentalisation des crimes sexuels du Hamas pour diviser le mouvement féministe
En France, notamment depuis la manifestation du 25 novembre, le mouvement féministe est sujet à de vives critiques concernant son comportement face aux attaques du Hamas du 7 octobre. Occultant les prises de parole sans ambiguïté du mouvement féministe, certain·es l’accusent d’oublier, voire de volontairement invisibiliser, les souffrances des femmes juives, alors que d’autres soutiennent que les crimes du 7 octobre ne doivent pas recevoir un traitement particulier… tout ça dans le but de renforcer les divisions au sein du mouvement féministe ?
Une chose semble claire : « Les grands gagnants de la polémique actuelle sont les adversaires du féminisme, qui se frottent les mains » (Laurence Rossignol)
Le 7 octobre 2023, le Hamas, groupe terroriste palestinien, lance une attaque de grande ampleur en Israël, tuant plus de 1200 personnes et prenant en otage 240 autres. L’Etat hébreu lance immédiatement une contre-attaque contre les membres du Hamas sur les territoires palestiniens. Après 2 mois, le bilan humain est catastrophique dans la bande de Gaza. Selon les derniers chiffres de l’UNICEF, 15 523 personnes, dont plus de 5 350 enfants ont été tuées. Comme dans toutes les guerres, les femmes sont particulièrement touchées car elles sont femmes : les Palestiniennes accouchent ou se font amputer sans anesthésie, elles ne peuvent plus s’acheter des quantités de nourriture suffisantes ou des protections hygiéniques. Les Israéliennes victimes du Hamas ont été violées, mutilées, exhibées et tuées de façon barbare.
Le travail de restitution des faits est encore en cours, révélant (ou confirmant) chaque semaine l’ampleur et la gravité des atrocités perpétrées envers ces femmes. Grâce au travail d’enquête de l’unité de police criminelle israélienne Lahav 443 – Israël refusant toute implication de la Cour Pénale Internationale -, l’équipe de gynécologues, médecins légistes, juristes et psychologues ont documenté le caractère collectif et répété des viols, la mutilation des parties sexuelles des victimes, la torture et souvent le meurtre qui s’ensuivent… le tout ayant été filmé par les hommes du Hamas.
Et en France, cette situation fait polémique. Les féministes ne parleraient pas, ou trop peu, des crimes du 7 octobre, elles condamneraient toutes les violences sexistes et sexuelles sauf celles réservées aux femmes juives, elles seraient antisémites… Un hashtag #MeTooUnlessYouAreAJew (MeToo sauf si vous êtes juive) est même relayé. Sur tous les réseaux sociaux, dans tous les médias, l’acharnement est le même : le mouvement féministe est hypocrite, notamment les grandes organisations féministes comme la Fondation des Femmes, directement visée par des critiques virulentes. A la télévision, les chaînes s’en donnent à coeur joie : i24NEWS (chaîne basée en Israël, favorable à Netanyahou) titre « Le silence des organisations féministes », CNews renchérit avec « Otages : le silence des assos féministes ?»… Sur X (anciennement Twitter), sous chaque post de personnes dénonçant le manque de condamnation par les féministes, des commentaires, venant majoritairement d’hommes, en profitent pour critiquer et insulter le mouvement féministe dans son ensemble.
La situation est la même à l’international : aux Nations Unies, l’ambassadeur israélien Gilad Erdan s’en est pris à Sima Bahous, directrice d’ONU Femmes, en ces termes : « Malheureusement, les horreurs endurées par ces jeunes femmes ne méritent pas d’être mentionnées. Pour l’ONU et ses agences, les femmes israéliennes ne sont pas des femmes ». Sima Bahous avait pourtant réagi dès le 8 octobre aux attaques.
Mais revenons à la France. Le 22 novembre, une tribune d’une féministe juive dénonce le silence des organisations féministes françaises au sujet de l’attaque du 7 octobre. Ces organisations, comme la Fondation des Femmes et Nous Toutes, sont attaquées de manière virulente pour leur supposé silence, quand bien même elles se sont exprimées à l’instar d’Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes qui dans sa chronique sur France Inter dénonce les attaques et rend hommage au combat des mères israéliennes et palestiniennes qui militent pour la paix pour que plus aucun enfant ne soit tué dans ce conflit.
Il est important de noter que certaines féministes se divisent effectivement sur le sujet. Dans son enquête sur les accusations portées contre les organisations féministes, la journaliste Barbara Cardin explique : « On voudrait nous faire croire que les ONG peinent à reconnaître les victimes du 7 car elles sont juives (…) mais en réalité personne n’a refusé de reconnaître ces victimes, et ce qu’on nous reproche, c’est de ne pas accorder un traitement particulier à leur cas (…) », car cela reviendrait à plus les considérer que les autres femmes victimes de violences sexuelles dans tous les autres conflits actuels. Au contraire, une tribune publiée dans l’Express, signée par plusieurs personnalités et militantes, regrette que certaines féministes restent silencieuses à propos de l’attaque du 7 octobre, ou se désolidarisent de leurs sœurs juives, en marque de soutien à la cause palestinienne… Elles semblent pourtant (presque) toutes d’accord sur une « manipulation » du féminisme à travers ces polémiques.
La plus grosse polémique autour de ce sujet sensible éclate lors de la manifestation du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au début du rassemblement à Paris, un cortège venu dénoncer les crimes du 7 octobre est pris à partie. Ils et elles accusent Nous Toutes, un des collectifs organisateurs, d’être « complices (des crimes du Hamas) car silencieuses à propos des violences sexuelles commises sur des israéliennes ». S’ensuit un tollé sur les réseaux sociaux et quelques médias, et Nous Toutes et d’autres organisations féministes sont directement accusées d’avoir empêché ce collectif de manifester et, plus généralement, de « nier les violences sexuelles et féminicides perpétrés contre des femmes juives » commis le 7 octobre. Les deux principaux organisateurs de la manifestation, Nous Toutes et Grève Féministe, publient donc un communiqué pour démentir ces accusations, au titre évocateur : « Stop aux attaques contre le mouvement féministe ! Nous refusons l’instrumentalisation de nos luttes ». Les organisations y expliquent que la mise à l’écart du groupe en question est due au fait que « beaucoup d’hommes portaient des gants coqués, ce qui a inquiété les organisations présentes et la police qui y ont reconnu des personnes d’extrême droite. Les CRS ont décidé de les encadrer sur la place de la Nation ». Elles confirment également que « des organisations et des personnes juives féministes étaient présentes aux côtés des autres organisations et collectifs féministes ».
Suite à cette polémique, les organisations féministes françaises, tour à tour, réitèrent leur condamnation des crimes sexuels du 7 octobre et leur soutien aux femmes victimes. Mais le mal est fait, ou plutôt la récupération engendrée. Comme le souligne la sénatrice Laurence Rossignol, « Les grands gagnants de la polémique actuelle sont les adversaires du féminisme, qui se frottent les mains ».
L’objectif de ces critiques et polémiques est donc clair : tenter de décrédibiliser le mouvement féministe, notamment en sous-entendant qu’il tiendrait un discours à géométrie variable concernant les violences sexistes et sexuelles, en polémisant sur les divergences existantes au sein du mouvement, et en profitant de ces sombres événements pour critiquer et insulter les féministes. Alors que, comme le souligne Laurence Rossignol en référence à ces polémiques, « Le cœur même du féminisme depuis ses débuts est de considérer que ce qui est commun à la condition des femmes est plus important que ce qui les sépare ».
Nous réaffirmons, en tant que féministes, notre condamnation la plus totale des crimes sexuels commis le 7 octobre par le Hamas, ainsi que notre solidarité à toutes les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans les conflits de notre monde.
Presse toi à gauche, « Les féministes font-elles un déni des crimes sexuels du 7 octobre? », 28 novembre 2023.
TF1 info, « Crimes sexuels du Hamas : critiquées pour leu silence, les associations féministes se défendent », 29 novembre 2023.
Elle, « Viols en Israël – Laurence Rossignol : « Les adversaires du féminisme se frottent les mains »« , 1 décembre 2023.
L’express, « Un curieux féminisme : elles dénoncent le tour pris par la manifestation du 25 novembre« , 27 novembre 2023.
Sandra Day O’Connor
En devenant la première femme à siéger à la Cour suprême américaine, brisant ainsi « un des plus grands plafonds de verre » des Etats-Unis, la juge Sandra Day O’Connor a marqué l’histoire juridique du pays. Elle s’est éteinte vendredi 1er décembre à l’âge de 93 ans.
Sandra Day O’Connor est nommée à la Cour suprême en 1981 par le président républicain Ronald Reagan, dont c’est la première nomination. Après que le Sénat ratifie sa nomination, avec 99 voix pour et aucune voix contre, la nouvelle juge de la plus haute instance juridique du pays devient la première femme à accéder à ce poste prestigieux. Elle y siégera 24 ans, avant de démissionner en 2005 pour s’occuper de son mari malade. Cette décision peu courante avait été applaudie par de nombreuses femmes qui se sont reconnues dans sa difficulté à mêler vie personnelle et vie professionnelle. Sandra Day O’Connor s’était ensuite retirée de la vie publique en 2018, après avoir annoncé qu’elle souffrait d’une forme de démence.
Souvent décrite comme une « voix de la modération » au sein de la Cour, Sandra Day O’Connor et ses positions centristes ont souvent été décisives pour faire pencher la balance d’un côté plutôt qu’un autre. Elle a rendu de nombreuses décisions importantes, dont plusieurs liées aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes. Ainsi, à deux reprises, en 1989 et en 1992, la juge fait pencher la Cour suprême du côté démocrate en votant en faveur de la préservation de l’arrêt Roe v Wade de 1973, aujourd’hui renversé, qui consacre le droit fédéral à l’avortement. En 1999, se positionne contre le harcèlement sexuel dans la célèbre affaire Davis v. Monroe County Board of Education.
Elle a également été une voix influente dans des affaires concernant la discrimination basée sur le sexe. Ainsi, en 1982, dans une affaire dans laquelle une école d’infirmières avait interdit l’admission d’un élève homme, la juge O’Connor avait déclaré qu’une école publique ne pouvait pas refuser l’admission d’un homme uniquement en raison de son sexe : « Plutôt que de compenser les obstacles discriminatoires rencontrés par les femmes, la politique de l’école du Mississippi consistant à exclure les hommes de l’admission à l’école d’infirmières tend à perpétuer l’image stéréotypée de l’infirmière comme étant un travail exclusivement féminin ». Cette décision a ensuite été importante pour l’admission des femmes dans les écoles masculines. Enfin, elle s’est aussi engagée dans sa vie quotidienne, en engageant de nombreuses assistantes femmes dans son cabinet, contrairement à ses confrères.
Pour sa brillante carrière, Barack Obama, alors président des Etats-Unis, avait remis à la juge O’Connor la médaille de la liberté, plus haute distinction civile américaine, en 2009. Après la nomination historique de Sandra Day O’Connor, cinq autres juges femmes ont suivi ses pas et ont été nommées à la Cour suprême. Quatre de ces femmes, nommément Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett et Ketanji Brown Jackson, sont actuellement en fonctions, un record pour la Cour.
The New York Times, « In and out of the Courtroom, O’Connor inspired a generation of women », 2 décembre 2023.
Le Monde, « Sandra Day O’Connor, première femme à siéger à la Cour suprême des Etats-Unis, est mort », 1 décembre2023.
« Femmes engagées », un nouveau podcast de Femmes du Monde et Réciproquement.
Jocelyne Adriant-Mebtoul, fondatrice et présidente de l’association Femmes du Monde et Réciproquement, vous présente le nouveau podcast « Femmes Engagées », dans lequel vous pourrez découvrir des femmes du monde entier.
Au cours d’une conversation, l’invitée racontera son parcours, ce qui l’a amenée dans la lutte, ses objectifs et ses espoirs. Ce podcast est un espace de liberté dans lequel les femmes peuvent prendre la parole sans se soucier du contexte politique ou économique de leur pays d’origine. Elles peuvent imaginer, réfléchir mais également transmettre sans condition et en toute bienveillance. Pour que cela soit le plus interactif possible, les podcasts de vingt-cinq minutes environ sont divisés en deux parties : premièrement la parole est donnée à l’invitée au travers de questions ouvertes sur son engagement, ses travaux et le lien entre son histoire et sa lutte ; puis l’entretien se termine avec un questionnaire de Proust revisité. Ainsi au fil du podcast vous apprendrez à connaître aussi bien politiquement que personnellement ces femmes qui se battent au quotidien pour que leurs droits soient plus reconnus dans leur pays.
Pour le premier épisode, paru le vendredi 1er décembre, c’est Tatiana Mukanire-Bandalire qui est invitée. Cette militante congolaise qui se bat contre les violences sexistes et sexuelles dans son pays raconte son histoire, la vie qu’elle a perdu durant la guerre en 2004 lorsqu’elle a été victime d’un viol comme arme de guerre et comment elle a retrouvé espoir et confiance en l’homme grâce à celui qui est aujourd’hui son mari. Elle souligne qu’elle n’est pas née féministe, elle est devenue féministe en réponse à ce qu’elle a vu et vécu au cours de sa vie. Son plus grand rêve serait que les droits de femmes soient réellement reconnus et respectés dans son pays et que les législateurs ne « piétinent » pas leurs propres lois sur les droits humains. Tout au long du podcast vous pourrez ressentir le sourire qu’elle dit avoir « facilement » et la force qu’elle entretient tous les jours tout en s’efforçant de la transmettre autour d’elle.
On espère vous avoir donné envie de les écouter et on vous donne rendez-vous tous les vendredis matins sur toutes les plateformes d’écoute pour retrouver un nouveau portrait d’une Femme Engagée.
Retrouvez le podcast « Femmes engagées » sur Spotify