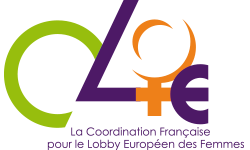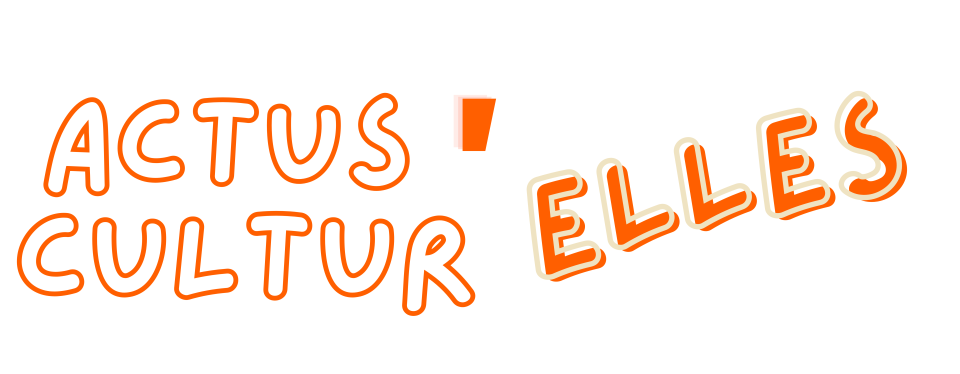La CLEF recrute son ou sa prochain·e service civique !
30 novembre, 2023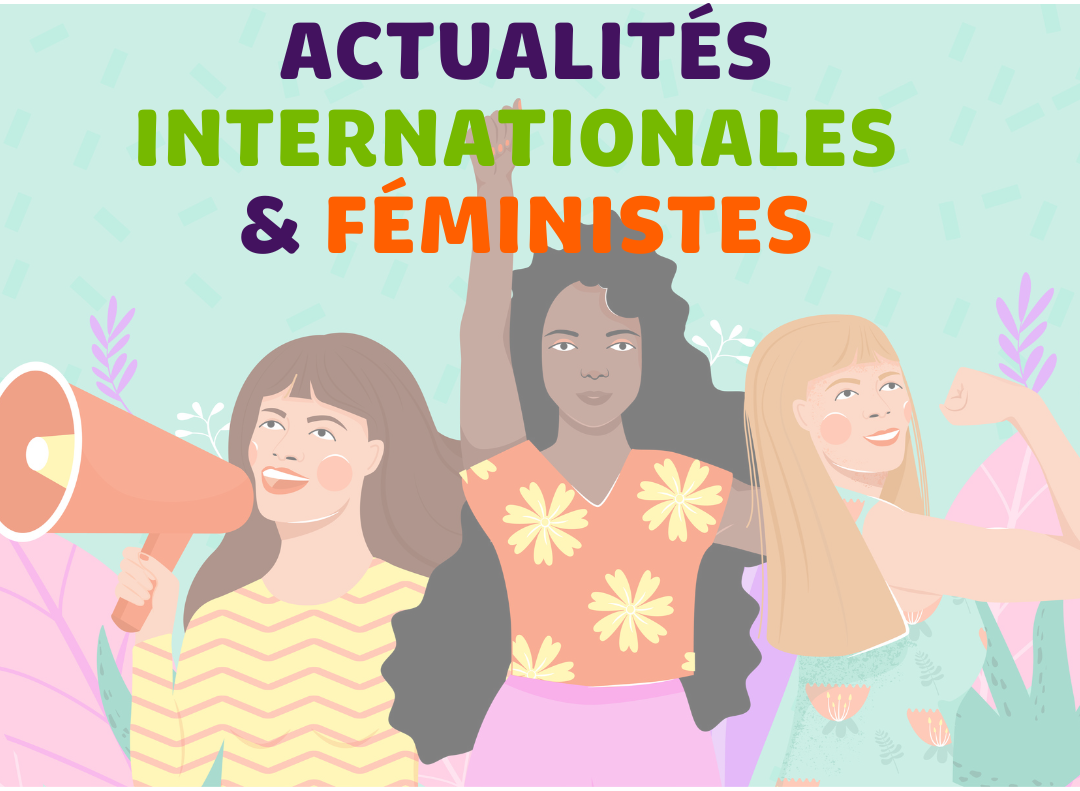
Revue de presse féministe & internationale du 1er au 8 décembre
8 décembre, 2023Revue de presse féministe & internationale du 24 novembre au 1er décembre

FRANCE
Un recul pour la pénalisation des viols conjugaux.
En juillet dernier a été décidé par le parquet de Paris, la direction régionale de la police judiciaire et la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, que les viols commis « dans un contexte conjugal » ne seraient plus traités par la police judiciaire – comme c’est le cas pour les viols hors contexte conjugal – mais directement par le commissariat. Ceci en raison d’une trop grande quantité de dossiers à traiter par la PJ.
Depuis 2017 et le début du mouvement #MeToo, le nombre de plaintes pour violences sexuelles conjugales a fortement augmenté, avec une hausse de 164%. On compte également une augmentation de 116% du nombre de poursuites judiciaires à la suite d’une plainte. Toutefois, sur les 3641 plaintes pour violences sexuelles au sein du couple recensées en 2022, seuls 328 agresseurs ont été condamnés. La principale raison d’une telle différence est le manque de formation des policier·es pour ce genre d’affaires. En outre, il a été montré que les viols conjugaux, assignés à la police judiciaire, sont souvent sous-traités car considérés comme moins « nobles » que les autres agressions ou crimes en tout genre dans la mesure où l’agresseur est déjà connu et que les preuves matérielles sont souvent inexistentes. La sociologue Océane Pérona avait d’ailleurs mis en avant cet écueil dans un article nommé « La difficile mise en œuvre d’une politique de genre par l’institution policière : le cas des viols conjugaux ». Elle y montre une classification des violences physiques et sexuelles au bas de laquelle se trouve le viol conjugal, qui permet une comparaison de la part du policier au mari mis en cause. Ainsi, la violence sexuelle est réfléchi à l’aune de la sexualité du policier, ce qui affecte grandement la prise en charge plus ou moins sérieuse du dossier. Finalement, ce manque d’entrain à travailler sur une violence sexuelle conjugale fait que, face aux nombreux dossiers qui acculent la PJ, c’est elle qui est laissée au bas de la pile. Il est alors courant d’attendre plus de six mois en cas de viol conjugal pour avoir une réponse du commissariat.
Face à ce trop-plein de dossiers et la difficulté des traitements des affaires, il a été décidé, sans demander l’avis des juges d’instruction, de faire passer l’entièreté du dossier aux mains des Brigades Locales de Protection de la Famille, qui prenaient déjà en charge les cas de violences conjugales. Certain·es magistrat·es y voient une opportunité d’un meilleur traitement des affaires par des personnes formées, d’autres y voient une requalification des crimes de viol, perdus au sein du continuum des violences conjugales. En effet, bien que les personnes au sein des BLPF soient formées à recevoir la parole des victimes, souvent dans un endroit adapté aussi bien aux adultes qu’aux enfants et permettant à la victime de ne raconter que le nombre de fois nécessaires les crimes qu’elle a subis, ils n’ont pas « les moyens et l’esprit de la PJ », habitués à gérer des crimes. En outre, ces brigades spécialisées ne sont pas présentes dans tous les commissariats : les personnes habitant dans les campagnes n’ont donc pas la possibilité d’y accéder. C’est pourquoi des associations comme le Collectif Français Contre le Viol Conjugal (CFCVC) avait, déjà en août de cette année, demandé une formation de tous·tes les policier·es aux violences sexuelles intrafamiliales.
Donner les dossiers de violences sexuelles aux BLPF, bien que permettant une possible meilleure prise en charge que par une PJ débordée, ne fait donc que clôturer le viol conjugal dans le continuum des violences et le faire disparaître, comme c’est encore beaucoup le cas. Pourtant il ne faut pas oublier que le contexte conjugal est une circonstance aggravante en cas de viol et qu’il n’est pas un crime à part entière. Le gérer au sein d’une brigade à différente des viols non-conjugaux ne fait alors que renforcer cette différenciation et déqualification, même si chaque magistrat a toujours la possibilité de saisir le service de police qui lui semble le plus adapté. Malgré tout, certain·es magistrat·es craignent la difficulté de la saisine tant qu’il faut un motif valable pour changer de service de police, et ont peur que cela discrédite leurs demandes.
C’est pourquoi certaines personnes du milieu, comme l’avocate Anaïs Defosse, préconisent plutôt la création d’un nouveau service dédié aux violences sexistes et sexuelles qui prendrait en charge aussi bien les cas de viols conjugaux, viols hors contexte conjugal ou encore incestueux, permettant de désengorger la PJ, tout en conservant ce rôle de police criminelle que ne détient pas la BLPF. Cela reviendrait alors à prendre en compte non pas le contexte dans lequel le crime a été commis mais bien la « contrainte morale » omniprésente dans ces cas, prenant parfois, lors des viols conjugaux, le pas sur la contrainte physique : selon une enquête menée par le HCE en 2022, 1/3 des femmes ont déjà cédé à un acte sexuel après forte insistance. Face aux réticences du syndicat de la magistrature et de certaines associations, le parquet de Paris soutient que les effectifs des BLPF seront renforcés pour être en mesure de répondre à toutes les plaintes et que les policiers seront formés aux violences intra-familiales. Pourtant, on est en droit de se demander si ce déplacement des affaires n’est pas un moyen de reléguer à nouveau au privé des actes qui relèvent de l’infraction la plus haute dans le Code Pénal français.
Mediapart, « À Paris, le traitement policier des viols conjugaux fait débat », 24 novembre 2023.
Libération, « TDepuis #MeToo, les procédures pour agression sexuelle ou viol sur conjoint en augmentation de 164% », 10 novembre 2023.
MONDE
Les marches du 25 novembre.
Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a été instaurée par l’ONU en 1999 en réponse de l’assassinat de trois soeurs dominicaines opposantes au partie de l’ancien dictateur Rafael Trujilo, le 25 novembre 1960. Leur mort entraînera celle du chef d’Etat et le soulèvement du pays tout entier.
Cette date est donc celle choisie pour rappeler l’état systémique des violences de genre à l’encontre des filles et des femmes dans le monde. A ce jour, aucun Etat ne connaît une égalité de fait entre les sexes. Chacun·e peut être confronté·es au sexisme, à du harcèlement, des agressions, un mariage forcé voire la mort, uniquement en raison de son genre. Comme rappelé par Amnesty International, dans l’Union européenne, 1 femme sur 5 a déjà subi des violences phyisiques ou sexuelles de la part de son compagnon. En France, depuis le début de l’année 2023, le collectif NousToutes a déjà décompté 121 féminicides, soit plus qu’en 2022.
Ces derniers temps, la montée au pouvoir des parties d’extrême droite ne fait que nuir aux combats déjà menés, notamment ceux de longue date comme l’accès à l’avortement que ce soit aux Etats-Unis, en Pologne ou potentiellement en Argentine selon le programme du président récemment élu Javier Milei. En Palestine et en Israël, les femmes sont les premières victimes de la guerre. Malgré tout, les femmes continuent de faire entendre leur voix et ce, même dans les pays où les restrictions à leur encontre sont des plus sévères. Les marches françaises du 25 novembre étaient donc, entre autres, un moyen de relayer la parole des femmes les plus démunies.
Samedi, des dizaines de milliers français·es se sont réuni·es dans les rues des grandes villes comme Paris, Lyon, Strasbourg et Lille, pour soutenir la lutte contre les violences de genre. A Paris, plusieurs cortèges, dont le chef de file était tenu par les familles des victimes de féminicides, défilaient sous les voix des manifestantes. Des slogans scandés tels que « solidarité avec les femmes du monde entier » et écrits comme « éduquez vos fils plutôt que protégez vos filles » résonnaient de la place de la Nation à celle de la République. Le violet (couleur du féminisme) couvrait aussi les rues de Madrid et de Rome, l’Italie étant fortement endeuillée depuis la mort de Giulia Cecchettin, 22 ans, tuée par son ex compagnon.
Des rassemblements en Amérique Latine ont également eu lieu, notamment en raison des chiffres accablants de féminicides ayant lieu dans la région. Au Mexique, en moyenne 10 femmes sont assassinées chaque jour (selon Amnesty International). En 2022, le Brésil a connu 722 féminicides. Les argentin·es font aujourd’hui face à un opposant de taille : le nouveau président de la République Javier Milei.
Ainsi, comme le soutiennent, à juste titre, les associations féministes ayant défilé samedi, « Nous ne voulons plus compter nos mortes ».
Amnesty International, « VPourquoi une journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre? »
TV5 Monde, « Manifestations dans plusieurs pays contre les violences faites aux femmes », 25 novembre 2023.
Le Monde, « Manifestation contre les violences faites aux femmes : des milliers de personnes ont marché à Paris et dans les grandes villes de France », 25 novembre 2023.
KAZAKHSTAN
Quand les femmes s’emparent du tabou des violences.
Depuis plusieurs années, les groupes féministes se battent pour que les violences domestiques soient à nouveau criminalisées au Kazakhstan. Ce combat a été ravivé le 17 novembre, après le féminicide d’une jeune femme de 31 ans par son compagnon. Compagnon qui n’était autre que le ministre de l’économie kazakhe ; sa notoriété créant une vague de contestation du système législatif et judiciaire actuel au sujet des violences de genre et domestiques.
Dans la culture kazakhe, il est plus prestigieux pour une famille d’avoir un garçon qu’une fille, ce qui signifie que les filles démarrent leur vie avec une sorte de handicap social, elles doivent prouver qu’elles ont de la valeur. C’est pourquoi lorsqu’elles sont scolarisées, elles doivent avoir les meilleures notes et ce, jusqu’à ce qu’elles arrêtent d’aller à l’école. Il est pourtant rare qu’elles poursuivent leurs études au-delà du baccalauréat, dans la mesure où il est plus attendu d’une jeune femme qu’elle trouve un mari et devienne mère de famille plutôt qu’elle ne fasse de longues études. En effet, après vingt-cinq ans, une femme est déjà considérée comme trop vieille pour le mariage, ayant dépassé la période de sa vie la plus propice pour procréer. La place des femmes est donc culturellement au foyer, tandis que le mari apporte l’argent. Mais, ce mari ne recevant pas d’enseignement de la part de ses parents sur la manière dont il faut se comporter pour être un bon père ou un bon mari, les écueils se répètent de génération en génération.
Le principal facteur de violences est l’alcoolisme : les hommes, sur qui repose le bon fonctionnement du foyer, ressentent une forte pression et tombent souvent dans l’alcool. Lorsque ce facteur est couplé avec un éventuel temps de chômage du mari, n’ayant alors pas d’argent pour subvenir aux besoins de la maison mais le dépensant pour acheter son alcool, les risques de violence domestique sont d’autant plus forts, les disputes étant récurrentes. Malheureusement les violences domestiques ne sont pas considérées comme un crime à part entière au Kazakhstan. Pire encore, les agressions par coups et blessures ou les atteintes physiques légères ont été décriminalisées en 2017. Les femmes ne peuvent donc rien faire face aux violences qu’elles subissent au sein de leur foyer, qui ne font qu’augmenter depuis cette décriminalisation.
Durant le confinement, un pic de violence envers les femmes a été enregistré, avec une augmentation de 25% des cas de violences conjugales et une augmentation de 34% de féminicides conjugaux. La police aurait enregistré pas moins de 46 000 appels de témoignages de violences conjugales dans les quatre premiers mois de 2020. En réponse à cette augmentation a été signée une loi pour la prévention des violences domestiques au début de la même année, mais cela n’a pas eu d’effets sur leur statut juridique. Cette loi semble effectivement portée sur la protection de la famille en tant qu’institution plutôt que pour les femmes. Depuis lors, des groupes de femmes et d’hommes se battent pour une meilleure prise en charge de ces violences.
A ce titre, en réponse au féminicide du 17 novembre, un groupe d’athlètes, d’avocat·es, d’artistes ou encore de blogueur·ses ont publié une vidéo demandant des mesures plus fortes pour la répression des violences faites aux femmes et notamment une criminalisation de la violence domestique. Les législateurs réfléchissent actuellement à la possibilité de recriminaliser partiellement les coups et blessures et les atteintes physiques légères, tandis que le député parlementaire Zhuldyz Suleimenova, du parti majoritaire, a proposé une criminalisation de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants et l’établissement d’une autorité différente pour les violences domestiques. Mais le système social du pays ne permet pas encore une répression formelle puisque les violences ne sont que très peu discutées voire reconnues et dans les petites villes, la proximité des habitant·es fait qu’une plainte pour violence est traitée comme une simple dispute familiale.
Au-delà des institutions judiciaires, même les institutions étatiques ne prennent pas ce problème au sérieux, ignorant les revendications des associations et produisant des textes de loi allant à l’encontre d’autres mesures déjà en place ou n’appliquant tout simplement pas les lois en vigueur susceptibles de soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes. C’est donc bien « le système qui permet que cela arrive », comme le dit Kana Beïsekeïev, réalisateur du documentaire kazakhe Les femmes.
Novastan, « « La Femme », un documentaire sur les violences domestiques au Kazakhstan », 7 juin 2021.
Human Rights Watch, « Kazakhstan Woman’s Death a National Tragedy », 27 novembre 2023.
REFPoM, « Des femmes contre les violences domestiques qui augmentent avec les périodes de confinement en Asie centrale », 10 janvier 2021.
FRANCE
Ile de France : « Avez-vous été victime de violences ? »
Depuis le mois d’octobre 2023 se sont généralisés les partenariats entre les services de police, les parquets et les hôpitaux d’assistance publique de Paris afin de permettre aux victimes de violences conjugales d’avoir la possibilité de porter plainte directement depuis les urgences des hôpitaux de Paris, du Val de Marne, Seine Saint Denis et Hauts de Seine.
En essai depuis 2020, ce dispositif a permis de recueillir 46 plaintes, 30 à Paris et 16 à Créteil. Bien que ce chiffre semble bas, il est important de considérer que ce sont des plaintes qui n’auraient certainement jamais été posées à cause du manque de sécurité que les victimes ressentent au sein des commissariats. En effet, selon une enquête menée par NousToutes qui a été le levier de la création de ces dispositif, 68% des femmes qui ont porté plainte révèlent une « banalisation des faits » ou pour 50% d’entre elles, une forte culpabilisation de la part des policiers. Policiers qui, dans 55% des cas, refusent de prendre la plainte de ces femmes malgré une obligation légale de le faire dans la mesure où c’est grâce à un dépôt de plainte que peut s’enclencher une démarche de protection des victimes et de leurs enfants. Pourtant, au-delà d’une simple plainte, ce dispositif permet de faire savoir aux femmes qu’elles sont écoutées et qu’elles peuvent profiter des urgences pour trouver une solution, qu’elle soit judiciaire, psychologique ou sociale. Pour Laurent Nuñez, il est important de faire jouer le collectif dans ces cas et « d’aller vers ».
« L’idée c’est que les urgences soient vues comme un lieu qui peut apporter des solutions »
Lors de cas de violence constatée sur une personne – hors accident de la route – les médecins cherchent à savoir si les marques sont dues à des violences conjugales. Si la victime acquiesce, alors l’urgentiste peut demander si la personne veut porter plainte. Si tel est le cas, un appel est envoyé grâce à une ligne directe au service de police, qui envoie à tout moment de la journée ou de la nuit, une patrouille en civil, afin d’instaurer un lien de confiance en dehors de tout cadre administratif et surtout de rester discret. La déposition se fait ensuite à l’hôpital, en toute confidentialité. Si la personne n’est pas en mesure de retracer son parcours, un lien aura déjà été créé avec les policiers, qui permettra un dépôt de plainte plus tard. Ce dispositif permet également de faciliter l’enquête préliminaire puisque des preuves matérielles des violences sont déjà constatées par du personnel soignant. Si la personne ne souhaite pas porter plainte, l’hôpital lui remet son dossier médical qu’elle pourra utiliser si elle décide éventuellement de porter plainte. Un cas est toutefois important à relever : si la personne semble être en cas de grand danger immédiat, le procureur est tout de suite informé par mail et l’urgentiste encourage la victime à porter plainte, en lui assurant une protection et un endroit où aller tel que les Maisons des femmes où sont proposés des ateliers collectifs, des rendez-vous psychologiques ou avec un·e assistant·e social·e. Si la personne ne souhaite pas porter plainte malgré cela, l’urgentiste est tenu de lui révéler que le procureur a été prévenu.
On espère que ce dispositif permettra, au-delà d’une augmentation générale des plaintes, une baisse du taux de plaintes pour violences conjugales classées sans suites qui atteint actuellement les 80%. Sur les 122 femmes mortes des coups de leur conjoint (ou ex-conjoint) en 2022, 16 d’entre elles avaient porté plainte. C’est pourquoi en juin 2023, le ministère de la Justice a fait savoir que de nouveaux dispositifs d’accueil allaient se déployer sur l’ensemble du territoire et notamment dans des lieux de santé afin de réunir tous les acteur·ices nécessaires à l’accompagnement de la victime dans son parcours judiciaire. Ce dispositif en fait partie et commence déjà à se développer nationalement avec 300 conventions signées ou en cours de signatures entre les hôpitaux, les services de police et de gendarmerie et les parquets dans des villes telles que Colmar, Angers ou encore Chartres.
Toutefois, il n’est pas certain que ce dispositif fasse baisser le taux de classement sans suite des plaintes pour viol ou agression sexuelle. En outre, le dispositif prenant place aux urgences, il ne peut être proposé qu’aux victimes décidant de s’y rendre et présentant des liaisons corporelles importantes et nécessitant des soins immédiats (hématomes, fractures etc). Ne sont donc pas prises en compte d’autres violences causant moins de conséquences physique pour la victime, ni les viols par contraintes morales ou encore les autres violences conjugales : économiques, verbales, psychologiques, etc. Pour réellement aider, il faudrait ajouter une formation pour la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans le cursus de formation des soignant·es. Et que la question « Avez-vous été victime de violences ? » devienne un réflexe du corps médical.
Service Public, « Ile-de-France : les victimes de violences conjugales peuvent porter plainte directement à l’hôpital », 18 octobre 2023.
Le Monde, « Violences conjugales : en Ile-de-France, le dépôt de plainte étendu aux urgences des hôpitaux de quatre départements », 4 octobre 2023.
France Info, « En Ile-de-France, les victimes de violences conjugales peuvent porter plainte aux urgences : « Sans ce partenariat, elles nous échapperaient » », 25 novembre 2023.
Woppa Diallo.
Juriste spécialisée dans la protection et la promotion des droits des femmes et militante féministe depuis son plus jeune âge, la sénégalaise Woppa Diallo se bat notamment pour l’éducation des filles dans son pays.
Woppa Diallo est originaire de la région de Matam, dans le nord du Sénégal, particulièrement touchée par les violations des droits des filles et des femmes. A l’âge de 12 ans, elle subit une mutilation génitale féminine, une pratique encore courante à Matam, où entre 60% et 79% des femmes en sont victimes, bien qu’elle soit interdite dans le pays depuis 1999. « J’ai ressenti une colère extrême envers les gens » raconte Woppa dans le quotidien The Guardian en parlant de cet événement traumatisant, qu’elle qualifie de « violation de ma vie privée » et de « torture ».
Trois ans plus tard, à l’âge de 15 ans, Woppa Diallo fonde l’Association pour le Maintien des Filles à l’Ecole (Amfe), après le départ d’une de ses camarades de classe, contrainte de se marier. La problématique des mariages et des grossesses précoces est en effet très présente dans la région de Matam, qui possède le taux d’alphabétisation le plus bas du Sénégal. Selon les mots de Woppa, « Nous sommes réservées pour nous marier et avoir des enfants ». Depuis 2008, son association lutte donc pour le maintien des filles à l’école, mais pas seulement : Amfe se bat également pour garantir une éducation de qualité aux filles sénégalaises, dans un environnement sûr qui protége les filles de toute forme de violence et de discrimination. L’organisation doit donc lutter contre une double contrainte : d’abord celle de la pauvreté et du manque d’infrastructures disponibles, ainsi que la contrainte sociale selon laquelle les jeunes filles doivent abandonner leurs études pour assurer leur rôle d’épouse et de mère au foyer… En parallèle, Amfe propose aussi des formations sur plusieurs thèmes, tels que les droits sexuels et reproductifs et la violence à l’égard des femmes.
L’association fondée par Woppa Diallo compte aujourd’hui plus de 250 membres, présent·es dans 14 villages. Selon sa fondatrice, sa force repose dans son statut d’organisation locale : il est plus facile d’apporter un tel changement de l’intérieur de la communauté, plutôt que d’un pays occidental. « Nous sommes toutes les nièces, les petites-filles, les filles de quelqu’un. Les gens sont obligés d’écouter ».
Le mois dernier, A soul of small places (Une âme des petits endroits), le livre qu’elle a co-écrit avec son mari, Mame Bougouma Diene, a remporté le prix Caine pour l’écriture africaine à Londres. Mame Bougouma Diene s’est inspiré des témoignages de sa femme sur les violences dont sont victimes les filles et les femmes dans sa région. Woppa Diallo a annoncé que le couple consacrerait la moitié du montant gagné à l’achat de serviettes hygiéniques pour les filles de Matam.
The Guardian, « ‘I felt extreme anger’: the FGM survivor ending abuse and giving a voice to girls in Senegal », 24 novembre 2023.
Le Quotidien, « Littérature – Auteurs de «Une âme des petits endroits» : Woppa Diallo et Mame Bougouma Diène remportent le Prix Caine », 6 octobre 2023.
Festival – Les Femmes s’en Mêlent.
Le festival de musique Les Femmes s’en Mêlent est en tournée en France depuis le 23 novembre et ce, jusqu’au 8 décembre. Ce festival de musique 100% féminin cherche à contrebalancer une industrie musicale inégalitaire en donnant une chance aux nouvelles artistes indépendantes.
Face à la sous-représentation des femmes dans les programmations des festivals de musique, depuis le 8 mars 1997, Les Femmes s’en Mêlent propose à des artistes indépendantes de donner des représentations sur scène, afin de leur offrir une chance que l’industrie n’est parfois pas prête à leur faire. De grands noms tels que Christine & the queens, Regina Spector, Yelle ou encore Soko ont débuté grâce à ce festival qui ne perd pas en force d’année en année, bien au contraire. Au programme cette année, de jeunes artistes prometteuses comme En attendant Ana, Blumi ou même Silly Boy Blue. Les artistes du festival sont présentes à Paris du 28 novembre au 2 décembre mais il est toujours possible d’assister à des concerts dans d’autres villes jusqu’au 8 décembre. En effet, le festival a un rayonnement national avec des concerts à Marseille, Toulouse, Bordeaux ou encore Rennes mais également international puisqu’on a vu des concerts à Madrid, Londres et Montréal.
Pour Stéphane Amiel, fondateur du festival, le mot clef de ce festival est « l’indépendance », aussi bien artistique que musicale, les femmes étant entièrement libres de la musique qu’elles proposent. L’accent est mis sur les femmes en début de carrière, qui n’ont pas encore de label mais qui souhaitent percer dans le monde de la musique. C’est donc une forte volonté d’égalité et de représentation qui anime le festival.
A ce titre, Amiel a créé il y a deux ans un second projet dans le même acabit, permettant aux femmes et personnes non-binaires, aussi bien artistes chanteuses que musiciennes ou techniciennes de participer à des ateliers, des conférences, des projections ou des débats pour que les personnes se rencontrent, échangent, apprennent les unes des autres. Ainsi, Les femmes s’engagent a pour but de se battre pour l’égalité femmes-hommes en offrant un espace dédié à la vocation de ces femmes. En repérant des thématiques clefs, ce programme œuvre à l’amélioration de l’égalité mais également à l’amélioration des projets de chacune en travaillant sur les besoins spécifiques de chaque initiative. Toutefois, pour ne pas se faire distancer par une société changeante, une évaluation du programme est proposée aux participantes, afin de le rendre encore plus effectif l’année suivante. Tout le monde est la bienvenue, avec pour seul critère, d’être soi, de vouloir créer ou aider à la création et d’être passionnée. Ce travail en groupe peut aussi donner de nouvelles vocations à certaines femmes qui n’osaient pas se lancer dans un domaine phallocentré mais qui voient en ces programmes un espoir d’égalité, de chamboulement des stéréotypes.
Les femmes s’en mêlent, « Le rendez-vous avec celles qui assureront l’avenir de la musique »
France Info, « Festival Les Femmes s’en mêlent : une nouvelle tournée pour célébrer les artistes indépendantes et la création musicale au féminin », 27 novembre 2023.
Ministère de la Culture, « »Les Femmes S’en Mêlent », le rendez-vous de la scène musicale féminine indépendante », 14 novembre 2022.