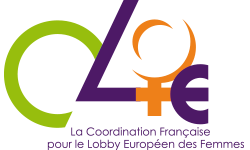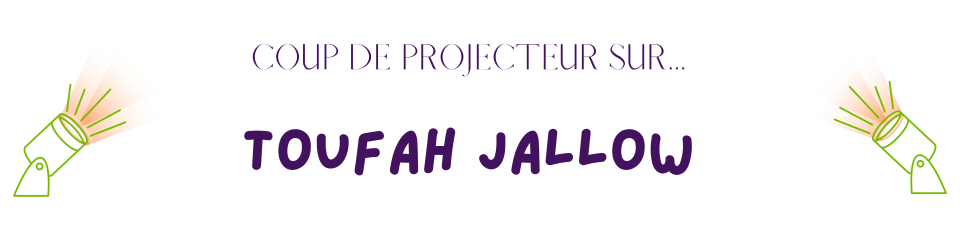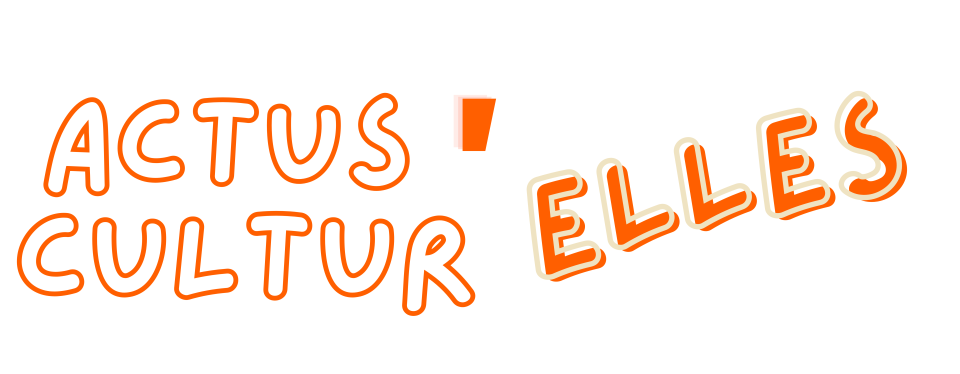Mardi de la CLEF #28 : La diplomatie féministe
22 septembre, 2023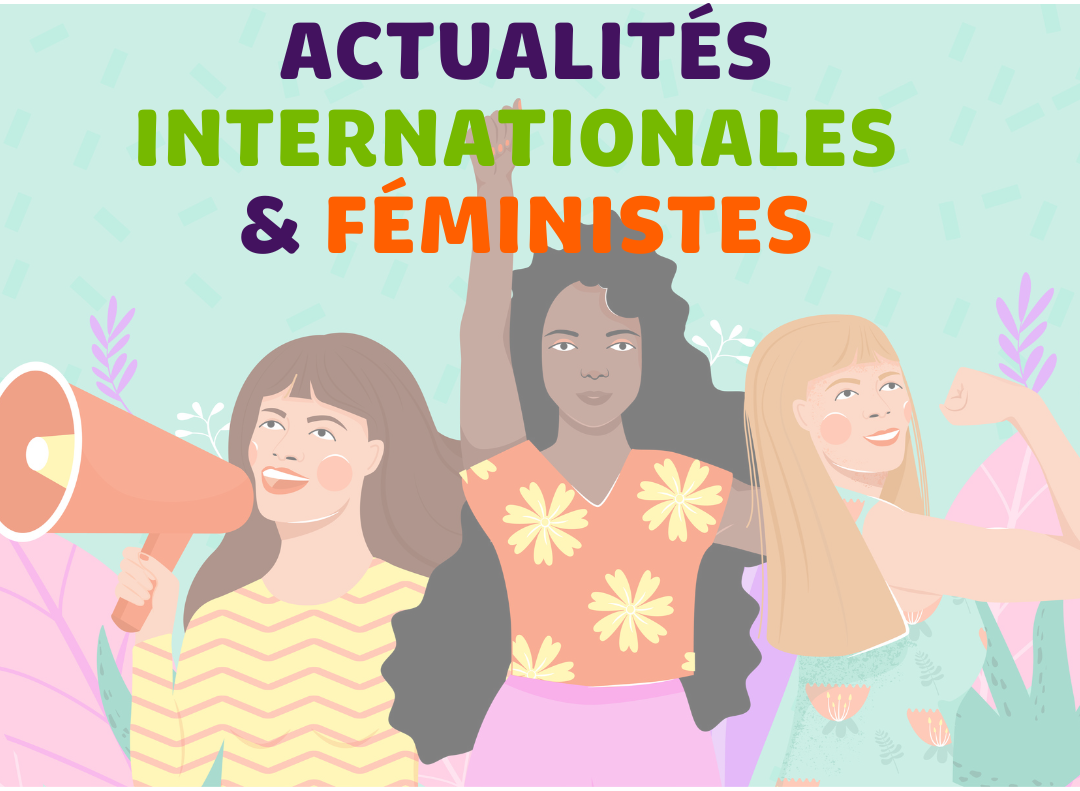
Revue de presse féministe & internationale du 29 septembre au 6 octobre
6 octobre, 2023Revue de presse féministe & internationale du 22 au 29 septembre

FRANCE
Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ?
Ce lundi 25 septembre, la Fondation des Femmes a publié son nouveau rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? », qui pointe du doigt le sous-investissement de l’Etat en matière de lutte contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles.
Cinq ans après la publication du premier rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? », la Fondation des Femmes publie une version actualisée, qui analyse les documents budgétaires publics afin d’évaluer le (sous) investissement du gouvernement français dans la protection des femmes victimes de violences. Le rapport se fonde sur un constat paradoxal : alors que les femmes dénoncent de plus en plus les violences, elles sont de moins en moins protégées par l’Etat. En effet, depuis le premier document de 2018, l’explosion du mouvement Me Too (ou Balance Ton Porc) en France a entraîné une véritable vague de libération de la parole autour des violences subies par les femmes – qu’elles soient sexistes, sexuelles ou conjugales. Elles sont de plus en plus nombreuses à témoigner et dénoncer publiquement ces comportements sexistes. Selon les enquêtes de victimation, chaque année, plus de trois millions de femmes déclarent être victimes de violences, et 200 000 plaintes sont enregistrées par les forces de l’ordre. A titre d’exemple, les plaintes concernant les violences conjugales ont augmenté de 83% ces cinq dernières années.
A première vue, l’investissement de l’Etat dans la protection et l’accompagnement des victimes semble lui aussi croissant : le budget a atteint 184,4 millions d’euros en 2023, soit une hausse de 44,9 millions depuis 2019, année du Grenelle sur les violences conjugales. Les places d’hébergement sont les plus coûteuses, représentant environ 60% des ressources allouées aux violences conjugales. Toutefois, la Fondation des Femmes révèle que cette hausse du budget n’a pas été à la hauteur de celle du nombre de victimes. En valeur absolue, l’Etat n’a dépensé que 967 euros par victime, contre 1 310 il y a quatre ans. La prise en charge des femmes dans l’ère post-MeToo n’est donc pas suffisante. La Fondation des Femmes dénonce également le budget dédié aux victimes de violences sexuelles hors couple, encore plus « dérisoire » que celui consacré aux violences conjugales. En effet, selon le rapport, l’Etat n’a dépensé que 12,7 millions d’euros en matière de protection des victimes de violences sexuelles, dont seulement 400 000 euros dédiés aux victimes de viol et d’agression sexuelle hors couple. En outre, contrairement aux violences conjugales, ces violences ne font pas l’objet d’un suivi budgétaire dans le cadre de la maquette du programme budgétaire « Egalité femmes-hommes ».
Ce sous-investissement étatique impacte directement les associations sur le terrain qui, faute de financements, ne parviennent plus à répondre aux besoins des femmes victimes de violences, toujours plus nombreuses à les solliciter. La Fondation des Femmes chiffre ces manquements et estime que l’Etat devrait dépenser, pour répondre aux besoins, entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros, contre les 184,4 millions actuels. Le rapport appelle donc le gouvernement a multiplié le budget dédié à la protection des femmes victimes de violences par au moins 14. Cette somme devrait notamment être allouée aux dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes, qui sont aujourd’hui gérés par des associations sous-financées, ainsi qu’aux places d’hébergement spécialisées. Concernant les violences sexuelles hors couple, le rapport estime que le budget devrait être multiplié par 30, soit un budget minimum de 344 millions d’euros. Cela permettrait de financer les centres d’aide d’urgence ainsi que les cellules de signalement. Enfin, face aux violences sexistes et sexuelles, la fondation demande l’augmentation du nombre d’enquêteur·ices et magistrat·es spécialisé·es, et l’amélioration de la prise en charge des psychotraumatismes.
Enfin, le rapport présente trois leviers complémentaires afin d’améliorer la politique de l’Etat en matière de violences faites aux femmes. Le premier concerne les associations, qui doivent être reconnues comme de véritables partenaires de l’action de l’Etat. Le rapport recommande également la mise en place de financements pluriannuels et la simplification des procédures de demande de subventions. Il plaide enfin pour une meilleure transparence des données budgétaires en la matière, ainsi que l’élévation du Service des droits des femmes dont le positionnement devrait être élevé au rang de délégation interministérielle, pour améliorer le pilotage de la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez le rapport complet : cliquez ici.
Le Monde, « Violences sexuelles et conjugales : un rapport de la Fondation des femmes dénonce le sous-investissement de l’Etat », 25 septembre 2023.
CHINE
Ouverture du procès critiqué d’une figure du mouvement Me Too.
L’ouverture du procès de la figure du mouvement #MeToo Sophie Huang Xueqin, vendredi 22 septembre, reflète l’hostilité du parti communiste chinois envers les activistes et les mouvements sociaux.
Deux ans après leur arrestation à Guangzhou, le 19 septembre 2021, le procès de Sophie Huang Xueqin, jugée aux côtés de son ami Wang Jianbing, défenseur des droits du travail et soutien du mouvement #MeToo se déroule actuellement, en huis clos. Les deux activistes sont accusés d’« incitation à la subversion de l’État », un chef d’inculpation souvent utilisé par les autorités chinoises contre des activistes, avocat·es ou autres intellectuel·les. Les deux accusés se voient aussi reprocher d’avoir organisé des réunions qui encourageaient « à manifester leur mécontentement à l’égard du pouvoir chinois ». En réalité, comme le dénoncent des dizaines d’organisations qui demandent l’abandon des poursuites, c’est l’action militante en faveur des droits des femmes qui est prise pour cible.
Dès l’émergence de #MeToo en Chine en 2018, Sophie Huang Xueqin s’est imposée comme une des voix du mouvement au niveau national. La journaliste a créé une plateforme en ligne pour signaler des cas de harcèlement sexuel. Elle a conduit et publié plusieurs enquêtes révélant l’ampleur de ce phénomène dans les universités et les lieux de travail. Une de ses enquêtes, qui portait sur le harcèlement d’étudiantes à l’université Beihang a conduit le Ministère chinois de l’Education à déchoir le professeur de son titre. En plus d’apporter un soutien aux victimes de harcèlement et d’agressions sexuels, Sophie Huang Xueqin s’était également engagée en témoignant publiquement du harcèlement qu’elle avait elle-même subi par un de ses collègues journalistes.
Des activistes comme Sophie Huang Xueqin ont permis au mouvement #MeToo de gagner en momentum pendant l’année 2018, et de rapidement s’imposer sur les réseaux sociaux chinois. Pour contourner la censure, les internautes utilisaient les symboles du riz et du lapin, dont la prononciation (« mi tu ») ressemble au hashtag #MeToo, qui avait été bloqué du réseau social national Weibo. En effet, malgré quelques victoires du mouvement féministe, telles que l’ajout du harcèlement sexuel comme base légitime de poursuite dans les procès civils, la censure des autorités a rapidement freiner ces progressions. En plus de contrôler les réseaux sociaux, l’Etat s’est aussi directement attaqué aux femmes qui dénonçaient les violences dont elles avaient été victimes, comme l’a montré l’affaire Peng Shuai. En 2021, la joueuse de tennis chinoise se joint au mouvement et publie un post sur Weibo, expliquant avoir été sexuellement agressée par un haut dirigeant du parti. Elle ne donne plus de nouvelles avant de réapparaître face à la pression internationale début 2022. Peng Shuai nie alors ses propres accusations d’agression sexuelle et met fin à sa carrière professionnelle.
C’est désormais à l’activiste Sophie Huang Xueqin que le pouvoir chinois s’attaque, dans un procès où elle risque une lourde peine de prison. Les conditions de sa détention sont critiquées par les organisations de défense des droits humains. Selon Chinese Human Rights Defenders, Sophie Huang Xueqin et Wang Jianbing n’ont pas pu voir leurs familles depuis leur arrestation en 2021. Plusieurs de leur·es ami·es ont dû signer des témoignages contre eux sous la pression des autorités. Les organisations interpellent également sur les mauvaises conditions de détention de Sophie Huang Xueqin, dont l’état de santé se détériore.
New York Times,« A Chinese Journalist Gave #MeToo Victims a Voice. Now She’s on Trial. », 22 septembre 2023.
Amnesty International, « Chine. La militante de #MeToo et le défenseur des droits du travail jugés sur la base d’accusations « sans fondement » doivent être libérés », 21 septembre 2023.
FRANCE
Un nouveau rapport sur la « pornocriminalité ».
Mercredi 27 septembre, le Haut Conseil à l’Egalité a publié un rapport édifiant sur l’industrie pornographique. L’institution dénonce l’inaction de l’Etat face à la « pornocriminalité » et insiste sur son caractère incompatible avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Le rapport, intitulé « Pornocriminalité. Mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique », sort un an après celui du Sénat « Porno : l’enfer du décor ». Il se base sur l’étude des quatre principales plateformes pornographiques, dont Pornhub, pendant un an et demi. Son premier constat est celui de l’illégalité des vidéos : selon cette étude, « 90% des contenus pornographiques contiennent de la violence physique ou verbale, et sont donc pénalement répréhensibles ». Les femmes sont en très grand nombre victimes de violences physiques et sexuelles dans cette industrie. Le Haut Conseil à l’Egalité évoque d’ailleurs la « culture du viol » ou encore la « déshumanisation des femmes ». Si le sexisme est omniprésent dans l’industrie pornographique, le racisme et la LGBTphobie le sont aussi, puisque « la pornographie est à l’intersection de toutes les haines et s’inscrit dans le continuum des violences ». A titre d’exemple, l’étude du HCE a dénombré 1,5 million de vidéos sur les plateformes pornographiques dans des catégories racistes.
Les procédures judiciaires actuellement en cours témoignent de cette violence. Dans l’affaire de Jacquie et Michel, le fondateur de la marque est mis en examen pour complicité de viol et traite d’ êtres humains, tandis que dans l’affaire du French Bukkake, 17 hommes ont été renvoyés devant la justice pour viols, viols en réunion, ou proxénétisme aggravé. Le processus de production de contenus pornographiques est donc étroitement lié à un système complexe d’exploitation sexuelle et de proxénétisme. Cependant, les procès liés à cette industrie restent exceptionnels. En effet, selon le rapport du HCE, le lobby de l’industrie pornographique, Free Speech Coalition, dissimule la violence et l’incitation à la discrimination sous couvert de liberté d’expression. Pourtant, comme le souligne le HCE, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence sont des limites à cette liberté.
Le rapport dénonce d’autres comportements illégaux des plateformes pornographiques, à l’instar de la pédopornographie. L’étude menée par le HCE a recensé environ 1,3 million de vidéos pédopornographiques. La pédocriminalité et la (pédo)pornographie sont étroitement liées : « la pédocriminalité est ainsi facilitée par la (pédo)pornographie, et inversement, la consommation de pédopornographie facilite le passage à l’acte pédocriminel ». Le rapport dénonce la banalisation, voire l’érotisation de l’inceste et de la pédocriminalité, alors que, selon la CIIVISE, 160 000 enfants en sont victimes chaque année en France.
Face à cette « pornocriminalité », le HCE interpelle les pouvoirs publics sur leur inaction, lourde de conséquences. Par exemple, concernant l’exposition des mineur·es à la pornographie, aucune loi n’est appliquée. Ni la loi de 1994 interdisant l’exposition des mineur·es à la pornographie, ni la loi du 30 juillet 2020 obligeant les sites pornographiques à contrôler l’âge des consommateur·ices ne sont respectées. Le résultat est sans appel : alors que 19% des mineur·es étaient exposé·es à la pornographie en 2017, le chiffre est de 28% en 2022. Le HCE met en garde sur le déni des institutions publiques, voire leur complaisance, totalement incompatible avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Selon le rapport, la consommation de contenu pornographique à un jeune âge renforce la culture du vio et augmente la violence sexuelle. Le rapport interpelle également l’Etat sur les défaillances de la plateforme de signalement Pharos. Lors de son étude, le HCE a signalé une trentaine de vidéos pornographiques au contenu illégal. Aucune réponse n’a été donnée, et les vidéos sont toujours en ligne.
Le HCE établit une liste de recommandations, comme le Sénat l’avait fait dans son rapport de 2022. En s’alignant sur la résolution appelant à « faire de la lutte contre les violences pornographiques une priorité de politique publique », adoptée au Sénat le 1er mars 2023, le rapport du HCE réitère l’urgence de la lutte contre le pornocriminalité et la poursuite des plateformes au contenu illégal. Il préconise aussi la création d’une nouvelle infraction générique d’exploitation sexuelle, afin de réaffirmer l’interdiction de la marchandisation de la sexualité d’autrui. Concernant la pédopornographie, le HCE s’aligne avec la recommandation de la sénatrice Laurence Rossignol et demande une redéfinition de la pédopornographie qui ne prête à aucune différence d’interprétation. Pour le droit à l’oubli, le rapport recommande « le retrait simple et effectif de contenus à caractère sexuel à toute personne filmée qui le sollicite, sans autre condition que de prouver qu’il s’agit d’elle ». Enfin, le HCE demande à l’Etat de soutenir, au Conseil de l’Union européenne, la criminalisation du partage illicite de contenu sexuel dans la directive européenne contre les violences faites aux femmes.
Après la sortie du rapport, Bérangère Couillard, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a d’ores et déjà annoncé la création d’un groupe de travail, qu’elle présidera, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur, la Justice, le Travail, la Culture et le Numérique. Il se pourrait également que le document influence les débats sur la loi de sécurisation de l’espace numérique, qui sera examinée dans les prochains jours à l’Assemblée nationale.
Retrouvez le rapport complet : cliquez ici.
Public Sénat, « Pornocriminalité : un an après le rapport du Sénat, le Haut Conseil à l’Egalité dénonce « l’inaction » des pouvoirs publics », 27 septembre 2023.
Haut Conseil à l’Egalité, « Synthèse du rapport », 27 septembre 2023.
INDE
Une nouvelle loi oeuvrant pour une meilleure parité au Parlement.
Les député·es indien·nes ont adopté un texte visant à améliorer la représentation des femmes au Parlement, qui sont aujourd’hui encore sous-représentées dans la sphère politique.
Le 20 septembre, en Inde, un nouveau projet de loi souhaite faire progresser la parité de la chambre basse du Parlement en réservant 33% des sièges aux femmes. Validée à l’unanimité par la chambre haute jeudi dernier, cette mesure semble marquer un tournant dans ce pays encore fortement patriarcal. En effet, les femmes sont toujours soumises à la tutelle d’une personne juridiquement responsable et n’ont obtenu le droit de vote sans restriction légale qu’en 1990. Aujourd’hui, les femmes ne remplissent que 15% des sièges de l’Assemblée nationale, 10% de ceux des assemblées régionales et seulement un des vingt-huit Etats fédérés est dirigé par une femme.
Ce projet de loi n’est pas une volonté récente des législateurs et avait déjà été présenté en 1996 puis à quatre autres reprises, sans succès. Pourtant, encore une fois, cette « victoire » cache un inconvénient de taille : la loi ne sera concrètement applicable qu’en 2029. En effet, l’une des conditions à son entrée en vigueur est d’attendre le nouveau découpage des circonscriptions locales. L’opposition relève une « injustice faite aux femmes » puisque, selon Sonia Gandhi, ancienne présidente du Parti du Congrès de l’Inde pour le Monde, la « mise en œuvre de la mesure est non seulement nécessaire mais possible ». Comme en informe le journal The Hindu, la parité au Parlement n’a effectivement pas de lien de causalité avec les limites territoriales des circonscriptions.
Le gouvernement l’aborde toutefois comme un vote historique. Le Premier Ministre Narendra Modi, œuvrant pour une meilleure inclusivité, s’est exprimé sur X (anciennement Twitter) à ce sujet qu’il décrit comme « un moment déterminant dans le parcours démocratique de notre nation ». En effet, les femmes sont encore largement sous-représentées sur le marché du travail (23% selon le Monde), faisant face à des discriminations quant à l’accès à l’éducation, à la santé et à la nutrition. Mais sous cette prise de position progressiste, se cache peut-être la volonté d’atteindre un plus grand nombre d’électeur·ices lors des très prochaines élections de 2024. Selon Sagarika Ghose, analyste pour le quotidien Times of India, cette loi serait « un attrapeur de voix », la politique restant « hostile aux femmes ».
Le Monde, « L’Inde propose des quotas pour les femmes au Parlement mais… pas avant 2029 », 21 septembre 2023.
Courrier International, « L’Inde vote une loi pour garantir un quota de 33 % de femmes à l’Assemblée nationale », 22 septembre 2023.
En accusant l’ancien dictateur de Gambie de viol, la militante contre les violences faites aux femmes a ouvert le dialogue sur ce sujet dans son pays. Elle raconte dans un livre son combat.
En 2015, Toufah Jallow, 19 ans, gagne un concours national organisé par le dictateur de l’époque, Yahya Jammeh, qui vise à encourager l’autonomie des jeunes femmes. On lui promet alors de financer ses études à l’étranger. Mais après avoir rencontré Yahya Jammeh, la jeune fille se retrouve prise au piège face aux avances du dirigeant, qui finit par la violer. Toufah Jallow s’enfuit alors au Sénégal.
En 2017, après la destitution de Yahya Jammeh, Toufah Jallow est la première femme à dénoncer publiquement l’agression qu’elle a subi deux ans plus tôt. En plein mouvement #MeToo, les internautes se mobilisent autour du hashtag #IamToufah et témoignent des violences sexuelles en Gambie et en Afrique de l’Ouest. Avec le soutien de l’organisation Human Rights Watch (HRW), la jeune femme tente de faire traduire en justice son agresseur, et de porter la voix de toutes les victimes de violences sexuelles du pays.
En 2019, elle témoigne de son viol devant la Commission vérité, réconciliation et réparation, qui enquête notamment sur les crimes sexuels commis par l’ancien dictateur pendant ses années au pouvoir.
Toufah Jallow offre un puissant témoignage dans son livre, intitulé « Toufah : La femme qui inspira un #MeToo africain », coécrit avec Kim Pittaway. Il a été traduit en français et vient de sortir en librairie.
Documentaire – Un silence si bruyant
Réalisé par l’actrice Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova, le documentaire dénonce l’inceste, en donnant la parole à plusieurs victimes.
Un silence si bruyant a été diffusé ce dimanche 24 septembre, rassemblant 1,15 millions de téléspectateurs. Le titre, évocateur, renvoie au silence auquel sont confrontées les victimes : d’abord le silence du cercle familial, puis celui du cercle sociétal. Ce silence autour de l’inceste est d’ailleurs illustré dans le documentaire par des images d’enfants qui n’ont pas de bouche.
Les réalisatrices donnent donc la parole à quatre victimes d’incestes, ainsi qu’à Emmanuelle Béart elle-même, dans le but de mettre un terme à ce silence assourdissant et, petit à petit, libérer la parole autour de ce problème sociétal. Le documentaire suit l’histoire de l’actrice, qui témoigne pour la première fois de sa carrière avoir été victime d’inceste pendant son adolescence.
A travers ce documentaire découpé en deux parties, Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova traitent de l’enfance brisée des enfants victimes d’inceste, de la nécessité de libération de la parole, ainsi que de la recherche de réparation des victimes.
Ce projet est diffusé en même temps que le nouveau rapport de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), publié le 21 septembre, selon lequel 160 000 enfants sont victimes d’inceste chaque année. Emmanuelle Béart s’est d’ailleurs engagée à ce sujet et a signé la tribune du 7 septembre demandant le renouvellement de la CIIVISE, dont le travail est si important aujourd’hui, comme en témoigne Un silence si bruyant.
Retrouvez le documentaire en replay : cliquez ici.