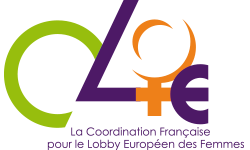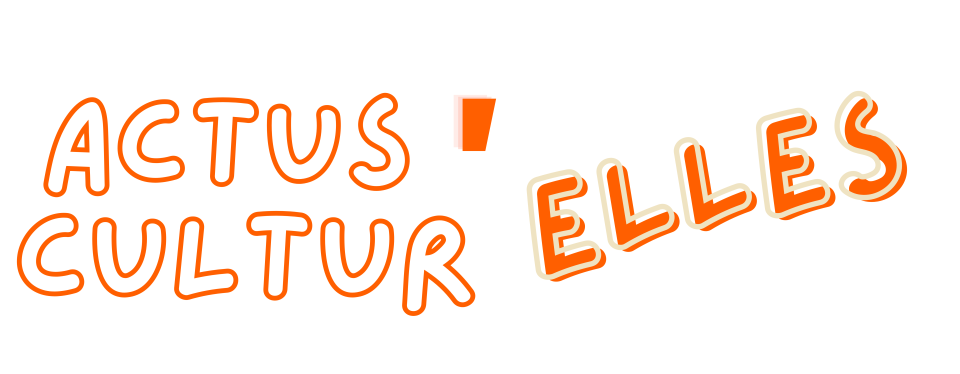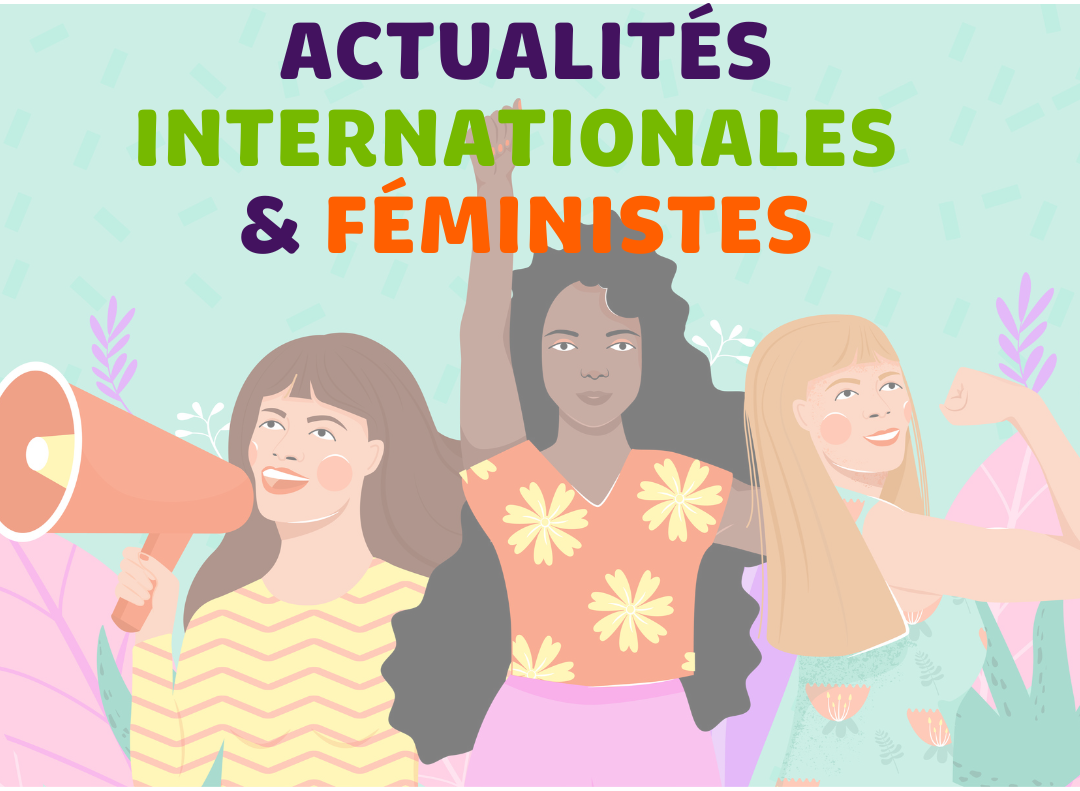
Revue de presse féministe & internationale du 22 au 29 septembre
29 septembre, 2023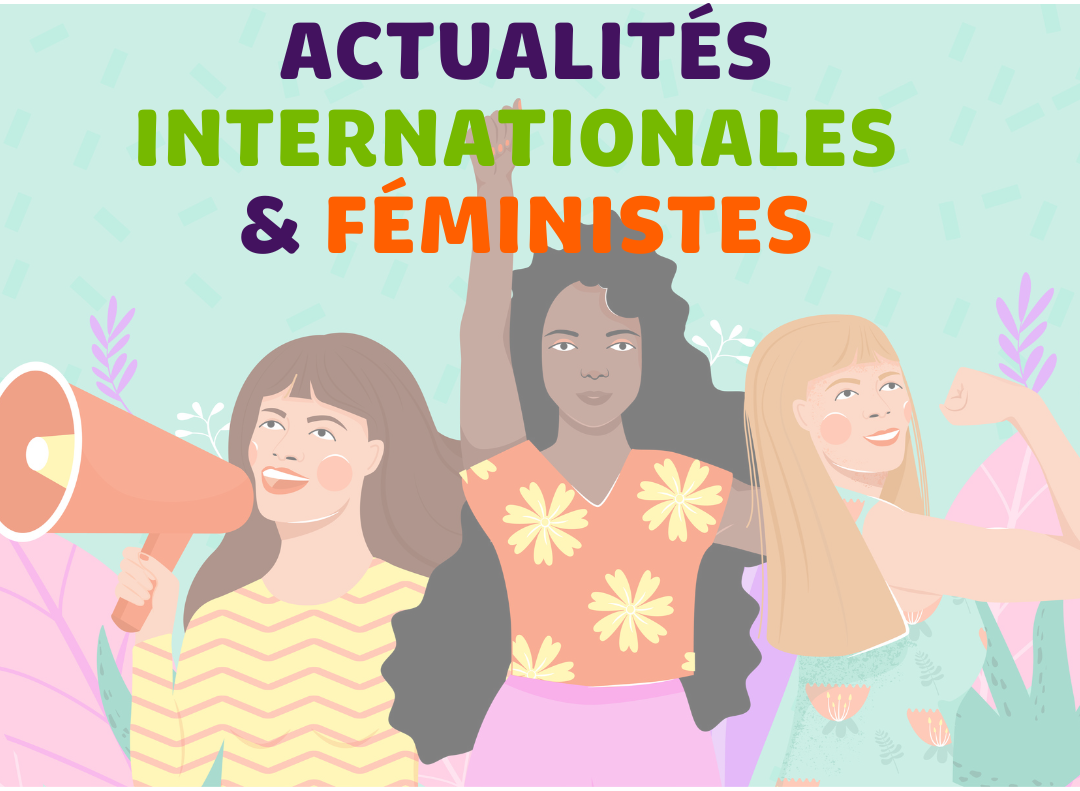
Revue de presse féministe & internationale du 6 au 13 octobre
13 octobre, 2023Revue de presse féministe & internationale du 29 septembre au 6 octobre

UNION EUROPÉENNE
Entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul.
Le 1er octobre 2023, neuf ans après sa mise en vigueur et sept ans après la première tentative d’adhésion, la Convention d’Istanbul, qui lutte contre les violences faites aux femmes la violence domestique, est officiellement entrée en vigueur dans toute l’Union européenne.
Alors qu’une femme sur trois dans l’Union a subi des violences physiques et/ou sexuelles depuis l’âge de 15 ans, la Convention d’Istanbul pose, depuis son entrée en vigueur en 2014, un cadre juridique global quant aux violences faites aux femmes en Europe. C’est en effet dans l’optique d’harmoniser les lois nationales déjà en vigueur dans certains pays de l’UE que le Conseil de l’Europe adopte en 2011 la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, aussi appelée convention d’Istanbul. Elle vise à protéger les femmes en essayant d’éliminer la violence domestique et à l’égard des femmes, qui constitue une violation des droits humains à savoir une atteinte à la dignité humaine, à l’égalité des sexes et au respect de soi. Elle permet donc d’agir sur quatre plans capitaux dans la lutte face aux violences faites aux femmes : la prévention, la protection, la poursuite en justice et la coordination de politiques globales dans ce domaine.
A ce titre, vingt-et-un pays de l’UE dont l’Italie – qui a fait partie des dix premiers signataires – ou la France, l’avaient déjà ratifiée mais il était impossible pour l’UE de signer la convention en tant que groupe avant 2021. En effet, le vote à la majorité qualifiée n’était pas encore de mise, ce qui signifie que si tous les pays membres n’étaient pas favorables à une signature, celle-ci ne pouvait pas avoir lieu. C’est donc grâce à cette nouvelle modalité du vote au conseil de l’Union européenne, que le 1er juin 2023, l’UE a pu adhérer à la convention d’Istanbul malgré quelques réfractaires tels que la Hongrie et la République Tchèque. En outre, la Pologne a annoncé son intention de se retirer de la convention, comme l’a fait la Turquie en 2021.
Concrètement, cette adhésion signifie que tous les pays membres sont obligés de signer la convention sans pour autant devoir la ratifier. Autrement dit, les six pays qui ne souhaitent pas être tenus de respecter ses lignes directives n’y sont pas obligés. Malheureusement, malgré une forte pression de la part de l’Union européenne, ces pays réfractaires ne semblent pas près de changer de ligne de pensée, considérant cette convention comme allant à l’encontre de leur fonctionnement politique et poussant à l’immigration. Ces pays doivent dans tous les cas, depuis le 1er octobre 2023, respecter les lignes directrices de la convention d’Istanbul et donc adopter une législation réprimant la violence à l’égard des femmes dans tous les domaines de compétence de l’UE. Les pays sont par exemple désormais obligés de collecter des données sur les violences faites aux femmes et prendre en compte leur statut spécifique lorsqu’elle est soumise à une procédure d’expulsion du territoire.
D’un point de vue plus symbolique, La présidente Ursula von der Leyen souligne par cette adhésion que « l’Europe se tient aux côtés des femmes, afin de les protéger contre la violence. Les femmes et les filles méritent toutes une vie sans violence : l’heure de la justice et de l’égalité est venue. [Ainsi], l’Union européenne envoie un signal fort : nous sommes déterminés à prévenir, condamner et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles sous toutes ses formes. ». Cette réflexion se place dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025.
Parlement européen, « La Convention d’Istanbul, un outil pour lutter contre les violences à l’encontre des femmes et des filles », novembre 2020.
Toute l’Europe, « Violences faites aux femmes : la ratification de la convention d’Istanbul dans l’Union européenne », 2 octobre 2023.
Vie Publique, « Violences faites aux femmes : adhésion de l’Union européenne à la Convention d’Istanbul », 9 juin 2023.
GROENLAND
Des femmes victimes de la Spiralkampagnen, campagne de contraception forcée, demandent justice.
Lundi 2 octobre, une soixantaine de femmes groenlandaises ont demandé une indemnisation au gouvernement du Danemark suite à la campagne de contraception forcée menée dans les années 1960 sur l’île, alors sous tutelle danoise.
Les 67 femmes et leur avocat, Mads Pramming, ont déposé une demande officielle d’indemnisation auprès du Danemark. Elles réclament 300 000 couronnes danoises (environ 40 200 euros) chacune, en compensation des violations de leurs droits qu’elles ont subi il y a plusieurs dizaines d’années, lors de la « campagne du stérilet ». Mads Pramming a précisé que si l’Etat ne répondait pas à leur demande, comme il l’attendait, les victimes porteraient l’affaire devant les tribunaux pour poursuivre le gouvernement.
Si elles ne sont aujourd’hui que soixante-sept à demander une indemnisation, le nombre de victimes total de cette campagne s’élève à plusieurs milliers. Les archives nationales ont montré que, entre 1966 et 1970, 4 500 femmes ont été concernées, certaines n’ayant que 12 ans au moment des faits. En effet, en 1973, le Parlement du Danemark a modifié la législation de sorte que les médecins n’étaient plus obligés d’impliquer les parents des jeunes filles de moins de 18 ans lorsqu’ils leurs donnaient des conseils en matière de contraception. En 1969, la campagne de contraception forcée touchait 35% des femmes de l’île en âge de procréer. Les victimes se sont vues poser un stérilet, en général de la marque Lippes Loop, sans qu’elles en soient informées ou qu’elles y consentent. Récemment encore, des gynécologues de l’île ont continué à retrouver des stérilets chez des femmes qui ignoraient leur présence. Dans le cas des plus jeunes victimes, les dispositifs étaient souvent trop gros pour leur corps d’adolescentes, entraînant des problèmes de santé allant jusqu’à la stérilité. Le mauvais état des soins et du suivi postopératoires ont également causé des douleurs, infections et hémorragies à de nombreuses femmes. Certaines d’entre elles ont dû subir une ablation de l’utérus ou sont devenues stériles suite à ces complications.
Les effets de la Spiralkampagnen (« campagne du stérilet ») ont été conséquents. Selon l’organisme de statistiques Statistics Greenland, le nombre de naissances a été réduit de 50% au début des années 1970, entraînant une chute drastique du taux de natalité alors que le Groenland avait le taux de croissance le plus élevé au monde à cette période. En effet, en 1953, l’île passe du statut de colonie à celui de territoire d’outre mer du Danemark. Le gouvernement danois lance alors un grand processus de modernisation du Groenland. Le taux de mortalité chute tandis que le taux de natalité augmente, à tel point que dans les années 1960, la moitié de la population a moins de 16 ans. Cependant, selon l’économiste danois Mogens Boserup, cette croissance de la population « n’indiquait pas que la politique économique devrait impliquer dans l’avenir une propagande en faveur du contrôle des naissances ». Certaines hypothèses expliquent que le nombre de jeunes mères posaient un problème dans le processus de modernisation, puisqu’elles n’allaient pas à l’école. D’autres pensent que le gouvernement danois souhaitaient éviter que cette modernisation ne devienne trop coûteuse en raison de l’explosion démographique. Quoiqu’il en soit, cette campagne visant à diminuer la croissance de la population est considérée aujourd’hui comme une grave violation des droits humains, voire un génocide, par les élu·es groenlandais·es.
L’affaire devient publique en 2017, lorsque Naja Lyberth, aujourd’hui à la tête du groupe de femmes demandant une indemnisation, dénonce publiquement l’État danois et sa « stérilisation concertée ». Elle témoigne qu’un stérilet lui a été posé sans son consentement pendant un examen médical à l’école il y a plusieurs dizaines d’années. Ce n’est que cinq ans plus tard, en 2022, que l’ampleur de la campagne est révélée par le podcast d’investigation des journalistes Celine Klint et Anne Pilegaard Petersen de la Danish Broadcasting Corporation (DR). Suite à ce scandale, les gouvernements danois et groenlandais ont ouvert une enquête officielle début 2023, dont les conclusions devraient être rendues en 2025. Elle vise à enquêter sur les pratiques de contraceptions imposées aux femmes de l’île entre 1960 et 1991, date à laquelle le Naalakkersuisut (gouvernement du Groenland) a repris le contrôle du secteur de la santé. Mais Naja Lyberth explique que les femmes victimes ne veulent pas attendre les résultats de l’enquête et souhaitent recevoir une indemnisation le plus tôt possible, étant donné que certaines d’entre elles ont déjà plus de 80 ans.
Slate,« Des Groenlandaises affirment qu’on leur a posé un stérilet à leur insu quand elles étaient adolescentes », 3 octobre 2023.
The Guardian, « Greenland women seek compensation over involuntary birth control », 4 octobre 2023.
Arctic Today, « Greenland women seek a reckoning for a 1960s Danish campaign to reduce births », 29 mars 2023.
ARGENTINE
Retour des mobilisations féministes face à la montée du candidat Javier Milei à la présidentielle.
En tête de liste des prochaines élections présidentielles, le candidat ultra-libéral d’extrême droite, Javier Milei, opposé à l’IVG, ne semble pas faire l’unanimité chez les féministes.
Après qu’il se soit ouvertement prononcé contre l’avortement, de nombreuses femmes sont descendues dans la rue manifester leur mécontentement. Le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) n’a été voté que le 30 décembre 2020 et légalisé le mois suivant. Encore très récent, le sujet a été porté à l’agenda politique et rendu possible grâce aux puissantes mobilisations féministes qui brandissaient le pañuelo verde (foulard vert), symbole de la Campagne Nationale pour le Droit à l’Avortement Légal, Sûr et Gratuit.
Malgré l’acquisition des droits sexuels et reproductifs, d’une éducation sexuelle à l’école et d’un nouveau ministère chargé de la question, cette même couleur et enseigne n’a pas disparu des rues de la capitale. En effet, le combat ne semble pas être terminé maintenant que l’extrême droite se montre particulièrement appréciée par une majorité électorale de tout âge. Comme rapporté par le quotidien Libération, les plus jeunes ne sont pas tous progressistes, certains considèrant l’avortement comme “la pire perversion” voir “le génocide institutionnalisé à niveau industriel”. Ces propos, relayés sur les réseaux sociaux par des influenceurs masculinistes, ne font que renforcer l’électorat de Javier Milei et sa volonté de restreindre l’accès à l’IVG qu’il caractérise pénalement “d’assassinat aggravé par ascendant”. S’il venait à être élu, ce dernier souhaiterait alors recourir à un référendum afin de contourner le vote du Congrès, toujours favorable à la légalisation de l’avortement.
Même si la mobilisation féministe a posteriori de la victoire du candidat aux primaires en août dernier ne prend pas encore la forme d’une “marée verte”, comme cela a pu être le cas en 2019, certaines ont fait entendre leur voix lors de la journée internationale pour le droit à l’avortement. Allant du siège de la présidence jusqu’au Congrès, cette manifestation à Buenos Aires jeudi 28 septembre a eu lieu à moins d’un mois du second tour des présidentielles prévues le 22 octobre. Parmi les militantes, Alicia Schetjet, fondatrice de la Commission pour le droit à l’avortement, qui après presque 40 années de lutte, fait l’éternel et accablant constat qu’il n’y a jamais de droits acquis.
TV5 Monde, « Argentine: les femmes dans la rue, le candidat anti-avortement Milei dans le viseur« , 28 septembre 2023.
Le Point, « Argentine: les femmes dans la rue, le candidat anti-avortement Milei dans le viseur », 29 septembre 2023.
IRAN
Nouvelle agression d’une jeune fille par la police des mœurs.
Le 1er octobre, Armita Garavand, jeune étudiante iranienne qui ne portait pas le voile, a été hospitalisée après avoir été agressée par la police des mœurs. Un an après la mort de Mahsa Amini, cet événement pourrait raviver la contestation populaire.
L’organisation Hengaw, qui défend les droits de la communauté kurde en Iran, a révélé mardi 3 octobre qu’Armita Garavand, jeune fille de 16 ans, avait été « battue » lors d’une « agression » d’agentes de la police des mœurs. La scène s’est passée dans le métro de Téhéran, la capitale iranienne, et les images des vidéos de surveillance ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. On y voit l’adolescente rentrer puis être évacuée de la rame de métro par la police, après avoir perdu connaissance. Un an après la mort de Mahsa Amini dans des circonstances similaires, Armita Garavand est elle aussi dans le coma, dans l’unité des soins intensifs de l’hôpital militaire Fajr. Sa chambre a été placée sous haute surveillance et les forces de sécurité interdisent l’accès à sa famille.
Malgré les dénonciations des organisations de défense des droits humains d’Iran, le gouvernement continue à nier sa responsabilité dans l’agression d’Armita Garavand, comme cela avait été le cas pour Mahsa Amini. Les autorités avaient expliqué qu’elle souffrait de « troubles neurologiques ». Selon la version rapportée par les médias d’État, Armita Garavand a chuté dans la rame de métro suite à une baisse de tension, et sa tête a heurté un côté du wagon. Cette version a été confirmée par la famille de la victime dans un premier temps. Dans un entretien vidéo, qui aurait été réalisé sous la contrainte selon plusieurs organisations, la mère de la jeune fille a déclaré à l’IRNA, l’agence de presse nationale, « Je pense que la pression artérielle de ma fille a chuté, je n’en suis pas très sûre, je pense qu’ils ont dit que sa tension avait chuté ». Elle a finalement été arrêtée jeudi 5 octobre. Un syndicat de professeur·es a également publié un communiqué, expliquant que le directeur de sécurité du Ministère de l’Education s’était rendu dans le lycée d’Armita Garavand et avait menacé le personnel éducatif et les élèves pour obtenir leur silence.
L’agression d’Armita Garavand intervient dans un contexte de renforcement de la répression d’Etat, un an après la mort de Mahsa Amini, pour contenir le mouvement de révolte populaire et empêcher de nouveaux soulèvements massifs. La répression des autorités avait déjà été féroce lors des manifestations, tuant plus de 500 personnes au total. Cela n’a pas empêché les femmes iraniennes à continuer de défier l’Etat, notamment par des actes de désobéissance civile. Elles sont toujours aussi nombreuses à sortir sans voile dans les rues. Le gouvernement a donc renforcé son appareil répressif. En juillet dernier, la police des mœurs a réinvesti les rues iraniennes après avoir disparu quelques mois. Le 20 septembre, le Parlement a adopté la très sévère « loi sur le hijab et la chasteté », qui prévoit des peines allant jusqu’à 10 ans de prison pour non-port du voile. Après le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, le mouvement Femme, Vie, Liberté est donc toujours bien vivant.
France Culture, « Iran : une jeune fille est dans le coma, l’histoire se répète-t-elle avec la police des mœurs ? », 4 octobre 2023.
La Croix, « Iran : Téhéran accusé de vouloir étouffer une autre affaire Mahsa Amini », 4 octobre 2023.
La chercheuse hongroise est devenue ce lundi la treizième femme lauréate du Prix Nobel de médecine.
Ce lundi 2 octobre a été décerné le prix Nobel de médecine à la chercheuse et professeure Katalin Karikó et à son partenaire de recherche Drew Weissman pour leur découverte du vaccin à ARN messager contre le COVID 19. Ces deux chercheurs se sont rencontrés il y a près de 30 ans, alors que Drew, comme nombre de ses contemporains, travaillait sur l’ADN, tandis que Katalin était déjà persuadée que les recherches sur l’ARN messager pouvaient faire évoluer la médecine.
Née en Hongrie, elle a toujours été passionnée par la biologie. A 14 ans elle termine troisième d’un concours national de biologie à Budapest puis décide de devenir scientifique à l’âge de 16 ans. Elle reste en Hongrie jusqu’à la fin de son doctorat avant de partir pour les Etats-Unis en 1985 avec son mari, sa fille de deux ans (qui deviendra plus tard double championne olympique d’aviron en huit) et 800 livres sterling cousus à l’intérieur de sa peluche. Cette traversée du mur de fer est risquée mais nécessaire puisque personne n’accepte de financer ses recherches sur l’ARN messager en Hongrie.
Malheureusement, les laboratoires de recherche des Etats-Unis ne sont pas plus friands de cette thématique. Elle trouve un poste à l’université de Pennsylvanie mais est contrainte à beaucoup changer de lieu de travail. En effet, même au sein de ce laboratoire, un autre type de discrimination se joue : elle doit faire face au comportement misogyne de l’époque. Certains hommes lui demandent le nom de son superviseur alors qu’elle dirige son propre laboratoire de recherche et préfèrent mettre en lumière son statut de femme mariée en l’appelant « madame » au détriment de « professeur » employé pour ses collègues masculins.
Elle dit d’ailleurs « j’étais l’archétype de la scientifique qui lutte. Et qui chute ».
Finalement, après avoir failli abandonner ses recherches et la recherche, ses efforts finissent par payer. Aux côtés de Drew Weissman, elle reçoit quelques titres avant le prix Nobel, tels que le titre Breakthrough, Princesse des Asturies ou encore le Lasker. Mais le prix Nobel de médecine a une signification particulière : elle est la treizième femme lauréate et la preuve vivante qu’il ne faut pas abandonner, toujours rebondir.
She said : Le film sur l’enquête à l’origine du mouvement #MeToo, du tabou à l’écrou.
Le 5 octobre 2017, le New York times sort une tribune accusant Harvey Weinstein, un des plus grands réalisateurs américains de harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol sur une douzaine de femmes. Cette tribune fait réagir, est relayée, le procès Weinstein est mis en place et les actrices comme Alyssa Milano reprennent, sur les réseaux sociaux, le mouvement #MeToo créé en 2007 par Tarana Burk. She said retrace l’enquête derrière cette tribune.
Dans ce film, nous suivons Jodi Kantor et Megan Twohey durant leur enquête sur les agressions perpétrées par le réalisateur. She said nous plonge alors dans la recherche incessante et fastidieuse de documents écrits, de témoignages, de preuves suffisantes pour dénoncer le géant du cinéma. Avec des rebondissements, des larmes, des joies et des défaites, le film offre au spectateur un voyage à bord d’un grand-huit émotionnel dont il connaît pourtant le point final : l’arrestation et la condamnation d’Harvey Weinstein à 23 ans de prison.
En effet, bien que beaucoup de gens connaissent la suite de l’histoire : une déferlante de posts sur les réseaux sociaux et un mouvement permettant aux femmes victimes de ne plus se sentir seules, d’oser s’exprimer, l’enquête des deux journalistes n’a pas été simple. On découvre notamment que les victimes étaient obligées de garder le silence que ce soit par la menace ou grâce à une grosse somme d’argent versée par l’équipe de Weinstein pour les faire taire. Ainsi, le film nous montre des portes fermées, des personnes souhaitant rester anonymes et des personnes effrayées. En outre, journalisme oblige, le film dépeint des débats entre l’équipe éditoriale et les avocats du réalisateur quant aux informations qui allaient sortir, car sur un tel sujet, les équipes juridiques de l’accusé ont leur mot à dire. Ils peuvent également répondre aux accusations afin d’essayer de décrédibiliser le journal qui les a fait paraître. C’est donc une course contre la montre qui s’enclenche une fois l’enquête démarrée.
Ainsi, bien que nous n’ayons pas de suspens quant à sa fin, ce film énerve autant qu’il rend fière grâce à l’acharnement de ces deux femmes qui voulaient en sauver des dizaines d’autres. On peut retrouver dans le film des actrices mondialement connues comme Rose McGowan, qui a notamment joué dans Charmed, et qui a sorti un livre intitulé Brave dans lequel elle raconte le viol qu’elle a subi sans pour autant nommer son agresseur : « le monstre ».
On sait aujourd’hui que les victimes du « monstre » ne sont pas uniquement au nombre de douze comme l’écrit le New-York Times mais 93 dont 14 témoignent avoir été violées. Parmi elles on retrouve notamment Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow (première à avoir annoncé avoir été victime de Weinstein et interrogée dans le cadre de l’enquête de Kantor et Twohey) Cara Delevingne et bien d’autres encore.
A présent, le combat contre les réalisateurs accusés d’agressions sexuelles et viol se poursuit, le monde du cinéma ne semblant pas à même de perdre ses grands réalisateurs.
Le film est disponible à la location sur plusieurs plateformes de streaming.