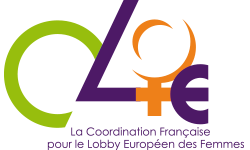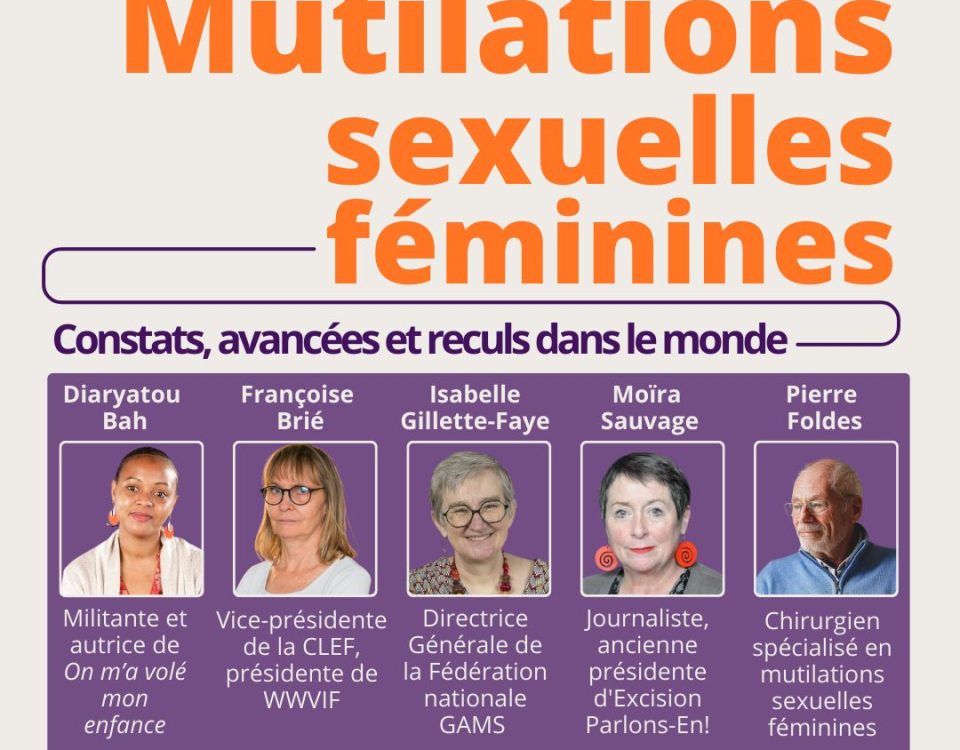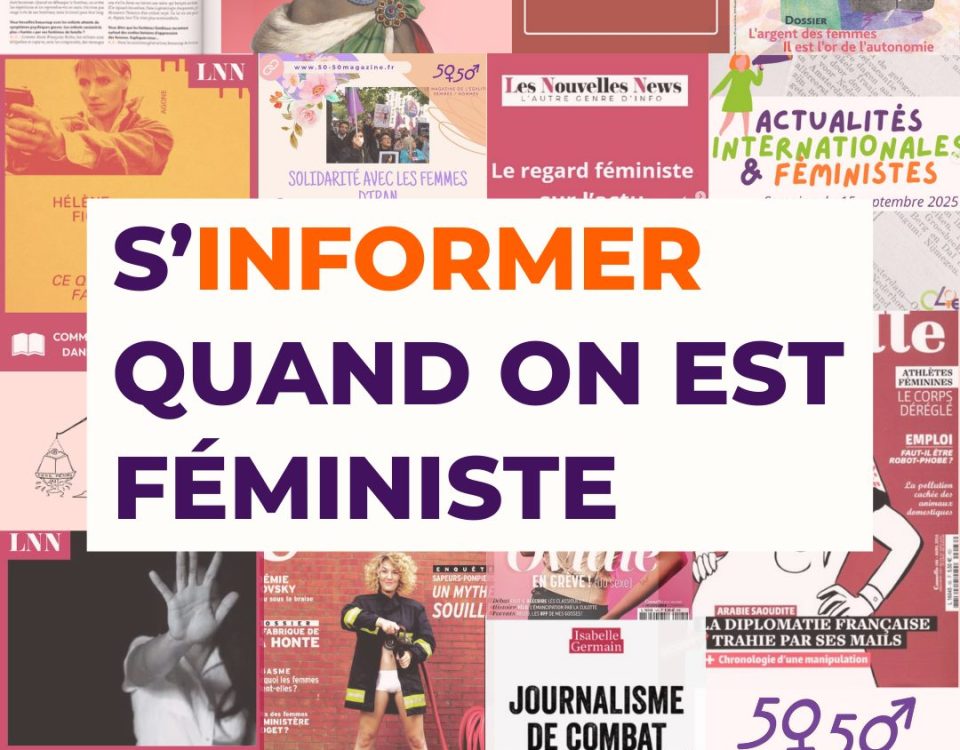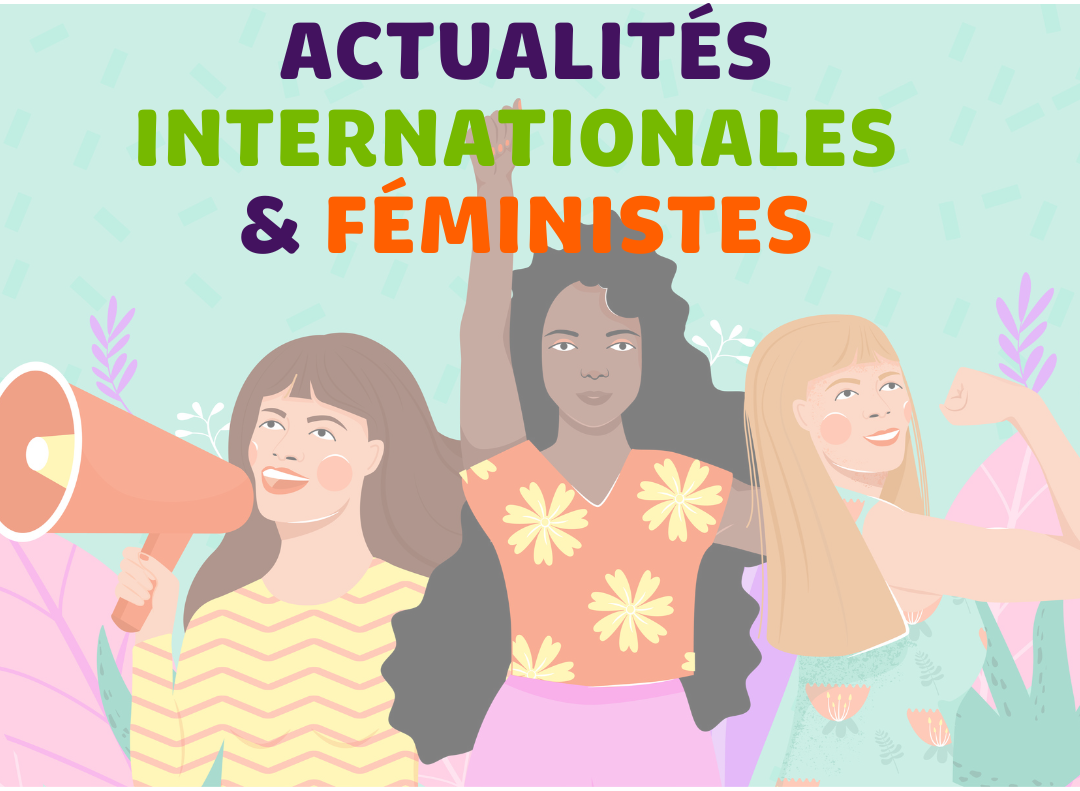
Revue de presse féministe & internationale du 07 au 11 juillet 2025
11 juillet, 2025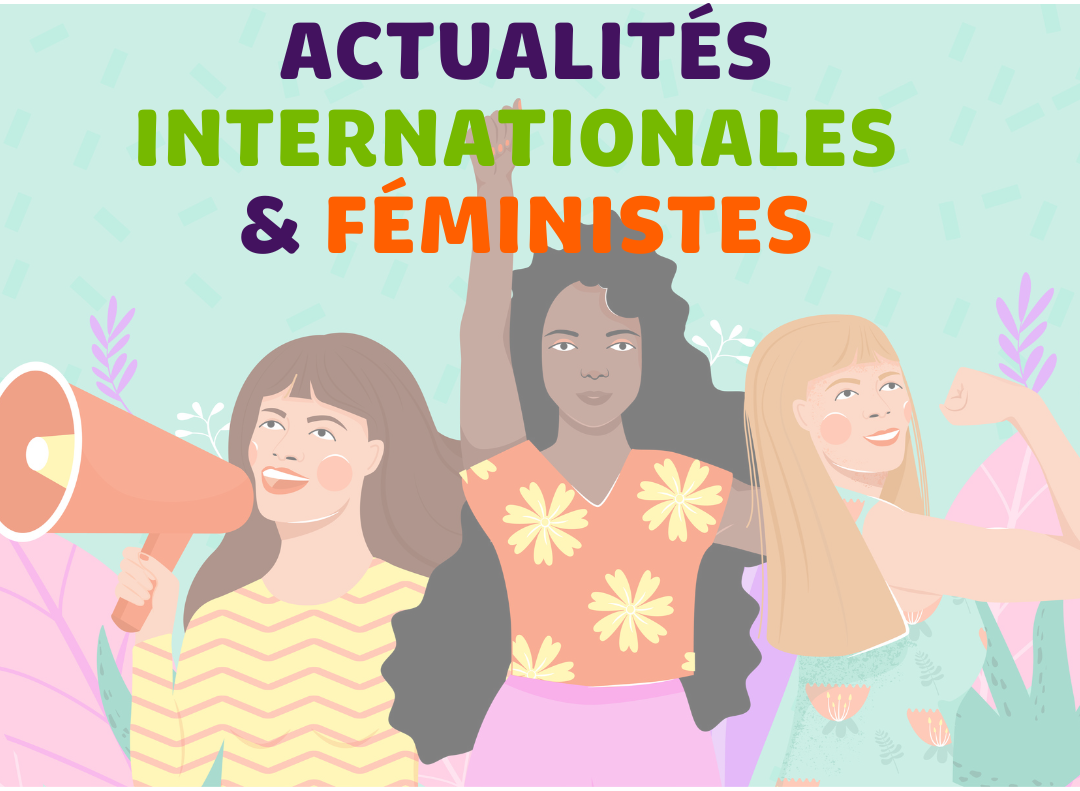
Revue de presse féministe & internationale du 25 au 29 août 2025
29 août, 2025Revue de presse féministe & internationale du 14 au 18 juillet 2025
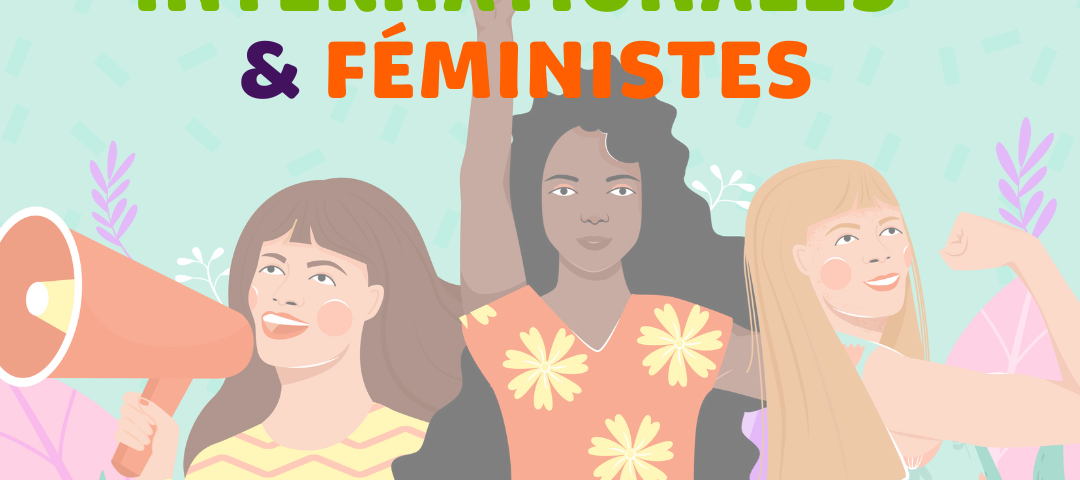
ETHIOPIE
Les viols comme arme de guerre, un crime impuni qui entrave la reconstruction des victimes
Entre 2020 et 2022, la guerre au Tigré a été l’un des conflits les plus meurtriers et les plus violents, faisant, selon l’Union africaine, plus de 600 000 mort·es en deux ans. Mais ce conflit, qui a opposé le gouvernement fédéral éthiopien au Front populaire de libération du Tigré, a été marqué par des attaques d’une brutalité extrême contre les femmes : l’utilisation des viols comme véritable arme de guerre.
Selon les autorités régionales tigréennes, près de 120 000 femmes et jeunes filles, soit une Tigréenne sur dix, ont été violées durant ce conflit. Les témoignages recueillis par Amnesty International confirment l’ampleur systématique de ces crimes : viols en réunion, esclavage sexuel, mutilations génitales, grossesses forcées et actes de torture tels que l’insertion d’objets coupants dans l’utérus. Une femme enceinte a ainsi été victime d’un avortement forcé provoqué par l’insertion d’aiguilles, causant une hémorragie mortelle.
Comme le souligne Birhan Gebrekirstos, chercheuse à l’université de Makalé, ces violences avaient un objectif clair : détruire physiquement et psychologiquement les victimes et empêcher la communauté tigréenne de se reconstruire. Selon elle, ces crimes relèvent d’un « esprit de revanche » encore vif plus de vingt ans après la guerre Éthiopie-Érythrée.
Les conséquences sont dévastatrices : mutilations irréversibles, stérilité, traumatismes psychologiques, suicides. Et la signature de l’accord de paix de Pretoria en novembre 2022 n’a pas mis fin aux violences.
Malgré la gravité des crimes, le silence des autorités éthiopiennes et érythréennes reste assourdissant. Reconnaître ces violences reviendrait à admettre l’implication des forces armées nationales. Pour Meaza Gebremedhin, activiste et présidente de l’ONG Harambee Collective, « Personne ne souhaite faire face au fléau des viols au Tigré ». La reconstruction des victimes, déjà marginalisées et souvent rejetées par leur propre famille, n’est pas une priorité pour les autorités régionales.
Deux ans et demi après la fin de la guerre, une seule procédure judiciaire a été ouverte, en septembre 2024 en Allemagne, à l’initiative de huit survivant·es.
Face à l’inaction des autorités, des initiatives locales comme le centre Hiwyet à Makalé jouent un rôle essentiel. Créée en 2023 et financée sur fond propre et par des dons, cette association a déjà accueilli près de 6 000 survivantes, âgées de 5 à 80 ans. Les femmes y bénéficient de soins médicaux, d’un accompagnement psychologique et, pour celles qui le souhaitent, de formations professionnelles afin de retrouver une autonomie financière.
Pour Meseret Hadush, fondatrice du centre, ce soutien doit s’accompagner d’un travail de mémoire et de justice : « On documente les faits au maximum pour constituer un dossier. On portera l’histoire des survivantes devant la Cour pénale internationale car ici, c’est peine perdue. Pour toutes les femmes victimes, faire reconnaître ce traumatisme fait partie du processus de guérison »
Comme le rappelle Amnesty International, l’utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre constitue un crime de guerre et peut relever de crimes contre l’humanité. Les Nations unies, qualifient ces violences de « tactique de guerre » visant à humilier, terroriser et détruire des communautés entières.
Pourtant, faute de volonté politique, les survivantes du Tigré restent, pour la plupart, sans recours juridique. Elles continuent de porter seules le poids d’un traumatisme qui, au-delà des individus, vise à détruire toute une communauté.
FRANCE
60 ans après la fin de la tutelle bancaire des maris, les Françaises peinent encore à conquérir leur indépendance financière
Le 13 juillet 1965, la France tournait une page du Code Napoléon : pour la première fois, les femmes mariées pouvaient travailler, percevoir leur salaire et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari. Une avancée majeure vers l’émancipation économique, symbole d’une autonomie enfin reconnue. Soixante ans plus tard, cette victoire n’est pas complète : si les Françaises ont conquis le droit de gérer leur argent, elles n’ont pas encore gagné l’indépendance financière à laquelle elles aspirent.
En 1987, à la question « Qu’est-ce qui contribue le plus à l’équilibre d’une femme ? », 52 % des Françaises répondaient « une famille, des enfants », contre seulement 25 % « l’indépendance financière ». Près de quarante ans plus tard, les priorités se sont inversées : selon une étude de La France mutualiste publiée le 7 juillet, 50 % des femmes placent désormais l’indépendance financière en tête de leurs aspirations, loin devant la famille (27 %).
Un changement qui traduit une prise de distance avec les schémas traditionnels… mais aussi une angoisse face à la précarité. Car malgré des droits formellement acquis, la réalité économique reste défavorable aux femmes.
Selon l’Insee, le revenu salarial des femmes dans le secteur privé restait, en 2023, inférieur de 22 % à celui des hommes, en raison d’un recours plus important au temps partiel et à des emplois moins qualifiés. Et les moments de rupture – divorce, monoparentalité, retraite – accentuent encore la vulnérabilité des femmes.
Une étude de l’Insee publiée le 10 juillet en Île-de-France révèle qu’après une séparation, les femmes sont le plus souvent les grandes perdantes. Leur niveau de vie chute bien plus que celui des hommes, tous milieux confondus. Dans les foyers aisés, la perte atteint en moyenne 15 100 euros par an pour les femmes, contre 6 400 pour les hommes. Et dans les familles modestes, la garde des enfants, assumée le plus souvent par les mères, accentue encore l’écart.
Au-delà des salaires, l’indépendance financière dépend aussi de la capacité à investir. Or, en matière d’épargne, les femmes restent en retrait. « Le sous-investissement des femmes est massif, notamment dans les actions cotées, dont on sait pourtant que c’est l’investissement le plus rentable à long terme. », alerte Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En 2024, elles ne représentaient plus que 25 % des investisseur·ses actif·ves en Bourse, contre 30 % en 2022.
Cette absence sur les marchés financiers s’explique par des écarts de patrimoine – les hommes disposent en moyenne de davantage de capital à placer – mais aussi par une aversion au risque plus marquée, nourrie par un manque de confiance. L’AMF déplore un « loupé collectif majeur ».
Pour Héloïse Bolle, conseillère en gestion de patrimoine, il faut aussi regarder du côté de l’organisation domestique : « Celles qui ont des enfants n’ont pas une minute à perdre, elles sont toujours sollicitées pour s’occuper d’eux. A la maison, ce sont elles qui gèrent, cela reste une réalité. »
Malgré tout, des signes d’évolution apparaissent. Les jeunes femmes investissent davantage : en 2024, 112 000 Françaises de moins de 40 ans se sont lancées en Bourse, contre 71 000 en 2022. « Un message infuse très lentement : de jeunes clientes, de moins de 35 ans, viennent avec l’idée de devenir indépendantes financièrement, constate Héloïse Bolle. Et cela dès leur premier, ou deuxième job ! », note Héloïse Bolle.
Mais le chemin reste long : même si la France n’a pas été la plus en retard en 1965 (le Royaume-Uni n’a légiféré qu’en 1975 et les États-Unis en 1974), l’enjeu n’est plus l’accès au compte, mais la conquête réelle de la liberté économique. Soixante ans après cette victoire juridique, l’émancipation financière des femmes est encore un combat. Le droit de disposer de son argent est acquis ; celui d’en gagner et d’en faire fructifier suffisamment pour être libre reste, lui, à conquérir.
Enzo Castéras, “Pourquoi les femmes restent peu investies en Bourse”, Le Monde, le 16 juillet 2025
UNION EUROPEENNE
L’endométriose, pour la première fois au cœur du débat européen
Ce 10 juillet, le Parlement Européen a débattu pour la première fois et en séance plénière sur l’endométriose, une pathologie chronique gynécologique qui touche deux millions de femmes en France et une femme sur dix en Europe.
C’est la députée européenne française du groupe écologiste Majdouline Sbaï qui est à l’origine de l’échange dans l’hémicycle de Strasbourg. Interrogée sur Libération, elle dit avoir été frappée que l’endométriose n’ait jamais été mise à l’ordre du jour au Parlement Européen que ce soit dans les discussions plus générales (par exemple sur la démographie européenne alors que les femmes atteintes sont touchées davantage par l’infertilité) ou même dans la Commission Environnement et Santé à laquelle elle appartient.
L’endométriose est une maladie dont on ne parle que depuis une dizaine d’années. Pourtant, encore aujourd’hui, il faut en moyenne sept ans pour qu’une femme puisse obtenir un diagnostic. Par moments invalidante en raison de forts pics de douleur, la maladie impacte fortement la vie quotidienne, la vie professionnelle et la santé physique et mentale des femmes qui en sont atteintes.
Lors du débat, il a pu être constaté que dans de nombreux pays, le manque de sensibilisation et l’absence de programmes de soins spécialisés entraînent encore des inégalités entre les femmes et les hommes. Il est donc important de veiller à ce que toutes les femmes en Europe aient un accès équitable à l’information et aux soins.
« Pendant bien trop longtemps, la recherche s’est concentrée sur les corps masculins. Il est temps que cela change. Le changement est en cours, mais il n’est pas assez rapide. Nous appelons à investir dans la recherche, non seulement sur le diagnostic et le traitement, mais aussi sur la sensibilisation à la santé des femmes. » (version traduite de l’anglais) – Tilly Metz, députée européenne luxembourgeoise du groupe les Verts.
Comme l’a rappelé Majdouline Sbaï, quatre priorités doivent absolument être prises en compte si l’on veut véritablement faire progresser la prise en charge de cette maladie.
Premièrement, l’eurodéputée insiste sur la nécessité d’obtenir des engagements concrets en matière de stratégie de recherche et de financement. Cela permettra aussi de mieux évaluer les différentes pratiques de soins en Europe : pourquoi observe-t-on davantage de chirurgies en Belgique, tandis que la France privilégie les traitements hormonaux ? Lequel est le plus efficace ? Si des travaux sont déjà en cours, elle souligne qu’un soutien renforcé permettrait de changer d’échelle et d’accélérer la recherche.
Deuxièmement, elle alerte sur la question du diagnostic et de la reconnaissance de la maladie. Bien qu’il y ait eu des avancées, notamment face au tabou et à l’invisibilisation qui ont longtemps prévalu, elle appelle à poursuivre la bataille culturelle engagée pour faire reconnaître pleinement cette pathologie, tant au sein du grand public que dans les milieux médicaux.
Troisièmement, l’eurodéputée plaide pour la mise en place de pratiques de soins globales et pluridisciplinaires, en tirant les leçons des études actuelles et futures. Elle défend une approche intégrée, mobilisant gynécologues, nutritionnistes, sexologues et psychologues, afin de proposer une prise en charge complète et personnalisée.
Enfin, elle appelle à élargir la réflexion au-delà du champ strictement médical, en s’attaquant aux enjeux sociaux et économiques liés à la maladie. L’inclusion dans le monde du travail doit faire l’objet d’une attention particulière, car cette pathologie a un impact direct sur la vie professionnelle des femmes qui en souffrent. Il est également crucial de traiter la prise en charge des soins et le surcoût financier induit par la maladie.
Parler de l’endométriose en séance plénière du Parlement européen est crucial pour sensibiliser les décideurs, recueillir leurs propositions et identifier les engagés. L’objectif est d’élaborer une stratégie européenne favorisant les échanges entre initiatives nationales, disciplines concernées et associations, afin de faire avancer des propositions concrètes.
À ce jour, aucun traitement curatif n’est trouvé mais l’Union européenne commence déjà à investir dans la recherche liée à la maladie. Tel est le cas du projet FEMaLE (Finding Endometriosis using Machine Learning), financé à hauteur de six millions d’euros par le programme Horizon 2020, qui vise à améliorer le diagnostic et la prise en charge de la maladie grâce à l’apprentissage automatique.
En France, le grand plan de lutte contre l’endométriose et l’infertilité lancé en 2022 par Emmanuel Macron commence tout juste à se concrétiser, avec des fonds désormais débloqués. La recherche, qui part de loin, va s’organiser autour d’une dizaine de projets scientifiques prévus dans les prochaines semaines. Regroupés au sein du programme national PEPR (un programme et équipement prioritaire de recherche), doté de 11,3 millions d’euros, ces projets viseront à mieux comprendre les causes de la maladie — microbiote, génétique, exposition chimique — et à explorer de nouvelles pistes de traitement.
INTERNATIONAL
La tendance virale qui dévoile l’excès de confiance masculine
Une nouvelle tendance qui circule sur les réseaux sociaux met en lumière l’excès de confiance que certains hommes peuvent avoir en eux-mêmes. Le principe est simple : leur demander s’ils pensent pouvoir faire atterrir un avion en cas d’urgence. Leur réponse, souvent positive, prête généralement à sourire.
Ce phénomène fait écho à une étude américaine publiée en 2023 par l’institut de sondage YouGov, menée auprès de 20 000 personnes. Celle-ci révélait que, dans un scénario d’atterrissage d’urgence assisté par des contrôleurs aériens, 46 % des hommes se déclaraient « très confiants » (20 %) ou « plutôt confiants » (26 %) quant à leur capacité à poser l’appareil sans incident. Du côté des femmes, ces proportions étaient bien plus faibles : 7 % se disaient « très confiantes » et 13 % « plutôt confiantes ».
L’ex-pilote en ligne Gérard Feldzer pour le Parisien a souligné l’absurdité de cette idée : « Pour un passager lambda, c’est tout bonnement impossible (…) Le tableau de bord est très complexe, il y a beaucoup de commandes à connaître, trop de paramètres à prendre en compte…».
Cette confiance excessive des personnes incompétentes à surestimer leurs propres capacités porte un nom : c’est l’effet Dunning-Kruger (noms des deux scientifiques ayant découvert ce mécanisme cognitif dans les années 1990). Il s’oppose ainsi au syndrome de l’imposteur qui décrit un phénomène psychologique dans lequel une personne doute de ses compétences, de ses réussites et de sa légitimité, malgré des preuves objectives de son succès et a tendance à les minimiser.
En 2025, trois chercheuses se sont emparées du sujet pour voir si l’effet Dunning-Kruger était plus fréquent chez les hommes ou les femmes. Ainsi, en s’appuyant sur les données de la British Cohort Study – une vaste étude scientifique qui suit depuis 1970 plusieurs milliers de Britanniques –, les chercheuses ont mis en évidence une différence marquée : « à compétences égales, les hommes ont tendance à surestimer leurs capacités et les femmes à les sous-estimer » (Le Monde).
Selon Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’Université catholique de Louvain (Belgique), ces résultats ne sont pas du tout étonnants. Il explique cela par les rôles traditionnels des hommes, axés sur l’assertivité, la compétence et la maîtrise — ce que la sociologue Raewyn Connell appelle la « raison », en contraste avec l’« émotion » associée aux femmes.
La société exige souvent des hommes qu’ils soient sûrs d’eux dès l’enfance, jusque dans les études, le monde professionnel et plus tard. Alors qu’à l’inverse, les femmes sont plus nombreuses à douter ou à attribuer leurs succès à d’autres facteurs tels que la chance ou les différentes circonstances favorables (entourage, argent, études, etc.).
Pour certains hommes, cette confiance affichée n’est pas sans conséquence. Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale, explique pour le journal Le Monde que la masculinité est souvent perçue comme un état de maîtrise, ce qui peut pousser certains à ressentir une pression à démontrer certaines compétences. Selon lui, cela peut engendrer un sentiment de menace envers leur virilité, lié à ce qu’il appelle une « masculinité précaire », où l’identité masculine devient un statut fragile à défendre.