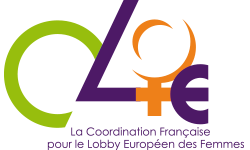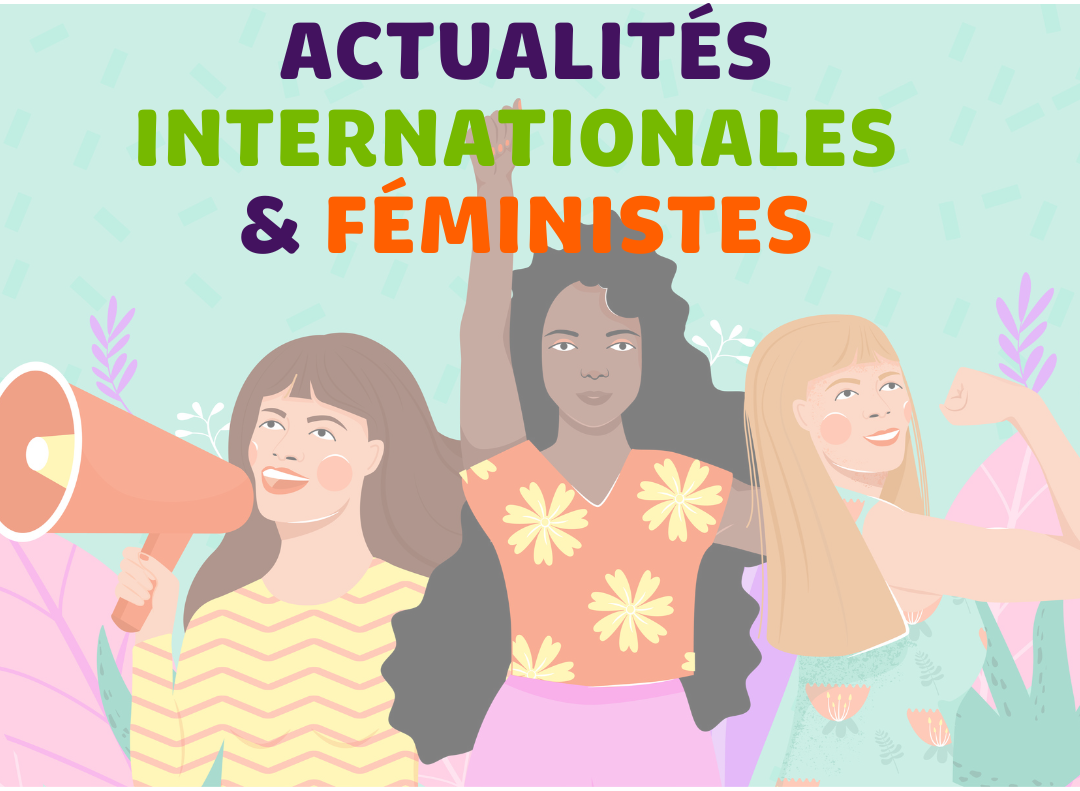
Revue de presse féministe & internationale du 13 au 19 avril
19 avril, 2024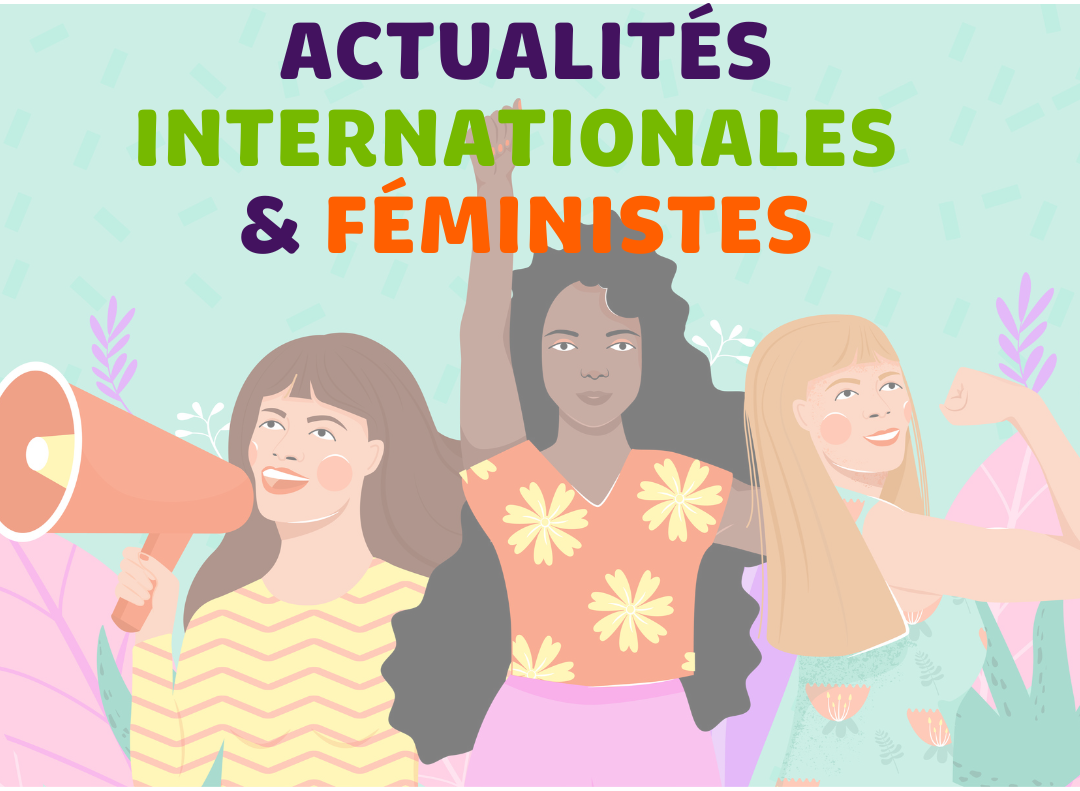
Revue de presse féministe & internationale du 13 au 19 avril
17 mai, 2024Revue de presse féministe & internationale du 20 au 26 avril

Tour d’horizon de l’état du droit à l’IVG dans les Etats membres de l’Union européenne
Cette semaine, l’équipe de la CLEF vous propose un numéro spécial de votre revue de presse hebdomadaire internationale. En effet, à moins de deux mois des élections européennes et alors que le droit à l’IVG est remis en cause dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, il semble important de procéder à un rapide tour d’horizon de l’état du droit à l’IVG dans l’Union européenne.
Avant toute chose, il semble légitime de se demander pourquoi la situation est-elle si disparate entre les Etats alors que l’Europe promeut la défense des droits fondamentaux grâce à sa Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH) et sa Charte des droits fondamentaux ?
La réponse est simple : les deux Europes ne peuvent (et ne veulent) s’immiscer dans ce qui est considéré comme faisant partie de la « morale publique » des Etats membres. Pour rappel, l’Union européenne est restreinte aux compétences que lui confèrent les Etats. Or, ces derniers se gardent bien de lui donner la possibilité de légiférer sur ce sujet, d’autant plus que sa compétence en matière de santé est subsidiaire : ce n’est que si les Etats ont besoin d’aide que l’UE peut intervenir (exemple avec le Covid). Ensuite, du côté de l’autre Europe, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ne souhaite pas reconnaître un droit à l’IVG. Elle le dit elle-même, « Pour la Cour, (…) l’article 8 ne saurait en conséquence s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement »[1].
Ainsi, chaque Etat est libre de légiférer comme il l’entend sur l’avortement. Mais le droit des femmes de choisir leur maternité est une affaire politique qui varie selon les partis dirigeants, faisant de l’IVG un droit particulièrement fragile [2].
[1] CEDH, (GC), 16 décembre 2010, A, B et C c. Irlande, n° 25579/05, §214 ; CEDH, 30 octobre 2012, P. et S. c. Pologne, n° 57375/08, §96.
[2] MARQUES-PEREIRA Bérengère, L’avortement dans l’Union européenne, CRISP, Bruxelles, 2021, p.103.
DÉCONSTRUIRE LES IDÉES REÇUES SUR L’ACCÈS À L’IVG EN EUROPE DE L’OUEST
L’accès à l’IVG dans les pays d’Europe de l’Ouest comme la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne peut sembler une évidence. Dépénalisé dans tous les États de cette région d’Europe, certains sont dans une démarche d’allongement du délai légal, allant dans le sens d’une libéralisation du droit à l’IVG. Dans des pays respectant l’Etat de droit, les combats menés par les féministes de la Seconde vague paraissent acquis et pourtant, la bataille n’est toujours pas terminée. Comme le rapportait Simone de Beauvoir à Claudine Monteil, « il suffira d’une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ».
En France, les féministes ont remporté de haute lutte une grande victoire : l’IVG est inscrite dans la constitution ! Cependant, le monopole de cette « liberté d’interrompre sa grossesse » revient toujours au législateur. Ainsi, l’accès à ce droit, maintenant officiellement fondamental, dépend toujours du bon vouloir politique. De même, cet accès est remis en cause dans sa pratique. En quinze ans, 130 centres où pratiquer l’IVG ont fermé leur porte sur le territoire français. La présidente du Planning familial, Sarah Durocher[3], et la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes[4], alertent sur la difficulté d’avorter dans les zones de déserts médicaux, nécessitant des heures de trajets supplémentaires et des délais d’attentes plus longs que sur d’autres parties du territoire.
Ces inégalités régionales se retrouvent dans plusieurs pays d’Europe et notamment en Espagne, Etat pourtant précurseur sur les problématiques liées aux violences faites aux femmes. En effet, chaque région est libre de choisir comment aborder l’accès à l’IVG. Ainsi, dans certaines comme celle de Madrid, Aragon ou Murcie, aucun hôpital public ne pratique l’avortement. Toutefois, les femmes sont directement redirigées vers des cliniques privées sous contrat pour lesquelles la sécurité sociale prend en charge les frais. Cette situation n’est absolument pas idéale puisqu’elle ne fait qu’augmenter la stigmatisation et le tabou autour de l’IVG et accroître les disparités d’accès entre les territoires[5]. En effet, dans certaines régions très conservatrices et catholiques comme Castille-et-Leon, même les cliniques privées refusent de pratiquer un avortement. En 2023, dans cette même région, un parti d’extrême droite a notamment essayé d’imposer une nouvelle loi visant à faire écouter le cœur du fœtus à la femme au préalable de l’opération. Selon le ministère de la santé, seulement 15% des interventions sont pratiquées dans les hôpitaux publics.
En Italie, le chemin vers l’avortement est lui aussi semé d’embuches. L’actuelle Première Ministre Giorgia Melloni s’est toujours présentée comme opposante à l’avortement. Bien qu’elle ne le restreigne pas légalement, son accès est fortement dégradé par l’utilisation massive de la clause de conscience des médecins. Selon un rapport du ministère de la santé italien[6], en 2019, 67% des gynécologues ont refusé de pratiquer une IVG. Un taux qui atteint 92% dans la région de Molise et 80% dans cinq autres régions du Sud du pays. Le 17 avril 2024, un amendement déposé par le parti de Giorgia Meloni a été validé, autorisant les militants d’associations anti-choix à accéder aux cliniques pour dissuader les femmes d’avorter.
En Allemagne, pays pour lequel le chemin vers la dépénalisation est particulièrement long, de nouvelles évolutions semblent être lancées. Les articles 218 et suivant du code pénal interdisent encore l’avortement mais ne lui apposent aucune sanction lorsqu’il est pratiqué durant les 12 premières semaines d’aménorrhée. Ainsi, un rapport envisageant de textuellement légaliser l’IVG a été rendu début avril 2024 et sera étudié par les ministres concernés dans les prochaines semaines. Toutefois, l’avortement est encore « le plus grand tabou de notre société », affirme la gynécologue Kristina Hänel, condamnée en 2018 pour « publicité » à l’avortement sur son site internet, pratique qui, notamment grâce à son combat, a finalement était dépénalisée en juin 2022. Mais l’information à l’avortement reste toujours difficile d’accès, l’IVG est encore stigmatisée et n’est pas remboursée : les femmes doivent débourser entre 350 et 650 euros (bien plus si elles doivent être hospitalisées)[7], sauf cas d’extrême pauvreté.
En Autriche aussi, une IVG n’est pas remboursée par la sécurité sociale et coûte entre 300 et 1000 €[8]. Depuis 2015, les femmes portugaises prennent également entièrement en charge leur avortement. Au Portugal, rien n’est fait pour encourager l’accès à l’IVG. Avec la Croatie et la Slovénie, le pays connaît le plus faible délai légal (10 semaines) et demande aux femmes de se soumettre à un entretien psychologique ainsi qu’à un délai de réflexion de trois jours au préalable. Le cours délai et le coût budgétaire influence in fine les femmes à avoir recours à un avortement illégal ou à partir à l’étranger.
A l’inverse, les Pays-Bas autorisent l’IVG jusqu’à la 24ème semaine d’aménorrhée, soit le délai le plus long d’Europe avec l’Angleterre. L’acte est gratuit, anonymisé et depuis le 10 février 2022, les femmes n’ont plus à se livrer à une « période de réflexion » de cinq jours. La Belgique a quant à elle repris ses débats vieux de quatre ans, visant à supprimer ou réduire le délai supplémentaire de « réflexion », actuellement de six jours, et à allonger le délai légal de 12 à 18 semaines. Mais les propositions de loi risquent de stagner au moins jusqu’aux prochaines élections législatives prévues en juin 2024[9]. Le Danemark est aussi en pleine discussion quant au même allongement du délai légal, recommandé par le Conseil d’éthique. Le Royaume avait d’ailleurs été le premier pays au monde à autoriser l’IVG sans conditions en 1973 [10]. Enfin, au Luxembourg, l’avortement ne semble pas être remis en cause, autorisé jusqu’à la quatorizième semaine d’amhénoré et sans conditions depuis 2012.
Ce premier tour d’horizon dresse les contours d’Etats européens autorisant légalement l’IVG mais dont les difficultés liées à son accès effectif demeurent. Il ne suffit donc pas de constater son existence légale pour déterminer ses garanties : l’IVG est un droit éminemment politique et constamment en mouvement (voir article 2).
[3] Tirée de l’intervention de Mme Sarah Durocher lors de la Table ronde organisée par le magazine la Déférlante pour le lancement de son treizième numéro le jeudi 29 février 2024 – Voir DHOLLANDE Victor, « Les Françaises encore confrontées à des difficultés pour procéder à l’avortement », France Inter, 28 septembre 2023.
[4] BATTISTEL Marie-Noëlle et MUSCHOTTI Cécile au nom de la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, Rapport d’information n°3343 sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, 16 septembre 2020 – Voir MAAD Assma et IMBACH Romain, « Accès à l’IVG : dans la pratique, des obstacles perdurent en France », Le Monde, 28 février 2024.
[5] Raquel Hurtado, du Planning familial dans MOREL Sandrine, « En Espagne, où l’avortement est légal, des médecins objecteurs de conscience en entravent l’accès », Le Monde, 17 août 2022.
[6] Ministro della Salute, Relazione attuazione Legge 194/78 tutela sociale maternità e interruzione volontaria di gravidanza – dati 2019 e preliminari 2020, 30 août 2021, p.56 – voir FEDERICO Ilaria, « En Italie, l’avortement est légal mais pas toujours accessible », La Croix, 13 janvier 2022.
[7] Sénat, Étude de législation comparée : l’interruption volontaire de grossesse, n°280, juillet 2017.
[8] Site : Abortion in Austria (https://abortion-in-austria.at/fr/methodes-et-couts/)
[9] Voir DU CHAMPS Anaïs, « Avortement en Belgique : entre blocage et mobilisations citoyennes », RTBF : les grenades, 4 mars 2024.
[10] Voir « Avortement : le Danemark “pionnier” en 1973, prêt à sortir du statu quo ? », Courrier international, 27 septembre 2023.
LES RECENTS BOULEVERSEMENTS CONCERNANT LE DROIT A L’AVORTEMENT EN EUROPE
Depuis 2018, quelques États membres de l’Union européenne ont décidé d’améliorer l’accès légal à l’interruption de grossesse alors même que, parallèlement, la Pologne et la Hongrie se sont orientés vers une politique inverse.
Depuis mars et mai 2018, il est désormais possible de pratiquer une IVG jusqu’à 12 semaines d’aménorrhée à Chypre et en Irlande. Jusqu’alors, Chypre n’autorisait l’avortement que si la santé de la femme était en danger et l’Irlande sous tous les cas de figure. Ce n’est qu’après le décès de Savita Halappanavar suite à un refus d’avortement et l’ampleur médiatique que cela avait suscité, que le gouvernement irlandais a tenu un référendum pour dépénaliser l’IVG. En 2018, 66,4% de la population a voté “oui”, modifiant alors un amendement constitutionnel datant de 1861. Les femmes ne sont donc plus susceptibles d’encourir une peine de 14 ans d’emprisonnement pour avoir choisi de mener leur vie comme elles l’entendent. Cependant, la clause de conscience reste très utilisée par les médecins du pays, restreignant toujours l’accès concret à l’avortement [1].
L’année 2023 a aussi marqué un tournant pour les Finlandaises et les Maltaises.
Depuis le 28 juin 2023, Malte autorise l’avortement à deux seules conditions : si la vie de la femme est en danger ou si le fœtus n’est pas viable[2]. Même si ce changement paraît léger, Malte était jusqu’alors le seul Etat membre de l’Union européenne à encore refuser l’avortement sans exceptions. Pourtant, hors ces deux cas extrêmes, procéder à une interruption de grossesse sur simple demande reste un délit puni de quatre ans d’emprisonnement pour le médecin avorteur et trois ans d’emprisonnement pour la femme et les autres personnes aidantes[3]. L’IVG n’est donc pas encore une option pour les Maltaises.
Un autre « petit pas » maltais peut être souligné du côté des institutions de l’Union européenne. La maltaise et actuelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a toujours porté ses convictions anti-IVG mais a toutefois déclaré qu’en tant que présidente, elle soutiendrait les positions pro-choix de l’institution qu’elle interprète comme « sans ambiguïté et sans équivoque »[4].
En Finlande, l’IVG n’était pas interdite de droit mais le chemin vers son accès était semé d’embûches. Il nécessitait l’approbation de deux médecins et une motivation de la part de la femme par rapport à son âge, sa situation socio-économique, le nombre d’enfants à charge etc… Depuis le 1er septembre 2023, l’IVG est accessible sans condition et gratuite jusqu’à la 12ème semaine d’aménorrhée[5].
Malgré ces avancées législatives, l’avortement reste particulièrement menacé notamment en Pologne et en Hongrie. Ces deux Etats membres sont également les seuls de l’Union européenne à avoir signé la Déclaration de consensus de Genève sur la promotion de la santé de la femme et le renforcement de la famille, adoptée en 2020 à l’initiative du gouvernement Trump, dont l’objectif et de contester le droit des femmes d’interrompre leur grossesse au regard de la primauté des “droits de l’enfant à naître”.
En Pologne, l’avortement n’est plus envisageable en raison d’une malformation grave du fœtus depuis la décision du Tribunal constitutionnel Polonais du 22 octobre 2020[6]. Pourtant ce cas représentait 98% des avortements légalement réalisés. Réduit aux seuls cas de risques pour la santé de la femme ou si la grossesse résulte d’un viol, la question de l’avortement a regagné une ampleur politique, lancée depuis 2016 et les « manifestations noires »[7], en favorisant notamment les scrutins pour la coalition gouvernementale de Donald Tusk. Ce dernier avait promis d’intégrer la dépénalisation de l’avortement dans son agenda politique et, chose promise chose due, quatre projets de lois ont été approuvés par le Parlement en avril 2024 visant à revenir à l’état antérieur à 2020[8]. Les débats restent à suivre mais ils pourraient constituer une première avancée pour les polonaises dont un tiers dit avoir déjà eu recours à l’avortement[9].
En Hongrie, l’IVG est autorisée mais peut-être plus pour longtemps. Depuis 2012, l’avortement médicamenteux, voie la plus simple, n’est plus tellement pratiqué dans le pays dont la Constitution « protège la vie dès la conception ». Les consultations médicales, obligatoires avant la procédure abortive, varient selon les convictions du personnel soignant : « il peut leur être montré des photos pour les décourager, leur parler des bénéfices d’avoir un enfant notamment en termes d’allocations… »[10]. Le gouvernement Orban, au pouvoir depuis 2017, mène une politique nataliste renforçant les campagnes et les financements anti-IVG. Les femmes sont désormais contraintes d’écouter le rythme cardiaque du fœtus, « obligations qui n’a aucune utilité médicale et ne sert qu’à humilier les femmes » selon l’IPPF[11]. Face à toutes ces complications, une grande part de Hongroises sont contraintes de se faire avorter à Vienne d’après l’association EMMA et Patent.
Ainsi, ces changements législatifs récents sont radicalement opposés : ils visent d’une part à promouvoir un meilleur accès à l’avortement et d’autre part à le restreindre. Les pays d’Europe de l’Est et d’Europe centrale connaissent également de grandes disparités législatives (voir article 3). Le droit à l’IVG est donc éminemment politique et nécessite une insatiable bataille des féministes contre les mouvements anti-IVG (voir article 4).
[1] Voir TAOUCHANOV Laura, « Droits à l’IVG : en Irlande, restrictions, intimidations et inégalités géographiques », RFI, 20 juin 2023.
[2] Loi du 28 juin 2023 amendant le code pénal Maltais (Act n° XXII of 2023).
[3] Article 243 B du code pénal Maltais.
[4] Voir LARTIGUE Aurore, « Droits à l’IVG : l’Union européenne impuissante face aux tentatives de retour en arrière », RFI, 19 juin 2023.
[5] Voir “Finland’s parliament approves reform to strict abortion laws”, Euronews, 26 octobre 2022.
[6] Tribunal constitutionnel, 22 octobre 2020, aff. K 1/20.
[7] Voir IWANIUK Jakub, « ‘Lundi noir’ de mobilisation en Pologne contre le projet de loi anti-avortement », Le Monde, 4 octobre, 2016.
[8] Voir BECCHIO Anastasia, “Pologne : première étape franchie pour un assouplissement des sévères lois sur l’avortement”, RFI, 12 avril 2024 ; CHODOWNIK Magdalena, « Pologne : le Parlement fait un premier pas vers une libéralsiation de l’accès à l’IVG », Euronews, 12 avril 2024.
[9] Selon un sondage mené par la fondation Federa.
[10] Intervention de l’association EMMA et Patent durant la table ronde « les droits sexuels et reproductifs en Europe sont-ils en danger ? » organisée par Choisir la cause des femmes à l’occasion des Rencontres féministes européennes, Nantes, 4 décembre 2023.
[11] Fédération internationale pour la planification familiale.
L’INÉGAL ACCÈS À L’IVG DANS LES ETATS D’EUROPE CENTRALE ET D’EUROPE DE L’EST
L’accès à l’IVG en Europe centrale et en Europe de l’Est est inégal selon les Etats, forçant souvent les femmes à recourir à l’avortement dans des pays limitrophes.
En Croatie, l’avortement est de plus en plus menacé. Légal jusqu’à la 10ème semaine et au frais de la femme enceinte, 60% des gynécologues refusent de pratiquer une IVG[1]. Les hôpitaux mènent également une politique de stigmatisation, certaines patientes pouvant recevoir des réflexions comme « pourquoi as-tu fait l’amour alors ? » [2] ou certains médecins exécutant un avortement par curetage sans anesthésie, « une forme de punition » selon Dorotea Šušak, directrice du Centre d’études féminines. De plus, les cliniques et associations pratiquant l’IVG font face à un phénomène de “kneelers”, des pro-life s’agenouillant devant les portes, pleurant la mort de “l’enfant à naître”. En 2017, la loi autorisant l’IVG avait été remise en cause devant la Cour constitutionnelle, qui avait toutefois rejeté la demande[3]. Face à cette montée du tabou et de l’impossibilité de fait d’accéder à une IVG, le pays présente le deuxième taux d’avortement légalement pratiqué le plus faible d’Europe, derrière la Pologne[4]. En effet, les croates qui le peuvent vont se faire avorter en Slovénie, où l’IVG est autorisée sous les mêmes conditions mais où elle est plus facile d’accès. Outre l’effacement de stigmatisation et de tabou autour de l’acte, le coût est également plus faible, 200€ en Slovénie contre 300€ en Croatie.
Depuis le début des débats constitutionnels français autour de l’IVG, les médias citent la Slovénie comme le premier Etat européen ayant inscrit l’avortement dans sa Constitution. Pourtant, la formule est bien moins claire qu’en France : « la décision d’avoir des enfants est libre. L’État garantit les possibilités de réalisation de cette liberté et crée les conditions qui permettent aux parents de décider de la naissance de leurs enfants ». Pour la militante slovène Tonja Jerele, il faudrait surtout y inscrire « la décision de ne pas avoir d’enfant est libre »[5], pour que l’IVG soit effectivement consacrée constitutionnellement.
Un peu plus à l’Est, en Slovaquie, l’avortement médicamenteux n’est pas légal et il reste difficile de trouver un médecin qui accepte de pratiquer un avortement chirurgical dont le coût varie entre 300 et 500 €. Depuis 2018, l’IVG est particulièrement attaquée dans le pays comptabilisant 19 propositions de loi visant à réduire l’accès à l’IVG devant le Parlement[6]. Les roumaines aussi sont face à un taux élevé d’utilisation de la clause de conscience par les médecins. De manière globale, le domaine de la santé du pays manque de moyens financiers mettant en péril les quelques centres de plannings familiaux encore prospères. Alors que la contraception est payante et que l’éducation sexuelle ne fait pas partie du programme scolaire, l’avortement est très peu accessible. A Bucarest, seuls deux hôpitaux publics acceptent de pratiquer une IVG et uniquement si la grossesse est à moins de 10 ou 12 semaines. Pourtant, la loi l’autorise jusqu’à la quatorzième semaine d’aménorrhée. Le soin est donc renvoyé aux cliniques privées, qui peuvent le facturer à hauteur de 700€[7].
Les complications liées à l’accès à l’avortement en Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie supposent un accès relativement compliqué pour les femmes Ukrainiennes réfugiées et victimes de viols. Pourtant, leur demande d’avorter est nombreuse. Rien qu’en Pologne, un collectif a recensé 326 sollicitations de femmes ukrainiennes souhaitant interrompre leur grossesse[9].
En République Tchèque, l’IVG est accessible pour toutes et gratuite sauf pour les femmes résidentes ne disposant pas d’un permis de séjour de longue durée. Seule exception : si leur vie est en danger. Toutefois, face au nombre important de Polonaises faisant le trajet pour se faire avorter en République Tchèque, le ministre de la Santé a précisé en 2016 que les femmes des Etats membres de l’Union européenne pouvaient légalement accéder à une IVG. Par peur de potentielles représailles, qui semblent « improbables » selon le bureau du médiateur de la République, certaines cliniques préfèrent malgré tout appliquer strictement la loi[10]. Une énième barrière pour les Ukrainiennes et les Polonaises.
Depuis décembre 2019, la Grèce fait face à la montée de campagnes anti-IVG, notamment avec l’introduction par l’Eglise orthodoxe d’une journée de « l’enfant à naître ». Une campagne pro-life avait également été lancée dans le métro de la capitale, soutenue par des membres du gouvernement conservateur. Le gouvernement Mitsotakis a en effet entrepris une politique nataliste face à la chute démographique du pays provoquant de fortes réactions et tensions avec les mouvements féministes du pays[11].
En Bulgarie, 70% de la population est attachée à l’avortement[12], possible jusqu’à 12 semaines sur demande de la femme et 20 semaines après accord d’une commission médicale. Le pays connaît l’un des plus hauts taux de recours à la pratique en Europe, ayant corrélativement l’un des plus faibles taux d’accès à la contraception[13].
La Suède autorise l’IVG jusqu’à la dix-huitième semaine et comme en Finlande et en Lituanie, elle ne prévoit pas de clause de conscience : les professionnels de santé ne peuvent refuser de pratiquer une IVG. En Estonie, Lettonie et Lituanie, l’IVG est autorisée jusqu’à la douzième semaine. Ce délai peut être allongé à la vingt-deuxième semaine pour raisons médicales ou pour les estoniennes âgées de moins de quinze ans. L’Estonie est d’ailleurs la plus encline à donner accès à l’IVG puisque les deux tiers des frais sont pris en charge, tandis qu’en Lettonie, la femme seule doit financer son avortement (sauf raisons médicales). De plus, la Lituanie n’a légalisé l’avortement médicamenteux qu’en 2023 et a déjà eu à débattre de projets de lois restreignant l’IVG, notamment en 2013 et en 2018[14].
L’accès au droit à l’avortement en Europe est donc extrêmement inégalitaire. D’un pays à un autre, l’IVG peut être considérée comme un tabou, un combat permanent ou un droit facilement accessible. Mais tous les Etats ont un point commun : l’IVG est toujours menacée par des mouvements anti-choix (article 4).
[1] Selon une étude commandée par la Médiatrice à l’égalité des genres en 2018.
[2] Intervention de l’association Brave sisters durant la table ronde « les droits sexuels et reproductifs en Europe sont-ils en danger ? » organisée par Choisir la cause des femmes à l’occasion des Rencontres féministes européennes, Nantes, 4 décembre 2023.
[3] Cour constitutionnelle de Croatie, 21 février 2017, Rješenje Ustavnog Suda Republike Hrvatske, broj: U-I-60/1991.
[4] 3%. Voir RICO Simon, « En Croatie aussi, avorter devient de plus en plus compliqué », RFI, 8 juin 2022.
[5] Intervention de Tonja Jerele durant la table ronde « les droits sexuels et reproductifs en Europe sont-ils en danger ? » organisée par Choisir la cause des femmes à l’occasion des Rencontres féministes européennes, Nantes, 4 décembre 2023.
[6] Voir Dr. NESTAKOVA Denisa, « four disturbing aspects to Slovakia limiting abortion access for Ukrainian women”, Heinrich-Böll-Stiftung European Union, 22 avril 2022 (https://eu.boell.org/en/2022/04/22/four-disturbing-aspects-slovakia-limiting-abortion-access-ukrainian-women).
[7] Voir LEDUC Marine et BIENVENU Hélène, « En Roumanie, l’accès à l’avortement encore plus entravé pour les femmes précaires », Le Courrier d’Europe centrale avec Le Courrier des Balkans, 19 mars 2021.
[8] Intervention de l’association Central FILIA durant la table ronde « les droits sexuels et reproductifs en Europe sont-ils en danger ? » organisée par Choisir la cause des femmes à l’occasion des Rencontres féministes européennes, Nantes, 4 décembre 2023.
[9] Voir BIENVENU Hélène, « En Pologne, des réfugiées ukrainiennes confrontées à l’accès restreint à l’IVG », Le Monde, 17 mai 2022 et « Nastya, la “fée ukrainienne de l’avortement” qui vient en aide aux réfugiées en Pologne », AFP et Le Point, 23 août 2023.
[10] Voir AMROUNI Charlotte et ORDONEZ Daniel, « Des centaines de Polonaises viennent en République tchèque pour avorter », Radio Prague International, 21 décembre 2021.
[11] Voir « La journée de l’enfant à naître provoque une tollé en Grèce », Courrier international, 3 janvier 2020.
[12] Selon une étude du Gallup International Association en décembre 2018.
[13] Selon l’European Parliamentary Forum for sexual & reproductive rights (EPF).
[14] Voir le Centre d’Action Laïque, Etat des lieux de l’avortement en Europe, 2019.
LA MENACE DES MOUVEMENTS ANTI-IVG
Ce tour d’horizon de l’état actuel du droit à l’IVG au sein des pays de l’Union européenne permet de mettre en lumière son importance politique. Tandis que les droits humains et fondamentaux sont internationalisés et inscrits dans des Conventions ou Chartes onusiennes et européennes, les Etat gardent encore le monopole du droit à l’avortement.
En effet, il mêle des intérêts religieux en concernant la détermination du commencement de la vie. Ainsi, les pays marqués par un recul d’accès à l’avortement sont ceux dont la religion principale est issue du catholicisisme : la Pologne, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, l’Italie etc… En effet, cette religion considère que « la vie humaine est un don de Dieu reçu en dépôt »[2], rendant son interruption délibérée incompatible avec la volonté divine. Le défin Pape Jean-Paul II qualifiait même « l’avortement provoqué [de] meurtre délibéré et direct »[1].
Religieux, les réseaux anti-IVG ou “pro-life” sont donc mondialement organisés et mènent une véritable guerre contre ce droit qui permet pourtant aux femmes d’accéder à une autonomie personnelle. Principalement financés par des fonds américains, russes et européens, ils ont pu récolter 707,2 millions de dollars sur la période de 2009 à 2018[3] leur permettant de mener des actions rapidement et efficacement. Comme l’explique Sarah Durocher, présidente du Planning familial, « nous avons mis 2 ans pour lancer notre tchat en ligne, les anti-IVG ont mis 2 mois »[4]. Dans leur « croisade pour la vie », ils appliquent donc une stratégie en trois temps : désinformer, intimider et agir en justice.
Dans un rapport publié le 17 janvier 2024, la Fondation des femmes présente la stratégie de désinformation anti-IVG comme ayant principalement lieu sur internet. En France, sur le référencement google, le deuxième tchat d’information sur l’avortement apparaissant après celui du planning familial est tenu par des anti-choix et vise à décourager les femmes d’avorter. Sur le média Instagram, un cinquième du contenu proposé sur l’IVG est dissuasif. Leur stratégie est d’autant plus dangereuse qu’elle est subtile : les sites ou associations se présentent au premier abord comme neutres mais divulguent de fausses informations pour in fine encourager les femmes à mener leur grossesse à terme. Ils désinforment sur les conséquences physiques et morales d’une IVG qui impacterait aussi bien la santé de la mère que la famille toute entière. Ce même stratagème se retrouve notamment en Croatie. Dans un témoignage donné au journal France24, une femme explique avoir obtenu des informations sur l’IVG en parcourant un site Internet à « l’aspect institutionnel » qui l’a, par la suite, orientée vers une association pour qu’elle soit « mise en lien avec une gynécologue ». Après l’entretien, elle est ressortie dans l’idée de garder l’enfant : « quand elle m’a demandé comment je me sentirais si je n’avais pas eu mes trois enfants, j’ai fini par changer d’avis ». Ainsi, l’une des personnes à la tête de cette association se réjouit « d’avoir sauvé 1 000 vies en 25 ans »[5].
En effet, dans certaines régions, il est difficile de trouver les bonnes informations. Par exemple, en Bavière, région à dominante catholique, trouver les adresses qui pratiquent l’IVG est presque impossible.
Les actions anti-IVG peuvent aussi être concrètes, dans les rues ou devant les lieux pratiquant l’avortement, visant à intimider le public. A Francfort comme en Croatie, des prières collectives sont organisées à Pâques et à la Toussaint, pendant un mois et demi, devant les bureaux des associations pratiquant une IVG[6]. Aux Pays-Bas, les murs des cliniques sont tagués de slogans « l’avortement est un assassinat » et des anti-choix interpellent les patientes et les médecins qu’ils traitent de meurtrier·èrs[7]. La récente autorisation italienne à ce que les militants anti-IVG entrent légalement dans les cliniques pourrait donc avoir de dangereuses répercussions.
Enfin, le réseau mène des campagnes politiques et juridiques pour gagner des voix et faire reculer les avancées féministes. En France, il apparait que la Fondation Lejeune a pour objectif principal de submerger le Planning familial de recours juridiques car, même s’ils perdent quasi-systématiquement, ils retardent tout de même le travail du Planning et la recherche scientifique autour de l’avortement. Les anti-IVG se saisissent aussi de tous les moyens légaux en leur possession, comme la possibilité d’adresser une initiative citoyenne européenne (ICE) à la Commission européenne. Dès l’entrée en vigueur de cette nouvelle démarche en 2012, un mouvement anti-IVG a présenté une ICE visant à supprimer l’aide financière pour le développement affecté aux soins de santé génésique. Leurs arguments se fondent sur le droit à la vie, même droit fondamental qui est employé par les mouvements pro-IVG pour défendre la vie de la femme enceinte. Ils retournent également des arguments féministes pretextant vouloir eux-aussi protéger la femme de la violence. A titre d’exemple, selon eux, la plupart des fœtus seraient de sexe féminin donc les « sauver » lutterait contre les menaces de l’avortement sélectif. Enfin, le gouvernement lui-même peut revendiquer son attache avec cette idéologie religieuse comme en Pologne, en Hongrie ou aux Etats-Unis sous le gouvernement Trump. En Espagne, le premier ministre Mariano Rajoy avait pour projet de limiter l’IVG en septembre 2014 mais s’était finalement abstenu face aux protestations féministes. En effet, c’est principalement grâce aux combats féministes que le droit à l’IVG peut perdurer.
Ainsi, le combat idéologique mené par les anti-choix a des répercussions sur l’accès aux droits de toutes les femmes de l’Union européenne. Ne pas pouvoir recourir à une IVG met en danger leur santé physique et psychique ne leur laissant pas le choix de mener leurs vies familiales comme elles l’entendent. En Europe, des femmes meurent encore des conséquences d’un refus d’avortement. Pour soutenir un accès sûr à ce droit, l’association slovène L’Institut du 8 mars, rejointe par un réseau d’associations féministes de plusieurs pays d’Europe, a soumis une initiative citoyenne européenne à la Commission afin que l’UE finance les soins liés à l’avortement[8]. Face à la menace qui pèse constamment sur le droit à l’IVG, il convient en effet de s’unir, se mobiliser et de rester solidaires à l’approche des élections européennes.
Ainsi, le combat idéologique mené par les anti-choix a des répercussions sur l’accès aux droits de toutes les femmes de l’Union européenne. Ne pas pouvoir recourir à une IVG met en danger leur santé physique et psychique ne leur laissant pas le choix de mener leurs vies familiales comme elles l’entendent. En Europe, des femmes meurent encore des conséquences d’un refus d’avortement. Pour soutenir un accès sûr à ce droit, l’association slovène L’Institut du 8 mars, rejointe par un réseau d’associations féministes de plusieurs pays d’Europe, a soumis une initiative citoyenne européenne à la Commission afin que l’UE finance les soins liés à l’avortement[8].
Face à la menace qui pèse constamment sur le droit à l’IVG, il convient en effet de s’unir, se mobiliser et de rester solidaires à l’approche des élections européennes.
[1] Voir KUIJPER Fiene Marie, Le Grand Continent, « l’avortement dans le monde après l’annulation de Roe v. Wade. Un état des lieux en 10 points », 7 février 2024.
[2] Conférence des évêques catholiques d’Angleterre et du pays de Galles rapportée dans CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/Royaume-Uni, n°2346/02, § 29.
[3] Voir l’étude de l’European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF), La partie émergée de l’iceberg, juin 2021, p.44.
[4] Intervention de Sarah Durocher durant la Conférence de la Fondation des femmes, « les mouvements anti-avortement : qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? », mercredi 17 janvier 2024.
[5] ALLEMANDOU Ségolène, « Croatie : je voulais avorter mais… », France 24, 25 juin 2018.
[6] ALLEMANDOU Ségolène, « L’IVG en danger au cœur de l’Europe », France 24, 25 juin 2018.
[7] « Droits à l’IVG : aux Pays-Bas, un raidissement conservateur et chrétien », RFI, 22 juin 2023.
[8] Pour vous renseigner ou signer l’ICE : https://www.myvoice-mychoice.org/