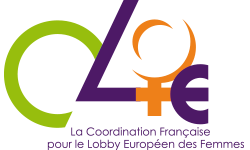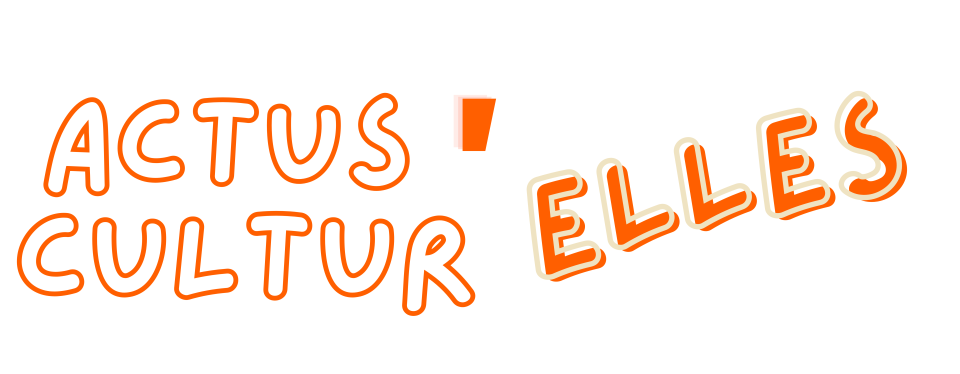Mardi de la CLEF #33 : Être une mère solo : La difficile conciliation des charges familiales et des charges financières.
4 avril, 2024
Manifeste pour une Europe féministe, juste et égalitaire en 2024 !
9 avril, 2024Revue de presse féministe & internationale du 30 mars au 5 avril

ARABIE SAOUDITE
Le pays préside la Commission pour les droits des femmes à l’ONU.
Mercredi 27 mars, l’Arabie saoudite a été désignée pour présider la Commission pour les droits des femmes de l’ONU pour une durée de deux ans. Sachant que le pays est classé 131ème sur 146 en ce qui concerne le respect des droits des femmes, selon un rapport du World Economic Forum intitulé « Global Gender Gap report » datant de juin 2023, ce choix a de quoi surprendre.
Depuis quelque temps, la situation des femmes et de leurs droits semble s’améliorer en Arabie saoudite. En effet, en avril 2016, le fils du roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud, avait lancé un grand plan de réformes appelé Vision 2030, avec la volonté de moderniser la société saoudienne. Les femmes étaient au cœur de ce plan, qui leur a progressivement décerné plus de droits. Il y a toujours des protestations, notamment de la part du clergé wahhabite qui s’oppose fermement à ces avancées, mais qui est en minorité au pouvoir.
Depuis, les femmes ont obtenu une série de droits : le droit de conduire, le droit d’étudier, le droit d’avoir un passeport, le droit de voyager, le droit de travailler sans l’autorisation de son mari, … Également, la mixité de l’espace public a été introduite, et le harcèlement au travail a été pénalisé. Cette évolution du droit a peu à peu porté la société toute entière et la sociologue Fawzia Al-Bakr considère que :
« La société saoudienne s’adapte graduellement à l’idée que les femmes sont des citoyens à part entière. C’est une adaptation difficile dans une société conservatrice comme la nôtre. Les jeunes générations le sont moins, cela crée des conflits intergénérationnels ».
On observe donc une nette amélioration des droits des femmes en Arabie saoudite depuis ces dernières années, pourtant la société, comme le système juridique et judiciaire, reste encore largement patriarcale. Amnesty International dans un rapport intitulé « Saudi Arabia: New Personal Status Law Codifies Discrimination Against Women », publié en mars 2023, revient sur la loi relative au statut personnel adoptée par le pays le 8 mars 2022, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce rapport très éclairant montre que :
« Bien qu’elle soit présentée par le prince héritier Mohammad bin Salman comme une avancée vers le progrès et l’égalité, la Loi relative au statut personnel ne respecte pas l’autonomie des femmes quant aux décisions concernant leur vie et celle de leurs enfants et elle perpétue la discrimination dont elles font l’objet »,
(Heba Morayef, directrice du bureau Moyen-Orient et Afrique du Nord).
En effet, cette loi est discriminatoire vis-à-vis des femmes qui n’ont pas les mêmes droits que les hommes dans un certain nombre de domaines, mais surtout dans la sphère privée, que ce soit au sein du mariage, dans le cadre du divorce, … Mais surtout, la loi refuse d’adresser frontalement la question des violences faites aux femmes. Même si elles gagnent des droits, elles restent néanmoins mineures face aux hommes de leur famille.
Ainsi, si l’ONU a fait le choix de laisser l’Arabie saoudite présider la Commission pour les droits des femmes afin d’encourager le pays à poursuivre ses avancées sociales vers davantage d’égalité et de liberté, on reste néanmoins en droit de questionner la stratégie et la légitimité de cette décision. En effet, il faut rappeler que cette décision permet de légitimer le pays sur la scène internationale en le présentant comme un acteur luttant pour les droits des femmes. Or, même si les évolutions sont notables, elles restent insuffisantes. Les femmes sont passées d’une certaine façon du statut d’objet à celui de mineur, et il aurait été à notre avis plus opportun de récompenser le travail de l’Arabie saoudite lorsque les femmes auraient obtenu le statut de sujet au même titre que les hommes. D’une certaine façon honorer le pays de ce titre à un stade préliminaire revient à se montrer satisfait de demi-mesures.
World Economic Forum, « Global Gender Gap Report », juin 2023.
Le Monde, « En Arabie Saoudite, le grand bond en avant des femmes », 16 avril 2023.
Amnesty International, « Arabie saoudite. La Loi relative au statut personnel inscrit dans la législation la discrimination à l’égard des femmes », 8 mars 2023.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Judith Tuluka Suminwa élue première ministre.
Judith Tuluka Siminwa, ancienne ministre du Plan, a été nommée Première ministre, le 1er avril 2024. C’est la première fois qu’une femme est à la tête du gouvernement en République Démocratique du Congo.
Au pouvoir depuis 2019, le président Félix Tshisekedi a récemment été réélu pour un second mandat de cinq ans, en décembre 2023. Il détient désormais 90% des sièges à l’Assemblée nationale, lui permettant de continuer sa politique sociale-démocrate vers la création de nouveaux emplois et de développement économique. Mais son premier ministre depuis 2021, Jean-Michel Sama Lukonde ne l’a pas suivi, déposant sa démission le 21 février 2024. Nommer Judith Tuluka Siminwa, Ministre d’Etat en charge du programme de développement local depuis presqu’un an, a été un « moyen de se défaire des pesanteurs politiques des chefs du parti », selon le directeur adjoint de la communication à la présidence, Giscard Kusema, pour Rfi. Il développe qu’étant à la tête d’aucun parti et donc « sans calculs politiques », elle serait, « a priori, prédisposée à se concentrer sur son travail comme cheffe du gouvernement ». Le président aurait aussi voulu « marquer l’Histoire » en nommant une femme première ministre pour la première fois : « Cette nomination vient couronner les combats de la femme congolaise et casser tous les préjugés négatifs sur la capacité des femmes à accéder à de hautes fonctions politiques. » Mais pour l’opposition, ce choix s’explique par le fait qu’elle ne pourra pas faire de l’ombre à Felix Tshisekedi. Proche collaboratrice du président sortant, elle représenterait une personne à qui il pourrait faire « porter le chapeau ».
Cette nomination prend place dans un pays « à l’agonie », comme en témoigne le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de la capitale Kinshasa. En effet, l’Est de la RDC est toujours plongée dans un contexte de conflit armé vieux de trente ans et la population toute entière fait face à une grande pauvreté. Bien que le Président souhaite en venir à bout, ses efforts sont encore vains. En prenant ses fonctions, Judith Suminwa Tuluka déclare vouloir œuvrer « pour la paix et le développement », consciente « de la grande responsabilité qui est la [sienne] ».
Judith Siminwa Tuluka représenterait aussi un espoir pour les femmes congolaises, notamment pour celles au cœur du conflit. « Elle connait les difficultés que la femme de l’Est traverse. La femme et la fille de l’Est sont violentées, la femme de l’Est est toujours marginalisée. Nous pensons vraiment qu’en tant que mère, qu’en tant que femme, elle aura un œil regardant à l’Est. », explique Marie-Noël Anatone, responsable de la société civile dans la province de l’Ituri, pour Rfi.
Evidemment, Judith Siminwa Tuluka n’est pas qu’une femme, ni qu’une mère. Âgée d’une cinquantaine d’années, elle est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et a longtemps travaillé pour le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Sa carrière politique au sein du gouvernement congolais est encore récente mais sûrement prometteuse.
La Croix, « RD-Congo : Judith Tuluka Suminwa, première femme à la tête du gouvernement », 2 avril 2024.
RFI, « Judith Tuluka Suminwa, Première ministre en RDC: un calcul politique du président Tshisekedi, les réserves de l’Eglise », 3 avril 2024.
EUROPE
Les conséquences genrées de l’externalisation des politiques migratoires de l’Union européenne.
En février 2024, l’ONG EuroMed Rights, un réseau de 68 organisations de défense des droits de l’homme basées dans une trentaine de pays différents de la région méditerranéenne, a publié un rapport intitulé « Analyse de genre de l’externalisation des politiques migratoires de l’Union européenne ». Ce travail d’analyse de fond est très intéressant car il nous permet de mieux comprendre les situations dangereuses auxquelles les femmes sont confrontées dans leur parcours migratoire, et de bien saisir la mesure de la responsabilité de l’Union européenne dans cette mise en danger.
En effet, il est essentiel de comprendre que ce parcours migratoire et les difficultés que rencontrent les personnes en situation de migration, ne sont pas dus au hasard mais aux politiques de prise en charge mises en place par l’Union européenne, qui porte donc une part de responsabilité. C’est pourquoi il est essentiel d’exposer la violence à laquelle ces personnes sont confrontées pour inciter autant que possible les institutions européennes à prendre en charge les personnes en situation de migration de la façon la plus humaine et respectueuse.
En externalisant les politiques migratoires, l’Union européenne essaye au contraire de s’éloigner autant que possible de la prise en charge de ces personnes, et donc d’une certaine façon de ne pas en porter la responsabilité. Parmi les pays, elle va notamment financer la Turquie, le Maroc et la Libye, pour que ces pays contiennent la migration, la bloque, pour que les personnes ne puissent pas avancer vers l’Europe. Mais, il y a plein d’autres pays qui reçoivent également des financements, on pense notamment à la Tunisie, dont la gestion inhumaine de la migration a été soulignée dans la presse au cours des derniers mois avec de nombreux cas de manquements au respect des droits humains fondamentaux.
L’externalisation accentue le processus de frontiérisation et de militarisation des frontières, or, comme l’expose le rapport, à l’exception du milieu universitaire, les politiques liées à la migration ne prennent pas en compte le facteur du genre. Or, en raison de leur sexe, les femmes vivent des situations de vulnérabilité de façon disproportionnée dans leur parcours migratoire. Premièrement, elles sont plus susceptibles de rester bloquées aux frontières, en situation d’immobilité forcée. On entend souvent que les hommes sont bien plus nombreux à traverser la Méditerranée et qu’ils constituent la majorité des personnes en situation de migration, mais le rapport d’EuroMed Rights souligne que la migration ne commence pas en Méditerranée, et que le fait que les hommes soient plus nombreux à arriver jusqu’à ce point est au contraire significatif de la complexité disproportionnée des femmes à entreprendre le parcours migratoire.
Par ailleurs, pour les femmes, le prix de la migration est celui de leur corps, elles le savent et c’est également ce qui les découragent parfois à entreprendre le voyage. D’autres n’ont pas le choix, viennent de zones de guerre où elles risquent la mort, et migrent donc seules, parfois enceintes et parfois avec leurs enfants. Elles subissent des violences sexuelles quasiment à chaque étape de la migration.
Prenons l’exemple d’une femme d’Afrique de l’Est cherchant à rejoindre l’Europe. Elle pourra essayer de passer par la Libye. Alors les financements européens directement versés aux milices locales pourront servir à la retenir prisonnière dans un camp de détention pour des raisons arbitraires et pour une durée inconnue. Si elle est enceinte et en besoin de soins médicaux, ils lui seront refusés et elle accouchera seule. Les gardiens pourront la violer autant qu’ils le souhaitent, qu’elle soit enceinte ou non, car ils ont tout pouvoir dans ces centres de rétention. En Libye, elle pourra également être capturée par des gangs et forcée à se prostituer dans ce que l’on appelle des « connection house ».
Si elle vient d’Afrique de l’Ouest, elle essayera peut-être de traverser la méditerranée à partir du Maroc pour aller en Espagne. Alors, comme l’a démontré Elsa Tyszler, elle se retrouvera probablement bloquée dans un des camps situés dans la forêt où elle attendra le bon vouloir des gardes de frontière qui se font appeler les « présidents » où on la fera chanter, faisant miroiter un passage contre des abus sexuels – passage qui n’arrive parfois jamais.
Si elle arrive jusqu’à la mer et qu’elle trouve un passeur, celui-ci exigera probablement des abus sexuels comme transaction en plus de coût financier pour le voyage. Une fois sur le bateau, si le passeur accepte de la prendre à bord après les violences, elle aura bien plus de chances de mourir noyée que les hommes de l’embarcation. En effet, les femmes voyagent souvent dans les cales avec les enfants, cales qui s’inondent rapidement, elles savent moins bien nager, elles sont plus lourdes enceintes, portent des vêtements amples et lourds, …
Un rapport sorti en 2021 de Tastsoglou a montré que les femmes se font tellement violées et violentées lors de leur parcours migratoire, et ce fait est tellement connu et su par les femmes qui, par manque de choix, se retrouvent dans l’obligation de migrer, que beaucoup se font mettre un implant contraceptif avant de partir afin de ne pas tomber enceinte pendant leur voyage.
Pour conclure, il faut rappeler que quitter son pays est un droit universel et fondamental attesté en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 13) ; que le droit de demander asile est un droit universel et fondamental attesté en 1951 par la Convention de Genève (article 18) ; et que le sauvetage en mer tombe sous le coup de l’obligation de prêter assistance du droit maritime attestée en 1982 par le Convention des Nations Unies signée à Montego Bay (article 98). L’externalisation des politiques migratoires n’a d’autre but pour les pays européens que de se soustraire au droit international et à leurs obligations. C’est refuser de porter la responsabilité de la prise en charge en la déléguant à des pays tiers.
Nous souhaitons également souligner que cette tendance à externaliser les politiques migratoires tend à camoufler la réalité de la prise en charge, car celle-ci est réalisée par des acteurs non étatiques. Les chercheurs et journalistes ont beaucoup de difficultés à obtenir des données brutes sur les centres de rétention, en Libye par exemple mais également dans d’autres pays, ils·elles travaillent donc beaucoup à partir de témoignages. Mais refuser à des personnes tierces de documenter la réalité de la prise en charge, c’est également refuser d’entendre sa responsabilité de façon à ne pas avoir à revoir les modalités de prise en charge.
EuroMed Rights , « Analyse de genre de l’externalisation des politiques migratoires de l’Union européenne », février 2024.
“Il est où le patron ?”, une BD engagée contre le sexisme dans le milieu agricole.
Dans une bande dessinée sortie en mai 2021 aux éditions Marabulles et illustrée par Maud Bénézit, cinq agricultrices d’Ardèche et du Briançonnais révèlent le sexisme systémique présent dans leur travail. Il est où le patron ? Chroniques de paysannes est une œuvre engagée et poignante, mettant en scène ce que les femmes subissent dans les coulisses du monde agricole.
Elles représentent un quart des chef·fes d’exploitations agricoles et 29% des actif·ves perment·es agricoles. Le terme « agricultrice » est entré dans le dictionnaire Larousse en 1961, soit il y a plus de soixante ans. Pourtant, certain.e.s tiennent encore ce même discours : « ce n’est pas un métier facile, faudra que tu trouves un compagnon pour t’aider ».
Pour les cinq autrices Marion Boissier, Fanny Demarque, Céline Berthier, Guilaine Trossat et Florie Salarnié, la banalisation de propos sexistes ne peut plus subsister. A cinq, elles ont alors créé leur propre collectif : les paysannes en polaire. Au fil des pages, elles transmettent leur colère maintenue bien au chaud, leur ras-le-bol collectif.
Coline : J’aime ce que je fais, mais parfois c’est usant de devoir se battre pour exister.
son mari : Bah ! T’exagères un peu quand même !
Coline : Pierre, ce n’est pas à toi qu’on demande tout le temps où est le patron !
son mari : Tu le prends trop à cœur, c’est juste une façon de parler.
Le projet de bande dessinée a germé en 2014 pour se concrétiser en 2017. Une histoire a alors vu le jour, tirée de leur vécu personnel et de témoignages de cinquante autres agricultrices. Bien que l’histoire soit fictive, les propos rapportés ont tous réellement été prononcés. L’objectif derrière l’œuvre collective : braver la difficulté de combattre contre le sexisme lorsqu’il est quotidien et sous couvert d’humour. Faire en sorte que les paroles comme « J’embauche que des filles, elles sont plus dociles et c’est plus agréable comme compagnie » ou « depuis le temps que j’embauche, mon fils n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. J’espère que toi tu sauras lui plaire ! », ne soient plus anodines mais percutantes. Transmettre, finalement, aux lecteur.rice.s, les « lunettes du féministes » que les trois personnages principales portent le long du récit.
Les retours positifs que les autrices ont pu recevoir confortent leur réussite. « Je suis très touchée par le nombre de témoignages qu’on a reçus. Ça consolide mes convictions : Si ! Ce qu’on a raconté, c’est vrai ! » (Céline Berthier, lors de la rencontre organisée par Odette & Co, oser au féminin). « On a l’impression d’avoir dénoncé le sexisme du milieu agricole mille fois, mais avec la BD ça passe mieux. Elle peut aussi inspirer d’autres personnes à montrer qu’on peut tous et toutes faire quelque chose face à ça, et qu’on n’est pas obligé.e.s de subir ou d’accepter. » (Marion Boissier pour TV5 Monde).
Dans ce milieu, les femmes font aussi face à de fortes inégalités salariales. Les cheffes d’entreprise ou d’exploitation agricoles déclarent avoir des revenus inférieurs de 30% à celui des hommes. L’apicultrice Marion Boissier explique ce chiffre à TV5 Monde comme étant issu d’une méfiance à l’égard des femmes lors de l’allocation d’un prêt : « la confiance en certains projets portés par des femmes seules est souvent moindre (…) alors qu’une transmission de père en fils se fera plus facilement car cela paraît plus habituel. » Cette situation est illustrée dans la bande dessinée lorsque la Maison de l’Agriculture doute du projet d’une des personnages voulant gérer une bergerie seule. Les bulles de BD relatent aussi que le travail des femmes n’est jamais valorisé voir n’est pas reconnu comme tel : « Et sinon ma chérie… Tu penses trouver un vrai travail bientôt ? Les abeilles, c’est sympa… mais… ça reste un hobby, non ? ». Fanny Demarque, bergère, rapporte la gravité des conséquences qu’engraine un tel sexisme ambiant : « Lorsque des violences surviennent dans leur couple, la plupart n’ont souvent d’autre choix que de rester car elles sont dépendantes économiquement de leur mari. Rares sont celles à avoir un capital puisque les fermes sont souvent au nom de l’homme. La transmission étant encore très patriarcale. »
Même si les planches de BD offrent une certaine légèreté au récit, ce dernier transmet une lourde réalité bien trop banalisée.
TV5 Monde, « Il est où le patron? : un BD qui défriche le sexisme dans l’agriculture », 29 janvier 2024.
Site du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, « Infographie – La place des femmes dans l’agriculture », 4 mars 2024.
Odette&Co Oser au Féminin, « Des paysannes en polaire et une dessinatrice », 5 janvier 2023.
L’autrice Maryse Condé nous a quittés dans la nuit du 1er au 2 avril 2024 à l’âge de 90 ans.
Née en 1937 dans une famille d’érudits en Guadeloupe, Maryse née Boucolon quitte les Antilles pour poursuivre des études de lettres à Paris. Après son premier mariage, elle s’installe en Guinée, au Ghana puis au Sénégal où elle élèvera ses quatre enfants et enseignera en tant qu’institutrice. En 1972, alors âgée de 35 ans, elle décidera de reprendre ses études et de poursuivre en thèse à l’Université de la Sorbonne. Plus tard, elle confiera au Monde, « J’ai compris que, si je n’arrivais pas à revenir à mes études, je ne m’en sortirais jamais ». Elle ne commencera qu’à publier ses écrits à l’âge de 39 ans, et achèvera une trentaine de livres de formes très variées : romans, pièces de théâtres, mémoires, livres pour enfants, essais… En 1984, son roman en deux tomes Ségou (Robert Laffont), peignant magnifiquement la chute du Royaume bambara au 19e siècle, lui vaudra sa renommée et le prix de littérature de la Nouvelle Académie en 2018. Pourtant, il lui vaudra aussi des critiques acerbes de certain.es intellectuel.les : « ils n’ont jamais accepté qu’une Antillaise, qu’une femme, se mêle de ce passé-là ». Devenue professeure de lettres à l’université de Columbia et directrice du centre des études françaises et francophones, elle transmettra dans ses œuvres son combat acharné contre le colonialisme.
Très inspirée par Le Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire, elle prend très tôt conscience du terme « colonialisé » et de sa propre internalisation de la culture française malgré elle. Sous sa plume, elle souhaite une Guadeloupe indépendante, elle cherche à comprendre ses origines « négro-antillaises » oubliée de sa famille (Le Cœur à rire et à pleurer, Robert Laffont) et la discrimination qu’elle a pu subir en raison de son identité. Elle l’exprimait ainsi par rapport à son autobiographie La vie sans fards (J.C. Lattès) : « [il] est peut-être le plus universel de mes livres. (…) Il ne s’agit pas seulement d’une Guadeloupéenne tentant de découvrir son identité en Afrique. Il s’agit d’abord et avant tout d’une femme (…) confrontée à ce choix capital et toujours actuel : être mère ou exister pour soi seule ». L’année dernière, Maryse Condé se confiait également à La Déferlante sur les préjugées qu’on lui a inculqués enfant : « une femme m’avait dit un jour : ‘Les gens comme nous n’écrivent pas.’ Il y avait un problème, mais je ne savais pas ce que c’était : le fait d’être une femme ou la couleur ? C’était les deux à la fois ».
L’autrice a le don de décrire le colonialisme et le chaos du postcolonialisme « dans un langage précis » (comme exprimé par la Nouvelle Académie lors de la remise du prix à Stockholm). Dans son roman Moi, Tituba sorcière noire de Salem (Gallimard), elle aborde aussi le thème de l’esclavage et de la domination. Elle y dresse le portrait de Tituba, une esclave du pasteur de Salem accusée injustement de sorcellerie. Pour l’historienne Françoise Vergès (TV5 Monde) : « c’est vraiment une femme qui savait ce que voulait dire d’être une femme noire née en Guadeloupe et quel était le lien avec l’Afrique. Mais aussi ce monde qu’on dit le monde atlantique, qui a été ce monde de traversées, de circulations et de déportations ». La France lui doit aussi la Journée nationale de commémoration de l’esclavage, instaurée en 2006 sous l’impulsion du Comité pour la mémoire de l’esclavage qu’elle présidait.
Ainsi, l’héroïne n’existe pas uniquement sur la pointe de la plume. La réflexion personnelle et humaniste de Maryse Condé restera gravée dans ses œuvres éternelles.
TV5 Monde, « Maryse Condé : mort d’une autrice à l’oeuvre humaniste et universelle », 2 avril 2024.
Le Monde, « L’écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé est morte », 2 avril 2024.
FranceInfo, « Mort de Maryse Condé : la grande autrice francophone en sept oeuvres majeures », 2 avril 2024.