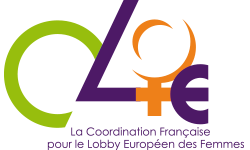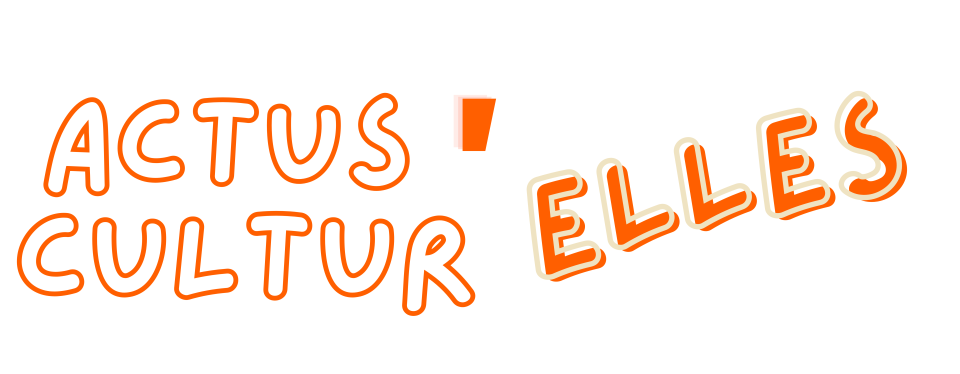APPEL À MANIFESTER – Le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, manifestons contre toutes les violences sexistes et sexuelles !
10 novembre, 2023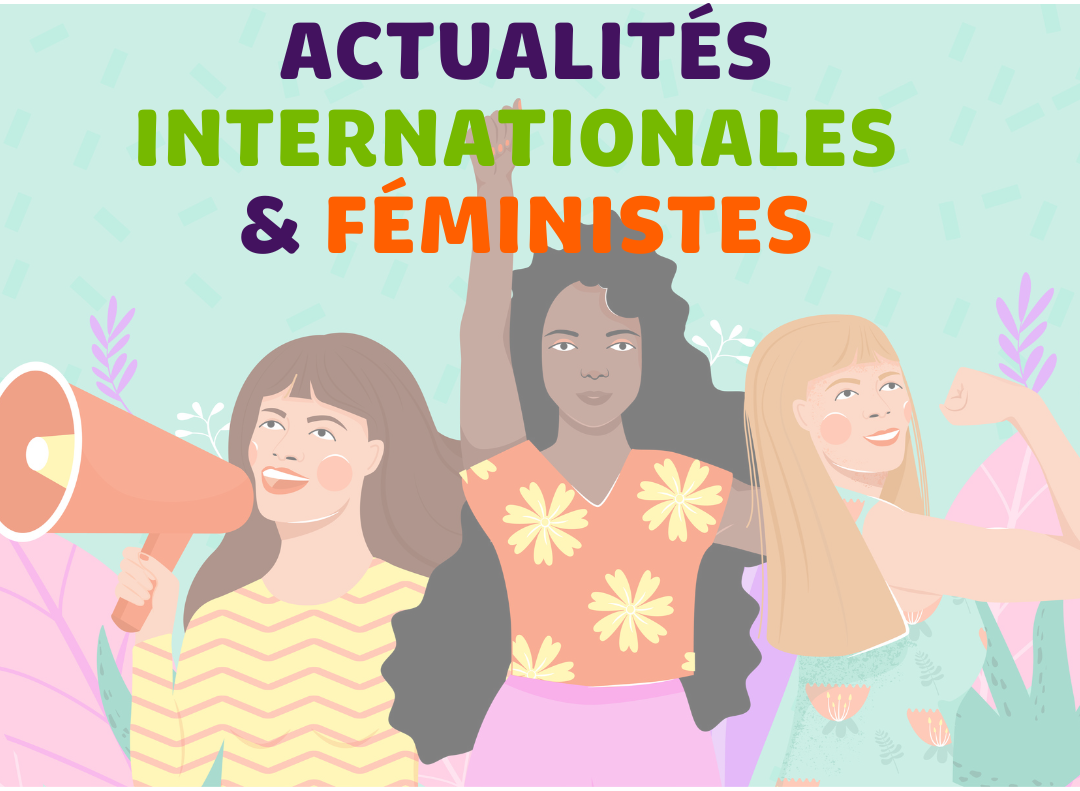
Revue de presse féministe & internationale du 10 au 17 novembre
17 novembre, 2023Revue de presse féministe & internationale du 3 au 10 novembre
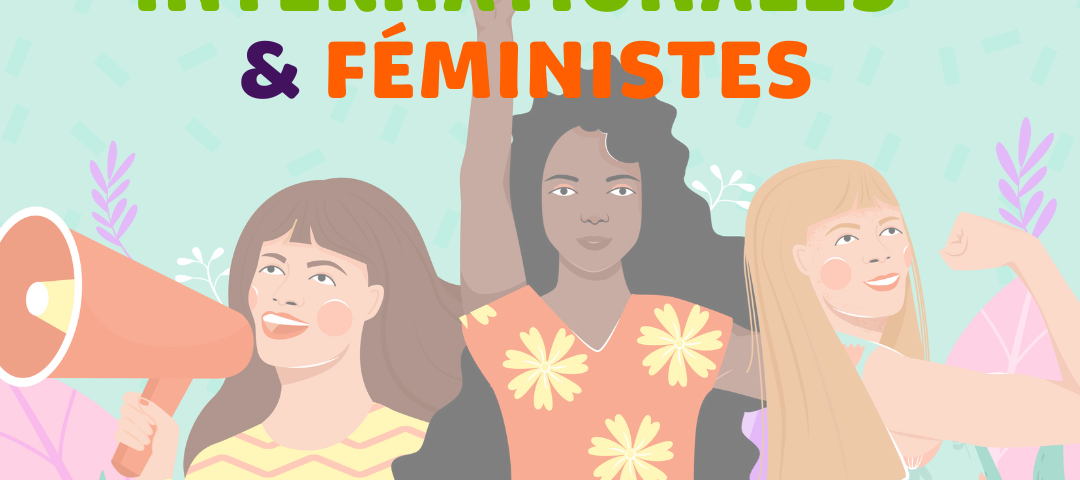
FRANCE
Le 6 novembre, 11h25.
Ce lundi 6 novembre 2023 à 11h25, les femmes commencent à travailler « gratuitement ». C’est ce que soutient le média féministe Les Glorieuses qui sort chaque année un hashtag avec la date et l’heure à laquelle les femmes ne sont symboliquement plus payées. Mais que veulent réellement dire ces chiffres ?
Commençons par le pourcentage utilisé pour effectuer le calcul de la date. Pour cette étude, Les Glorieuses ont utilisé l’écart de salaire de 15,4% entre femmes et hommes à temps de travail identique. Ceci leur a permis par la suite de rapporter cet écart à un nombre de jours de travail ouvrés puis de le rapporter à l’année en cours pour atteindre le 6 novembre. Toutefois il existe deux autres pourcentages, qu’elles mentionnent dans leur article. Le premier, 24% d’écart, relève des différences de temps de travail annuel dans le secteur privé. Ceci vient notamment du fait que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes. En effet, en 2020, 27,4% des femmes en emploi étaient à temps partiel tandis que ce n’était le cas que pour 8,4% des hommes. Le deuxième, relevant de l’écart de salaire entre hommes et femmes à post identique et temps de travail identique descend quant à lui à 4%. Toutefois ce pourcentage nettement plus petit ne permet pas de mettre en lumière les inégalités inhérentes au marché du travail sur lesquelles nous reviendrons plus tard.
Dans ces 15% ne sont pas comptés les temps partiels au moment T mais sont en revanche comptés les arrêts de travail ou temps partiels demandés par une femme au cours de sa vie. Le congé le plus courant est le congé maternité, toujours plus long que le congé paternité en France. A cette période, les patrons ne peuvent pas licencier la salariée, mais elle n’est pas non plus en mesure de continuer à monter dans la hiérarchie. C’est également par la suite qu’elle demandera certainement à moins travailler. Pourtant, ce sont bien la flexibilité et la capacité à faire de longues heures de travail qui intéressent les grandes entreprises que Claudia Goldin nomme « cupides » et qui proposent les plus hauts salaires. Or ces disposition sont majoritairement masculines, les femmes ont moins de chance d’être promues (théorie du plafond de verre), d’autant plus que les promotions arrivent le plus souvent à l’âge où elles commencent à enfanter. C’est notamment la raison pour laquelle il est plus difficile, dès l’embauche, d’intégrer une telle entreprise : les employeur·es verront en la femme une perte de profit et une opportunité gâchée d’avoir quelqu’un capable de modeler ses heures de travail à leur guise. Toutefois une grande partie du problème vient également de l’inégale répartition des emplois sur le marché du travail des salaires liés à ces emplois. Les métiers du care, majoritairement féminins, sont le plus souvent sous-payés. Ainsi, bien que les métiers de soignant·e, de personne de ménage ou d’infirmier·ère soient payés également pour les femmes et les hommes, le pourcentage de femmes y étant plus élevé, il est normal que sur le calcul global, on arrive à la conclusion que les femmes gagnent moins. En effet, deux tiers des travailleur·euses au SMIC sont des femmes. Cependant, ce qui ne ressort pas de cette étude, c’est que les femmes noires et les femmes handicapées, souvent relayées à ces métiers dévalorisés, font face à une inégalité double. Ainsi, selon le webzine Madmoizelle, les femmes noires commenceraient à travailler gratuitement, en moyenne, en juin. Aucune étude scientifique n’est réellement faite sur la question car en France, il est interdit de faire des statistiques ethniques, se heurtant au « principe d’égalité des citoyens », bien que cela pourrait permettre d’atteindre au contraire une meilleure égalité. Pour ce qui est des femmes handicapées, aucune donnée genrée n’est disponible sur la question du travail.
Le 6 novembre à 11h25 ne concerne donc pas les femmes individuellement, car beaucoup d’entre elles ne remarquent pas de différence de salaire avec leurs collègues masculins. C’est plutôt une critique de la société dans son ensemble, ne traitant pas encore correctement des faits qui ne devraient pas avoir d’impact sur le travail des femmes : grossesse, garde des enfants, ethnie. Pour pallier cela, Les Glorieuses proposent dans leur article trois nouvelles politiques publiques. La première repose sur le principe d’éga-conditionnalisté, revenant à conditionner l’accès aux marchés publics et l’obtention de subvention pour œuvrer au respect de l’égalité salariale au sein de l’entreprise. La deuxième serait de revaloriser les salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses, donc notamment les métiers du care. Finalement, elles soutiennent l’idée d’un congé parental équivalent pour les deux parents afin que la parentalité ne pèse plus uniquement que sur la femme. En effet, si les hommes commencent eux aussi à prendre des congés à la naissance d’un enfant, alors la société capitaliste sera dans l’obligation d’ajuster ses besoins.
Finalement, une meilleure égalité des salaires pourrait, selon elles, faire baisser les différents types de violences et notamment les violences économiques. En effet, selon leur dernière enquête, 41% des femmes ayant déjà été en couple ont connu au moins une fois des violences économiques, que ce soit par l’interdiction d’accès à son compte bancaire ou le fait de dépenser autant que son ou sa partenaire alors que la personne gagne plus. Ces violences, qui pourraient commencer à se résorber si les écarts de salaires étaient moins élevés, entraînent d’autres problèmes tels que la dépendance économique. Dans certains cas, les femmes ne peuvent pas quitter leur conjoint violent, car elles sont économiquement dépendantes à celui-ci. Il est alors important de regarder les fondements de la société et des inégalités afin de pouvoir gérer des problèmes qui, de prime abord, n’ont pas de lien direct. En France, les violences conjugales ne diminuent pas, tout comme l’écart salarial qui reste au-dessus de 15%. Pourtant l’Europe, depuis 2006, est dans une diminution constante de l’écart salarial. Ceci ne va pas en s’améliorant au vu des réformes mises en place par le gouvernement telles que la réforme des retraites, faisant travailler les femmes plus longtemps car beaucoup n’ont pas cotisé pendant une partie de leur vie, les rendant d’autant plus vulnérables à une forte précarité.
Il semble donc nécessaire d’emboiter ce calcul au sein d’autres afin d’en voir sa véritable valeur sociale. Toutefois il reste indispensable à la bonne transmission du message: l’emploi de biais numériques et mathématiques transformés en un slogan impactant permet de choquer. Une telle date, ça ne s’oublie pas.
INSEE, « Dans le secteur privé, l’écart de salaire entre femmes et hommes est d’environ 4 % à temps de travail et à postes comparables en 2021« , 2021.
Huffington Post, « Lundi 6 novembre à 11h25 : pourquoi les femmes travaillent « gratuitement » à partir de ce moment », 6 novembre 2023.
L’insoumission, « PEn 2023, à partir du 6 novembre à 11h25, les femmes travaillent gratuitement », 6 novembre 2023.
ALLEMAGNE
Les agressions sexuelles comprises dans la définition nationale de crime de guerre.
Mercredi 1er novembre, le gouvernement de centre gauche allemand a approuvé la proposition de loi du ministère de la Justice visant à élargir la définition des crimes de guerre aux agressions sexuelles, esclavage sexuel et avortements forcés.
Comme le remarque la ministre fédérale de la Famille, Lisa Paus, « les violences sexuelles, avant tout contre les femmes, ont longtemps été utilisées dans les guerres du monde entier et par les terroristes comme une arme tactique ». Bien que les viols de masse aient été largement utilisés durant la Seconde guerre mondiale, il a fallu attendre la fin des années 1990 et la résolution du conflit en ex-Yougoslavie puis au Rwanda pour que les agressions sexuelles et plus spécifiquement le viol soit enfin étudiés comme « arme de guerre » par la communauté internationale. Définies comme « tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui sous l’emprise de la coercition » par le Tribunal pénal International du Rwanda dans le jugement Akayesu de 1998, les agressions sexuelles peuvent désormais être considérées comme partie intégrante d’une stratégie militaire.
Les agressions sexuelles sont alors qualifiées internationalement de crime de guerre par le Statut de Rome, créateur de la Cour Pénale Internationale (CPI), dès 1998. Ce crime est d’une importance universelle puisqu’il envisage tout agissement contraire au droit humanitaire – aussi appelé droit de la guerre – régi par les quatre Conventions de Genève de 1949. Ainsi, bien qu’aucun conflit armé n’ait actuellement lieu sur le territoire allemand, l’Allemagne peut être amenée à statuer sur la commission d’un crime de guerre en raison de sa compétence universelle. En effet, même en l’absence totale d’un lien de rattachement avec l’État (par la nationalité de l’auteur·ice ou la commission du crime sur le territoire national), une personne étrangère ayant commis un crime de guerre peut voir sa responsabilité pénale engagée devant une juridiction allemande.
Dans ce pays, les crimes de guerre sont donc pratiquement toujours envisagés sous cette compétence-ci. Ce nouveau projet de loi visant à élargir leurs définitions, désormais déposé devant le Parlement, est d’autant plus intéressant que son utilisation est plus courante que dans les autres Etats. En effet, l’Allemagne est pionnière de la lutte contre l’impunité des crimes internationaux en Europe et est à ce jour le seul pays à disposer d’un code des crimes internationaux à part entière (entré en vigueur en 2002).
Ainsi, elle souhaite encore une fois montrer l’exemple en incluant les agressions sexuelles, l’esclavage sexuel et les avortements forcés à sa définition nationale de crime de guerre. En avril 2019, l’Allemagne souhaitait déjà combattre les agressions sexuelles, utilisées comme armes de guerre, en facilitant l’accès des victimes à leurs droits sexuels et reproductifs. Cependant, sa proposition de résolution devant le Conseil de sécurité de l’ONU a été vidée de sa substance par la Chine, la Russie et les Etats-Unis.
La communauté internationale n’est donc pas si disposée à avancer vers une meilleure prise en charge des victimes de violences sexuelles en temps de guerre. Même le viol, infraction qui amène pourtant le plus au concenssus, reste difficilement retenue lors des procès internationaux. Cette proposition de loi allemande, bien que nationale, pourrait être un très bon exemple pour une meilleure incrimination de ce phénomène malheureusement mondialement connu.
France Info, « L’Allemagne veut poursuivre les violences sexuelles dans les zones de conflit comme des crimes de guerre », 1er novembre 2023.
UNIL, « La reconnaissance du « viol comme arme de guerre » : intérêts, réflexions et limites », 11 octobre 2021.
Le Monde, « L’ONU vote une résolution pour combattre le viol comme arme de guerre, en la vidant de sa substance », 24 avril 2019.
ÉTATS-UNIS
Les citoyen·nes de l’Ohio inscrivent le droit à l’IVG dans leur Constitution.
Mardi 7 novembre, les électeur·ices de l’Etat de l’Ohio ont voté pour inscrire le droit à l’IVG dans la Constitution. A un an de la présidentielle américaine, cette victoire représente une étape importante du combat pour les droits reproductifs des femmes, thème central des élections de 2024.
Mardi, les citoyen·nes de l’Ohio étaient appelé·es à voter sur le droit à l’avortement, grandement menacé dans cet Etat. En effet, après l’annulation par la Cour Suprême de l’arrêt Roe v. Wade aux Etats-Unis en 2022, l’Etat avait adopté une loi très restrictive sur l’IVG. Le texte interdisait tout avortement (y compris en cas de viol ou d’inceste) dès qu’un battement de cœur pouvait être détecté, soit avant la sixième semaine. Cette loi avait choqué le pays entier après qu’une fille de 10 ans, violée, s’était vu refuser un avortement. Depuis, le texte avait été suspendu par la justice.
L’amendement de la Constitution, connu sous le nom de Issue 1, et soumis au vote mardi, s’oppose totalement à la législation ultra restrictive de l’Ohio. Il consacre en effet la protection du droit de chaque individu à prendre ses propres décisions en matière de droits reproductifs, notamment sur l’IVG et la contraception. L’Etat pourra donc interdire l’IVG seulement après 23 semaines, quand le fœtus est viable hors de l’utérus de la mère. L’inscription de cet amendement dans la Constitution a été votée à une majorité confortable, et représente une victoire importante du mouvement pro-choix, qui a milité pour protéger le droit à l’IVG contre les attaques des républicains, qui s’intensifient depuis l’annulation de Roe v. Wade l’année dernière.
Les camps démocrate et républicain ont mené une campagne de longue haleine pour convaincre les électeur·ices de voter pour ou contre cet amendement crucial. Des moyens financiers et humains conséquents ont été engagés, et les groupes démocrate et républicain nationaux ont investi cette campagne, qui était un moyen pour eux d’évaluer si la colère des électeur·ices après Roe v. Wade pourrait aider les démocrates lors des élections présidentielles et législatives de l’année prochaine. Le droit à l’IVG est en effet un enjeu central de la future présidentielle, et aucun des deux camps ne semble prêt à un compromis. La nomination de Mike Johnson en tant que speaker de la Chambre des représentants la semaine dernière, connu pour ses vues anti-IVG, le montre. De son côté, le président Joe Biden s’est félicité du résultat électoral en Ohio : « Les électeurs de l’Ohio et dans tout le pays ont rejeté les tentatives des élus républicains d’imposer des interdictions extrêmes de l’avortement, qui mettent en danger la santé et la vie des femmes (…) ».
Le droit à l’IVG était également au centre de plusieurs autres élections régionales cette semaine. Dans l’Etat du Kentucky, aussi très conservateur, le démocrate Andy Beshear, dont la campagne insistait sur le droit à l’avortement, s’est fait réélire. Un espoir de plus pour les mouvements pro-vie souhaitant adopter des mesures similaires en 2024 dans des Etats non-démocrates, comme l’Arizona, le Dakota du Sud, le Missouri et la Floride.
New York Times, « Ohio Vote Continues a Winning Streak for Abortion Rights« , 7 novembre 2023.
Le Monde, « Le droit à l’avortement, l’étendard électoral gagnant des démocrates américains« , 8 novembre 2023.
Huffington Post, « États-Unis : L’Ohio approuve la protection du droit à l’avortement, victoire retentissante des pro-IVG« , 8 novembre 2023.
FRANCE
Des mères à la rue, l’augmentation de la précarité en Ile-de-France.
Chaque jour, 1500 demandes d’accès au logement d’urgence sont déclinées. Dans le lot, environ 1100 familles, avec des enfants de tous âges. Véronique Boulinguez, sage-femme volante, apportant les premiers soins obstétricaux aux femmes sans domicile fixe, souligne qu’en une année, elle a eu le malheur de compter 300 femmes enceintes dans les rues de la capitale.
Véronique Boulinguez a un emploi unique en France inventé en 2016 par la mairie de Paris. Elle parcourt les rues de Paris et des banlieues à la recherche de futures mères ou d’enfants en très bas âge pour leur proposer des soins. Elle précise que ces femmes ont souvent demandé de l’aide au SAMU social qui n’a pu leur fournir une chambre que pour une nuit ou deux avant de devoir les renvoyer dans la rue. Pour ce qui est des logements d’urgence, une liste de personnes prioritaires a été mise en place face à la sur-demande : les femmes accompagnées d’enfants de plus de trois mois sont derrière les femmes victimes de violences, les femmes enceinte et les femmes avec des enfants de moins de trois mois. Sachant qu’il est déjà difficile de trouver une chambre pour la première catégorie, il suffit d’imaginer ce qu’il en est pour la dernière. Chaque jour, c’est entre 30 et 40 femmes qui appellent le 115 sans réponse fructueuse. Ainsi, les 1500 places de logement réservées aux femmes enceintes ou venant d’accoucher ne suffisent pas, le système étant saturé, ce qui signifie qu’elles doivent se débrouiller dans un environnement hostile et avec des enfants.
Ayant, pour la plupart, quitté un environnement violent, que ce soit des violences conjugales ou risques de violences et mutilations sexuelles dans leur pays d’origine, les femmes migrantes retournent dans une nouvelle situation de violence une fois en France. Bien qu’il n’existe pas d’étude précise sur la question, il est possible de dire qu’environ une SDF sur trois est agressée sexuellement et ce, sans compter les récidives ou la prostitution. « Leur non-existence légale en fait des proies pour les agresseurs » (Quentin Le Maguer, responsable du CHU du SAMU social de Paris). Ainsi, 26% des demandeuses d’asile interrogées par la revue The Lancet, disent avoir été victimes de violences sexuelles dans les 12 derniers mois sur le territoire français. Certaines femmes se retrouvent même enceinte à la suite de ces violences qui ont eu lieu en France ou durant leur voyage.
Le souci est que pour accéder à une maternité, il faut la plupart du temps s’inscrire sur internet, accès que les femmes SDF n’ont pas. En outre, une fois les premiers mois passés, il devient très compliqué d’entrer dans une maternité, les places étant limitées. Elles sont donc souvent redirigées vers des maternités privées qu’elles ne peuvent pas payer. Il en est de même pour l’accès aux plus de 1000 centres français de la Protection Maternelle et Infantile, qui proposent des soins pour la mère et pour l’enfant gratuitement, mais pour lesquels l’inscription se fait sur internet, ne laissant pas ou peu de place pour les femmes qui ne peuvent pas prendre rendez-vous. C’est pourquoi le travail de Véronique Boulinguez est si important pour les femmes SDF, elles voient en elle un espoir de trouver un abri, une aide, ne serait-ce que psychologique. Malheureusement, la sage-femme venant elle-même d’un centre de PMI ne peut rien faire face à une demande aussi conséquente. Au début de sa profession, lorsqu’elle trouvait une femme enceinte dans la rue, elle prévenait tout de suite sa direction et lui trouvait un logement. Aujourd’hui, le nombre de femmes enceinte est tellement élevé et le nombre de places si bas que cela n’est plus possible. Elle est donc dans l’obligation de laisser parfois des bébés nés prématurés dans le froid de la nuit, les services de néonatalité coûtant trop cher aux mères sans couverture santé.
En réponse à ce manque de place dans les centres d’hébergement et le danger de la vie dans la rue avec un bébé, certaines femmes occupent des lits des hôpitaux, restant jusqu’à 70 jours après leur accouchement (le temps habituel étant de deux à quatre jours). C’est notamment le cas à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, qui est obligé de refuser des femmes enceintes par manque de lit disponible. Cette occupation a démarré à la fermeture du centre temporel d’accueil qui avait été installé à côté de la maternité pour permettre aux femmes dans la précarité de rester avec leur enfant après l’accouchement. Ce centre n’a malheureusement duré que quelques mois, laissant les nouvelles mères sans lieu où aller. Pour cause, la Seine Saint-Denis est le département comptant le plus de personnes pauvres de France, avec pourtant peu de moyens pour les accueillir convenablement, les logements d’urgence étant très mal répartis. Toutefois, des solutions sont proposées avec par exemple un nouveau plan de construction de logements d’urgence évoqué par le président du département. Une autre possibilité, cette fois-ci étatique et proposée par Véronique Boulinguez, serait de développer des partenariats entre les hôpitaux et les associations d’aides aux femmes enceinte afin de mutualiser les ressources d’une maternité et d’un accueil de jour, ce qui permettrait de réduire les inégalités sociales de la santé. Ceci ne semble malheureusement pas près d’évoluer en 2024 dans la mesure où les propriétaires de logements sociaux préfèrent rénover leur logement pour accueillir les spectateurs des prochains Jeux Olympiques, prêts à payer beaucoup, plutôt que des familles en situation de précarité.
Libération, « «Tous les soirs, on les laisse dehors» : à Paris, une «sage-femme volante» au secours des femmes enceintes sans abri », 3 novembre 2023.
Femmes de Santé, « Véronique Boulinguez ».
Actu.Fr, « »On est devenu un centre d’hébergement d’urgence » : cri d’alarme à la maternité Delafontaine », 6 novembre 2023.
Chelsie Hill, danseuse en fauteuil roulant.
Ancienne championne de danse, Chelsie Hill a fait de sa passion sa force pour se reconstruire après un accident qui l’a rendue invalide. Aujourd’hui, avec son groupe des Rollettes, elle offre un espace de sororité à toutes les femmes et filles handicapées.
La vie de Chelsie Hill, qu’elle soit en fauteuil roulant ou non, a toujours tourné autour de la danse. Dès l’âge de 5 ans, elle participe – et remporte – des compétitions de danse aux Etats-Unis. Adolescente, elle veut devenir danseuse professionnelle. Au lycée, elle fait partie de l’équipe de danse populaire des Breaker Girls. Son avenir semble tout tracé. Mais en 2010, à l’âge de 17 ans, Chelsie est impliquée dans un grave accident de voiture avec un conducteur ivre. Elle se réveille à l’hôpital, sans l’usage de ses jambes.
« La danse reste la danse, que l’on marche ou que l’on roule ! »
Malgré tout, après plusieurs mois de convalescence, la jeune fille se remet petit à petit à la danse avec le groupe des Breaker Girls, grâce à son père qui leur ramène des chaises roulantes. Néanmoins, Chelsie Hill a du mal à accepter sa nouvelle vie en tant que femme handicapée. En 2012, deux ans après son accident, elle fonde les Rollettes, un groupe de danse uniquement pour les femmes et les filles en fauteuil roulant. Elle explique avoir créé cette équipe pour rencontrer des filles « comme elle ». Grâce à cette communauté qui lui ressemble et la comprend, Chelsie se réapproprie son histoire de danseuse et de femme handicapée. Aujourd’hui, onze ans après la création du groupe, les Rollettes est devenue un véritable espace de soutien pour les femmes avec un handicap dans le pays. Cet été, les Rollettes ont organisé leur événement annuel « Rollettes Experience », qui promeut l’autonomisation des femmes et des filles handicapées. A cette occasion, plusieurs centaines de femmes et d’enfants se sont rassemblé·es à Los Angeles autour de cours de danse. Chelsie a en effet déménagé à Los Angeles pour poursuivre son rêve de toujours, celui de devenir danseuse professionnelle.
En parallèle, Chelsie Hill est engagée dans la défense des droits des personnes handicapées. En 2018, avec les Rollettes, elle a lancé la campagne « We Are Boundless » (Nous n’avons pas de limites). Toujours à travers la danse, elle transmet des messages inspirants visant à déconstruire les préjugés autour des femmes en fauteuil roulant. Le message est clair : leurs rêves, leurs objectifs, leur capacité vont au-delà de leur condition physique. En 2019, Chelsie et les Rollettes lancent une nouvelle campagne intitulée « We Can Together » (Nous pouvons ensemble). Elle célèbre la force de l’unité face aux limites qu’on nous impose.
Jejune Magazine, « Chelsie Hill – Dance Is Dance », 16 août 2022.
New York Times, « When a Dancer’s Moves Include a Wheelchair », 9 novembre 2023.
Documentaire – Toutes Musclées
La série documentaire d’Arte retrace les batailles passées et actuelles menées par les femmes dans le monde du sport, qui reste un bastion du sexisme dans notre société.
Le documentaire, réalisé par Camille Juza, revient sur le long combat, malheureusement toujours actuel, des sportives françaises. Il peut d’ailleurs se résumer à une seule phrase, celle de l’historienne Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, « L’histoire des sportives, c’est l’histoire d’un combat permanent ». De grands progrès ont été accomplis depuis plusieurs siècles, quand les femmes étaient totalement exclues de la pratique du sport. Les Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu l’été prochain, sont en effet les premiers à respecter une stricte parité entre sportives et sportifs. Pourtant, le sport reste un domaine où l’égalité femmes-hommes est loin d’être atteinte.
Le documentaire revient d’abord sur l’émergence des femmes dans le milieu sportif, un monde alors fait par et pour les hommes. La réalisatrice se base sur de nombreuses images d’archives ainsi que sur l’expertise d’historiennes et de chercheuses. Entre la fin du XIXème siècle et le XXème, les femmes ne sont pas les bienvenues dans ce monde masculin qui prône la virilité. Les sportives doivent se différencier des hommes et sont autorisées à pratiquer un sport sous condition de modération, de discrétion, et surtout d’esthétisme. Quelques dates marquent les esprits. En France, les femmes ne sont pas autorisées à pratiquer le lancer de marteau avant…1987. Aux Jeux Olympiques, le 800 mètres femmes est interdit entre 1928 et 1960.
Le documentaire aborde également les injonctions patriarcales, souvent contradictoires, voire absurdes, qui reposent sur les femmes sportives : elles doivent être performantes, puissantes, tout en gardant une certaine féminité. En effet, le corps des femmes musclées clashe avec les représentations de la féminité imposées par le patriarcat. Plusieurs sportives et personnalités, à l’instar de l’ancienne footballeuse Nicole Abar, témoignent des commentaires sexistes qu’elles reçoivent sur leur physique : « Un mec ne veut pas d’une fille trop musclée », « Tu es un garçon manqué »… Le cas emblématique de l’athlète sud-africaine Caster Semenya, sur lequel revient le documentaire, le montre.
Une série documentaire indispensable, qui nous montre à tou·tes les discriminations que subissent encore les femmes dans le monde du sport, où la présence égale des deux sexes à tous les niveaux reste loin d’être atteinte. Parce que l’histoire des sportives, c’est l’histoire d’un combat permanent, qui continue aujourd’hui…
Retrouvez le documentaire sur Arte : cliquez ici.