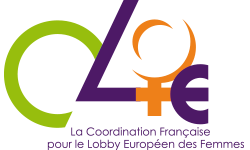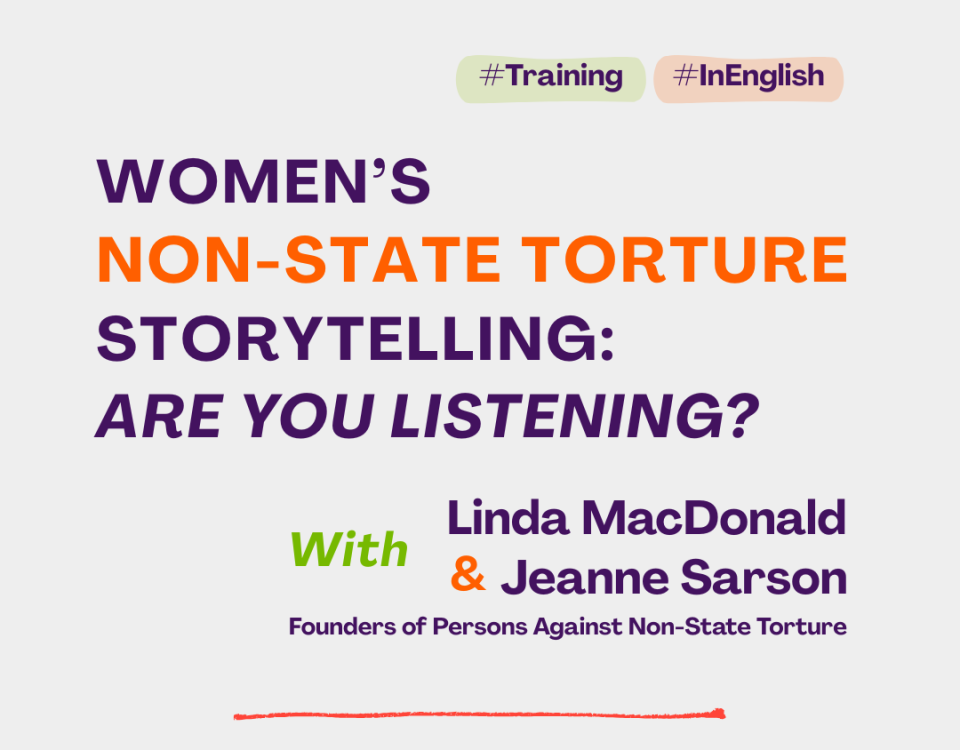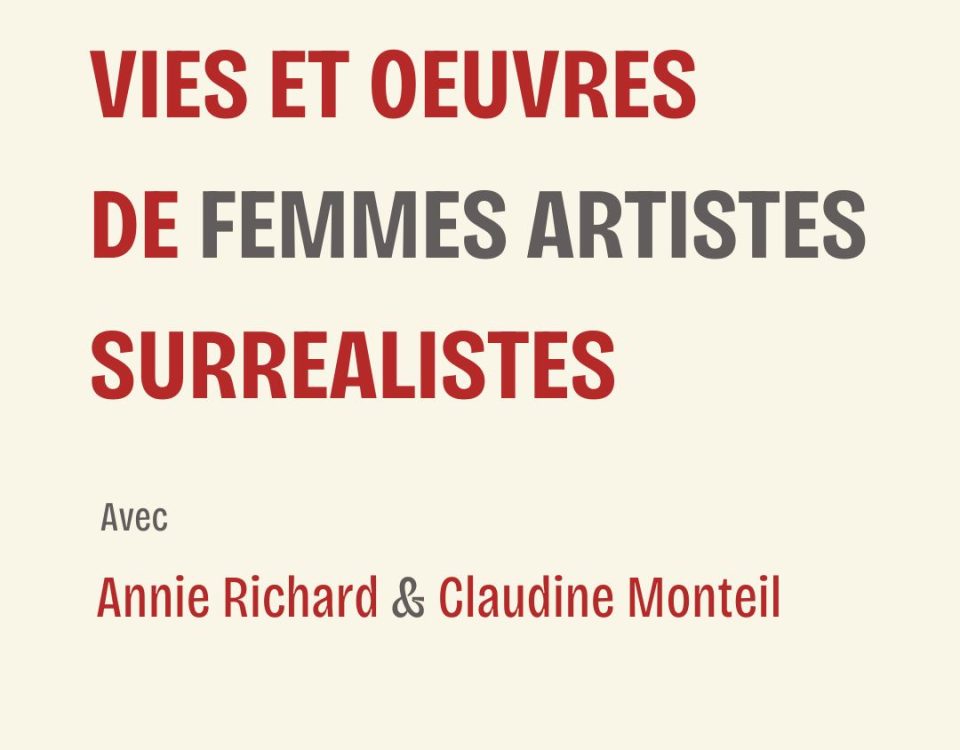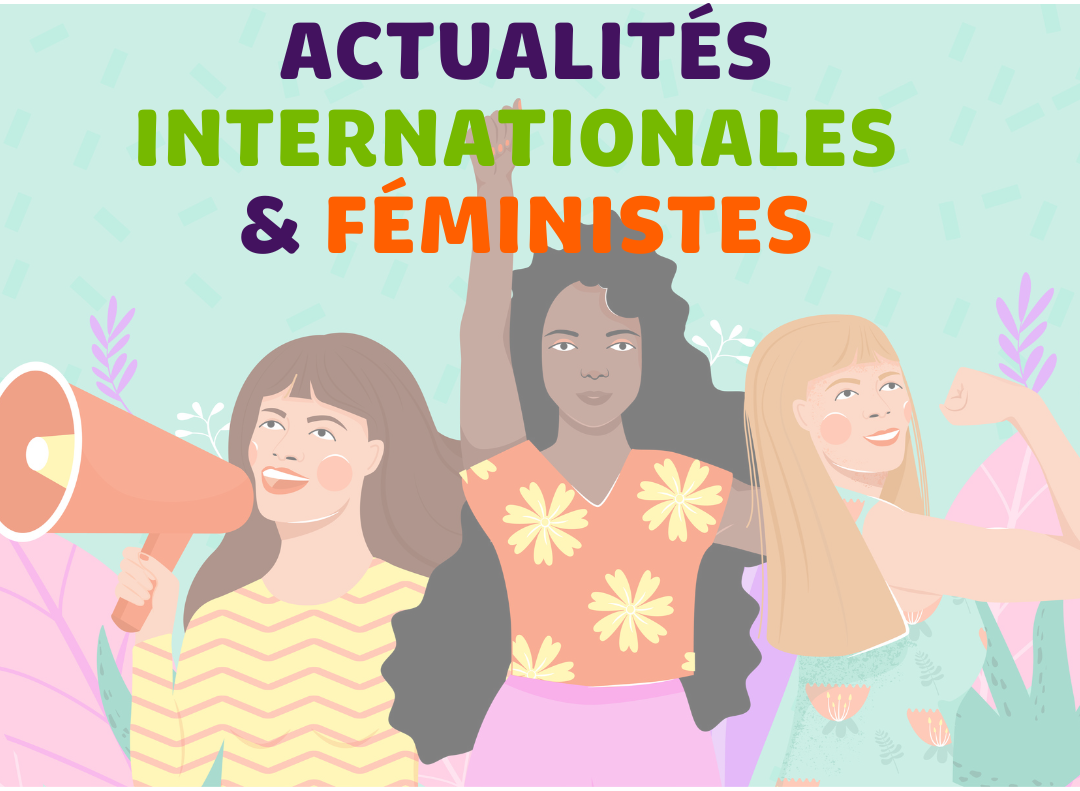
Revue de presse féministe & internationale du 22 au 26 septembre 2025
26 septembre, 2025
Mardi de la CLEF #42 : Corps des femmes, champ de bataille. Génocide de l’Etat israélien en Palestine et violences spécifiques en Israël et Palestine.
6 octobre, 2025Revue de presse féministe & internationale du 29 septembre au 03 octobre 2025
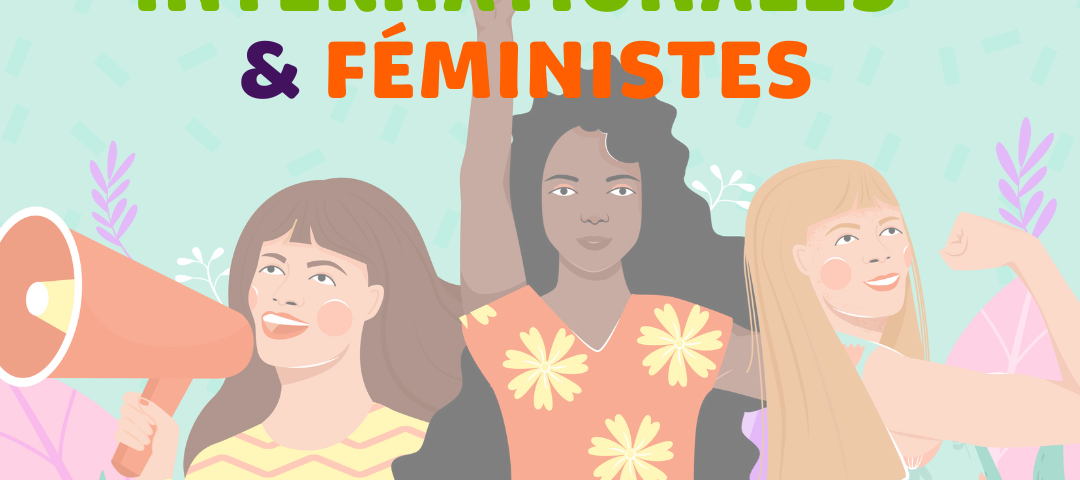
SÉNÉGAL
Quinze associations féministes sénégalaises interpellent le Président Diomaye Faye, après son discours à l’ONU.
A la suite de son discours à la tribune des Nations Unies sur l’égalité des sexes et la défense des droits des femmes, le président sénégalais Diomaye Faye a été enjoint par quinze organisations féministes à passer des mots aux actes.
Le 22 septembre 2025, le chef de l’État sénégalais a affirmé, dans un discours fort prononcé à l’Assemblée générale de l’ONU, son engagement en faveur de « l’égalité entre les sexes, l’autonomisation des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre ». En rappelant que l’égalité est un devoir moral et universel, il a appelé la communauté internationale à agir, considérant que « la lutte contre les violences et les discriminations est un combat permanent qui engage États, citoyens et leaders ». Enfin, Diomaye Faye a insisté sur le soutien du Sénégal à la Déclaration de Beijing, une référence mondiale en faveur des droits des filles et des femmes qui fête cette année ses 30 ans.
Ce discours a tout de suite fait réagir les organisations féministes sénégalaises, qui ont souligné un décalage entre les engagements du Président et la réalité vécue par les femmes sénégalaises. Ces associations ont signé un communiqué conjoint, le 23 septembre, pour pointer les écarts existants et rappeler le chef de l’État à ses promesses.
Elles notent ainsi qu’en dépit de ses engagements internationaux, le Sénégal applique encore des lois contraires aux normes internationales. L’âge légal du mariage étant fixé à 16 ans pour les filles constitue, par exemple,une violation de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le droit à l’avortement est également mentionné dans la tribune. En effet, le Protocole de Maputo, signé et ratifié sans réserve par le Sénégal, reconnaît le recours à l’avortement comme un droit humain, étant autorisé dans des circonstances spécifiques (viol, inceste, agression sexuelle…). Cependant, les articles 305 et 305 bis du Code pénal répriment l’avortement médicalisé pour les femmes et les filles victimes de viol ou d’inceste.
Par ailleurs, les organisations féministes signataires déplorent une trop faible représentativité des femmes au sein du Parlement et des instances décisionnaires sénégalaises. Ainsi, dans les deux derniers gouvernements, les femmes représentaient moins de 15% de tous les postes de nomination.
Elles proposent ainsi une réforme juridique complète, basée sur la justice sociale et la reconnaissance pleine de la place des femmes dans la société sénégalaise. Une des mesures proposée est la reconnaissance du féminicide dans la législation pénale. En effet, les signataires de la lettre pointent du doigt une recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles, survenant dans un climat d’impunité persistante et de faibles mécanismes de protection des victimes.
Ainsi, si elles saluent « cette prise de parole symbolique porteuse d’espoir et de reconnaissance », les organisations féministes signataires de ce communiqué insistent sur la nécessité de prendre des mesures concrètes. Comme elles le concluent, « les droits des femmes et des filles méritent plus que des mots : ils exigent des réformes courageuses et une volonté politique inébranlable. Le temps est à l’action. »
“Sénégal : des militantes féministes interpellent Diomaye Faye”, Wayeno, 27 septembre 2025.
FRANCE
Le projet militant d’un monument aux avortées inconnues : entre Histoire et questions contemporaines.
A l’occasion de la journée mondiale pour le droit à l’avortement, qui s’est déroulée ce dimanche 28 septembre, l’association “Aux avortées inconnues” a présenté son projet de leur ériger un monument dans Paris.
Alors que nous célébrons les 50 ans de la loi Veil, “Aux avortées inconnues” nous invite à jeter un regard en arrière, à avoir une pensée pour toutes ces femmes mortes dans le secret de l’avortement clandestin. Mariana Otero, réalisatrice et présidente de l’association, déclare au micro de FranceInfo :
Déclarées sous d’autres noms, le chiffrage de ces décès est aujourd’hui difficile à effectuer : les femmes meurent de l’appendicite, du tétanos, mais jamais ne sera nommé ce terme tabou, l’avortement. Aujourd’hui, de nombreuses familles vivent encore dans le secret. Mariana Otero est bien placée pour en parler : sa mère, la peintre Clotilde Vautier meurt en 1968, à 28 ans d’une “péritonite”. Il faudra presque 25 ans pour que ses filles découvrent la réalité : leur mère est morte d’une sépticémie faisant suite à un avortement clandestin.
Il s’agirait ainsi de lancer un tout nouveau travail de mémoire, qui devient urgent : les témoins de ces histoires sont de plus en plus âgés et la documentation quasi-inexistante. Outre ce chantier historique, le projet a notamment pour vocation de libérer la parole sur le sujet de l’avortement, afin de lever le secret et la culpabilité qui pèsent dessus depuis 1920, date de la loi qui interdisait et criminalisait l’avortement.
L’histoire que ce projet cherche à écrire paraît pourtant encore contemporaine.
Si la France est précurseure dans la constitutionalisation du droit à l’avortement, la question de son accessibilité se pose. Entre l’existence de la clause de conscience des médecins, leur permettant de refuser de pratiquer une IVG qui s’inscrit dans les conditions prévues par la loi, les baisses de financements d’acteurs comme le Planning familial et les déserts médicaux, l’accès à l’IVG reste fragmenté.
A l’international, le droit à l’IVG est également mis en danger, de façon d’autant plus frontale : sur les trois dernières années, nous avons observé avec effroi la criminalisation de l’avortement dans certains états américains depuis 2022, la possibilité depuis 2024 pour les militants anti-IVG de faire pression sur les femmes au sein-même des cliniques ou encore la légalisation de l’IGV à Malte en 2023, uniquement en cas de danger vital pour les femmes ou de foetus non-viable.
Ce projet militant s’affiche ainsi comme un hommage aux avancées des ces cinquante dernières années, mais également comme un rappel plus que nécessaire que les droits des femmes restent précaires, qu’un retour en arrière n’est jamais très loin et que la lutte ne doit pas s’essouffler.
AFP. “Bientôt un monument « Aux avortées inconnues » à Paris?”. France 24, 24 septembre 2025.
ARGENTINE
Des milliers de manifestant·es dans les rues après un triple féminicide.
Le 24 septembre, trois jeunes argentines ont été retrouvées assassinées, après avoir été torturées. Ce triple féminicide, filmé, serait lié au narcotrafic sud-américain. Cette onde de choc traverse et émeut toute l’Argentine.
« Lara, Brenda, Morena » sont les trois noms qu’on retrouve sur les banderoles des manifestations de soutien et d’indignation qui traversent l’Argentine depuis le 24 septembre. Ce sont les noms des trois jeunes filles torturées puis tuées, dans la banlieue sud de Buenos Aires : Lara Gutiérrez, 15 ans, Brenda del Castillo et Morena Verdi, toutes les deux 20 ans. L’une d’elle était mère d’un bébé d’un an.
Croyant se rendre à une fête, les deux jeunes femmes et l’adolescente ont été piégées, le 19 septembre. Elles ont en fait été torturées, assassinées puis enterrées dans le jardin d’une maison de la banlieue sud de Buenos Aires, où elles ont été retrouvées le 24 septembre, cinq jours après leur disparition. Cette séance de torture a été filmée et diffusée en direct sur un compte privé Instagram. Visionnés par 45 personnes, ces actes auraient servi d’exemple de sévices, au sein d’un groupe criminel lié au narcotrafic.
Ce triple-féminicide a suscité une véritable onde de choc dans le pays, rassemblant plusieurs milliers de personnes dans les rues de la capitale samedi 27 septembre, présent·es pour soutenir les proches des victimes et pour demander justice. La manifestation a été organisée par le collectif « Ni una menos » (Pas une de moins), qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Une participante au rassemblement, citée par TV5 Monde, dénonce le traitement médiatique de ces crimes, en plus de pointer du doigt l’injustice économique et sociale dont sont victimes les filles de quartiers défavorisés : « On essaie toujours de culpabiliser les filles, on sait tout de leur vie, ce qu’elles faisaient là, comment est la famille… On publie leurs photos mais on ne sait rien des auteurs, pas leurs noms, leurs visages sont floutés. »
Le crime dont ont été victimes Lara, Brenda et Morena s’inscrit dans un moment où les femmes et leurs droits sont grandement menacées en Argentine. L’élection de Javier Milei à la tête de l’État en 2023 a marqué un fort retour en arrière, comme en témoigne le démantèlement du ministère des affaires féminines argentin, peu de temps après l’entrée en fonction du Président. Alors qu’une femme est tuée par un homme toutes les 36 heures, selon un groupe local de surveillance des féminicides cité par la BBC, Javier Milei déclarait en janvier qu’il souhaitait supprimer le terme de « féminicide » du code pénal. Introduit en 2012 comme une circonstance aggravante à l’homicide, le féminicide est punissable de prison à vie. Mais selon Milei, et son ministre de la justice Mariano Cúneo Libarona, le concept de féminicie sous-tend l’idée que la vie d’une femme a plus de valeur que celle d’un homme et constitue donc, une « distorsion du concept d’égalité ».
CÔTE D’IVOIRE
Simone Ehivet Gbagbo candidate aux présidentielles
“Simone, tu as été l’icône de la jeunesse et des femmes en Côte d’Ivoire.” C’est en ces termes que Robert Bourgi, proche de l’ex-mari de Simone Ehivet Gbagbo, débute son plaidoyer afin d’inciter la candidate aux présidentielles à se retirer de la course.
Ancienne première dame, Simone Ehivet Gbabgo s’est présentée aux élections présidentielles ivoiriennes qui se tiendront le 25 octobre prochain afin de passer de l’autre côté de la scène politique.
Dans un environnement dominé par les hommes, elle a su s’imposer comme une figure militante. En 1982, à une époque où le multipartisme est interdit par le président Félix Houphouët-Boigny, elle co-fonde illégalement, avec d’autres militants socialistes, le Front populaire ivoirien (FPI), lui valant quelques séjours en prison.
Dans un pays où, aujourd’hui encore, les femmes ne représentent que 30% des parlementaires et accèdent peu aux postes décisionnels, Simone Ehivet Gbagbo a été une pionnière dans la vie politique ivoirienne : élue député en 1995, elle devient vice-présidente de l’Assemblée nationale et y préside le groupe du FPI. A l’élection à la présidence de son ex-mari, Laurent Gbagbo en 2002, elle ne se contente pas du rôle protocolaire de première dame et participe activement au pouvoir décisionnel.
Surnommée “Maman”, elle incarne pour ses partisans une tête de proue forte contre la rébellion et les pressions internationales, et représente, depuis près de 40 ans, un féroce adversaire pour l’opposition politique : « J’ai passé six mois en prison, j’ai été battue, agressée sexuellement, laissée pour morte. Après toutes ces épreuves, il est logique que les gens ne s’en prennent pas à moi. » explique-elle dans son interview à l’Express.
L’élection de 2010 est un tournant pour elle : à la suite de la crise post-électorale qui s’ensuit, elle est arrêtée puis condamnée en 2015 pour « tentative d’atteinte à la sécurité de l’État ». Elle sera néanmoins graciée en 2018 par le président Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale.
Son divorce lui donnera l’occasion de relancer sa carrière politique : elle quitte le FPI et crée son propre parti, le Mouvement des générations capables (MGC), en 2023. Les élections à venir constituent ainsi le premier test de la solidité de son retour sur la scène politique.
Si sa candidature fait débat, rappelant l’histoire douloureuse de la mandature de son ex-mari, Simone Ehivet Gbagbo souhaite sortir de cette ombre et écrire un nouveau chapitre pour la Côte-d’Ivoire. Elle promet une réforme du pouvoir, en invitant massivement les femmes à s’investir dans la vie politique nationale, comme certaines le font déjà au sein du MGC.
Dans un pays où elles ne représentent que 30% des parlementaires et accèdent peu aux postes décisionnels, la candidate est l’une des adversaires les plus redoutables du président Ouattara et inspire ses compatriotes : ”Je peux devenir la première présidente de la Côte d’Ivoire. Vous m’appellerez madame la présidente ».