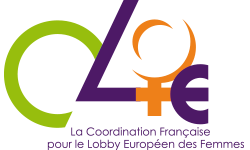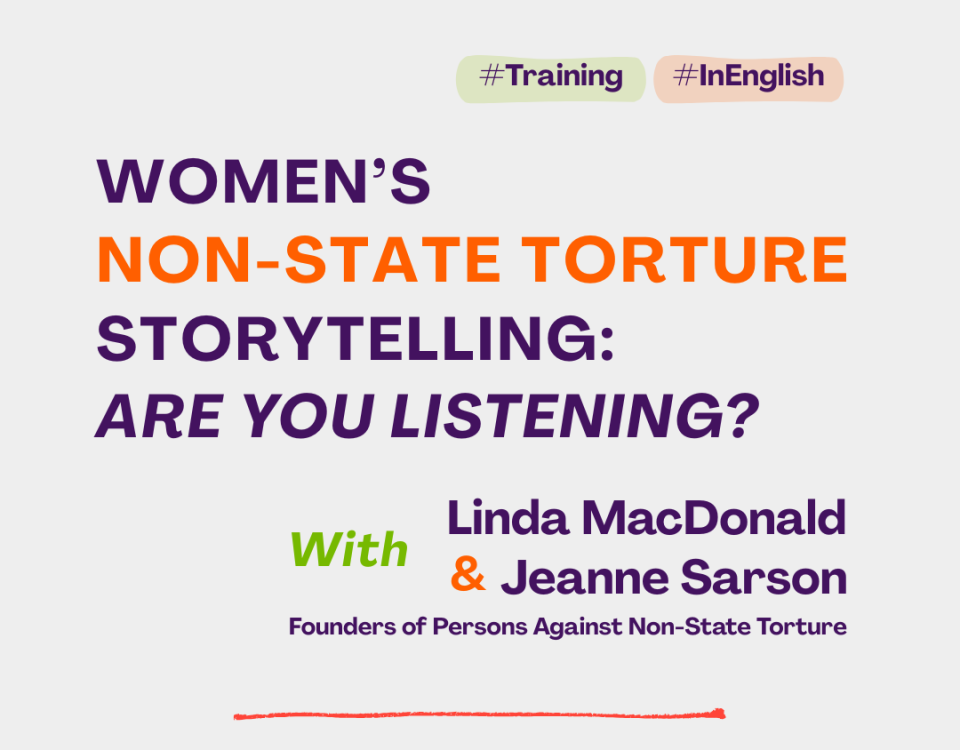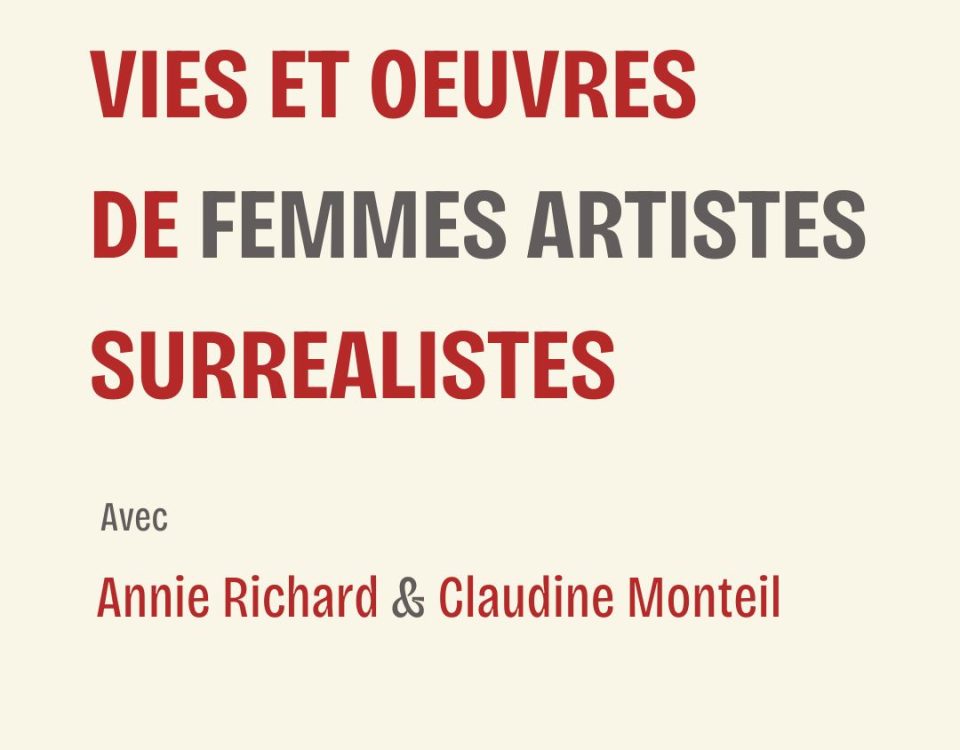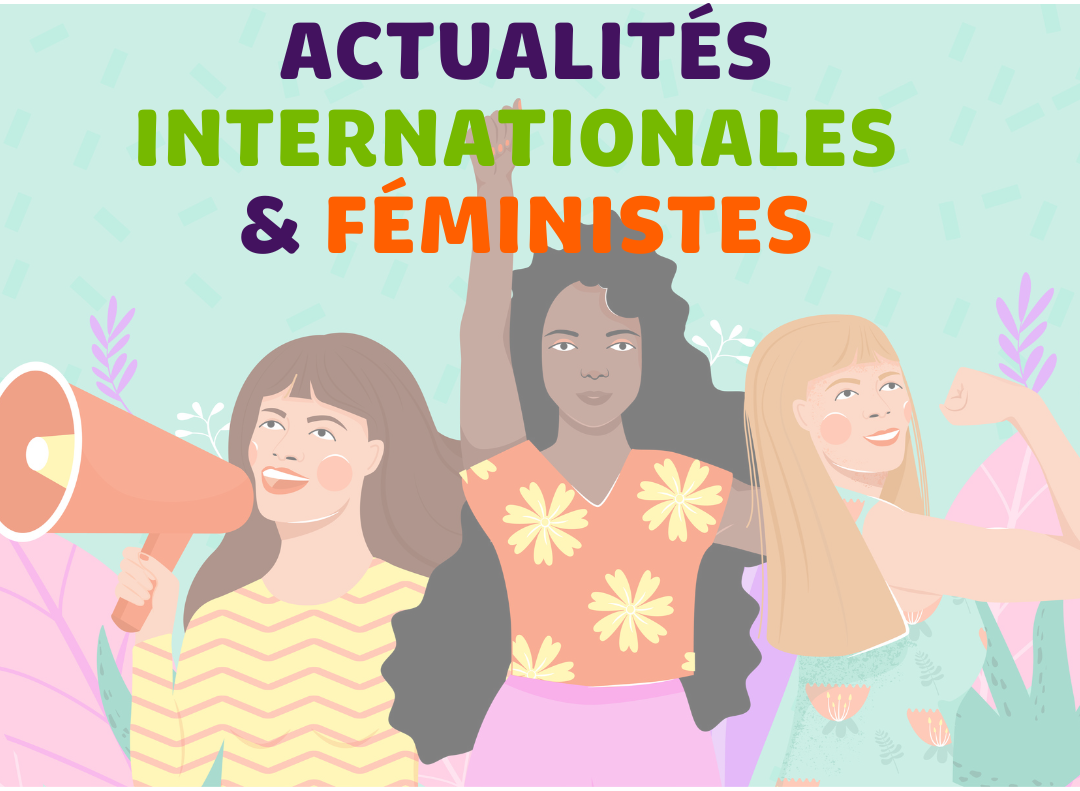
Revue de presse féministe & internationale du 25 au 29 août 2025
29 août, 2025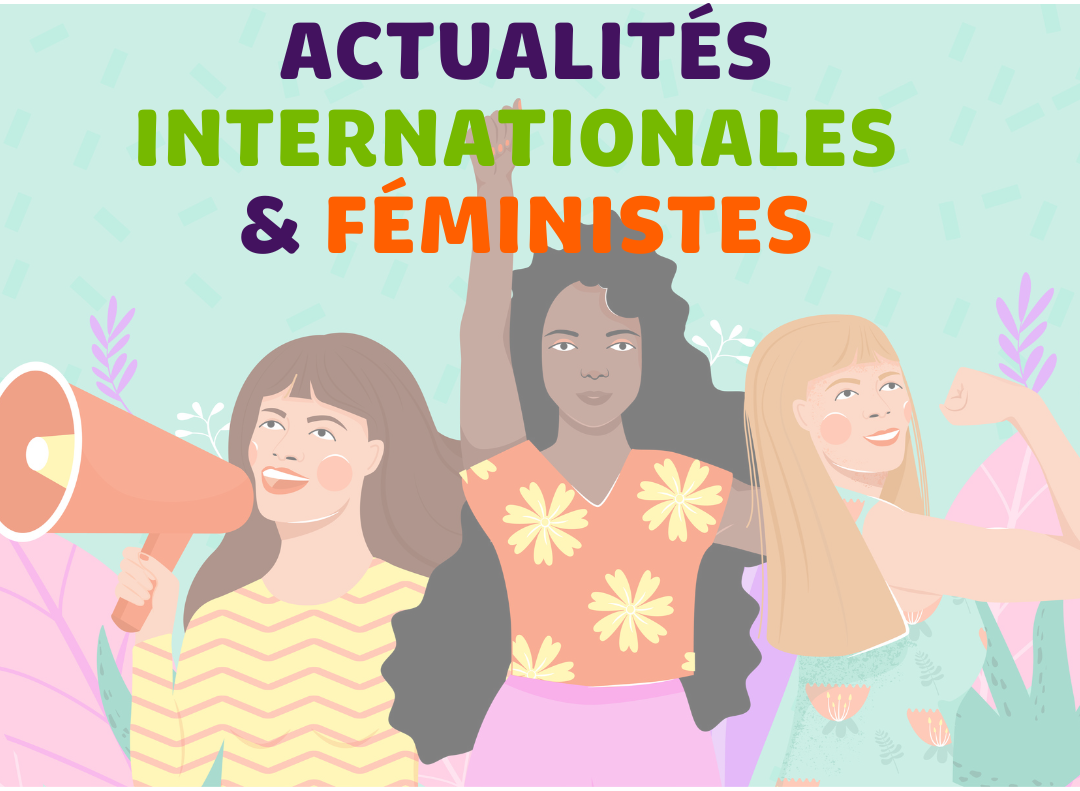
Revue de presse féministe & internationale du 08 au 12 septembre 2025
12 septembre, 2025Revue de presse féministe & internationale du 01 au 05 septembre 2025
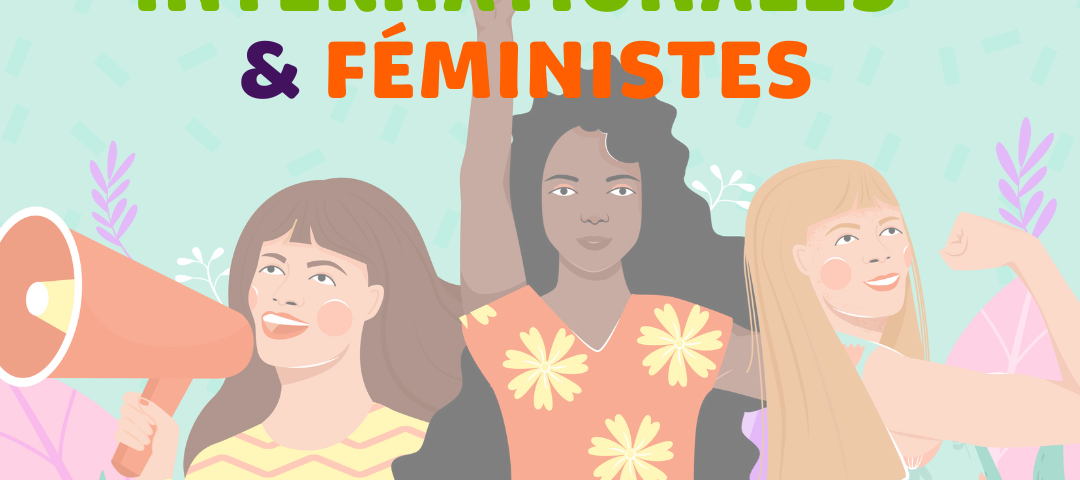
ITALIE
Un site de diffusion d’images intimes volées provoque un séisme politique en Italie
La découverte d’un forum en ligne rassemblant des centaines de milliers d’images de femmes volées, retouchées ou détournées a suscité une vague d’indignation en Italie. Victimes anonymes comme figures politiques et artistiques sont concernées, révélant une nouvelle fois l’ampleur de la cyberviolence dirigée contre les femmes.
Les contenus diffusés sur ce forum sont le plus souvent des clichés du quotidien sexualisés et commentés de manière dégradante, ou des montages pornographiques réalisés par le biais de l’intelligence artificielle, qui déshabillent artificiellement les femmes.
C’est le forum Phica.net, actif depuis 2005 et recensant jusqu’à 700 000 membres, qui a été dénoncé cette semaine par l’eurodéputée Alessandra Moretti. Le forum comprenait un « carré VIP » où apparaissaient notamment la présidente du Conseil Giorgia Meloni, la cheffe du Parti démocrate Elly Schlein ou encore l’ex-ministre Mariastella Gelmini, dont l’image avait été manipulée par le biais de l’intelligence artificielle. Les victimes sont des femmes connues du grand public (journalistes, politiciennes, artistes) ou non. Parmi elles, l’actrice Paola Cortellesi, réalisatrice et symbole de la lutte contre les violences conjugales en Italie.
L’affaire a éclaté publiquement lorsque deux élues du Parti démocrate, Alessandra Moretti et Valeria Campagna, ont alerté les réseaux sociaux. D’autres responsables politiques ont publiquement annoncé porter plainte, initiant un mouvement plus large.. Moretti a elle-même révélé être ciblée depuis 2014 : « Des centaines de mes photos ont été modifiées puis données en pâture à ces animaux », a-t-elle dénoncé. L’eurodéputée a affirmé vouloir « encourager toutes les femmes à porter plainte » au pénal et non pas seulement obtenir la fermeture administrative du site. Ses propos ont libéré d’autres témoignages et renforcé l’appel à une réaction collective face à ce qu’elle qualifie de « violence brutale ».
Face au flot de plaintes, le forum a finalement fermé. Sur sa page d’accueil, un message a tenté de se dédouaner, assurant : « Si tes droits ont été violés, contacte-nous avec le lien afin que nous puissions le supprimer. » Les administrateurs affirment que « certains utilisateurs » auraient trahi « l’esprit originel » du site, une justification jugée indécente par les victimes.
Pour la première fois en Italie, deux femmes occupent les plus hautes fonctions politiques du pays, Giorgia Meloni et Elly Schlein, et figurent toutes deux parmi les victimes du forum. Meloni a condamné fermement ces pratiques, tandis que la ministre de la Famille et de l’Égalité, Eugenia Roccella, a annoncé un plan de renforcement des protections en ligne. Mais la philosophe féministe Giorgia Serughetti rappelle les limites de cette réponse : « Aucune politique contre la violence ne peut être efficace si elle ne travaille pas sérieusement à la transformation culturelle de la société. ». Elle dénonce l’hypocrisie d’un gouvernement qui condamne la violence tout en rejetant les initiatives d’éducation sexuelles, pourtant essentielles pour agir à la racine.
Ce scandale intervient une semaine après la fermeture d’un autre groupe, « Mia Moglie », qui rassemblait plus de 30 000 membres sur Facebook. Là encore, des photos intimes de femmes étaient partagées par des hommes de leur entourage, accompagnées de commentaires sexistes. L’affaire avait déjà mené à plusieurs milliers de plaintes et à une action de groupe contre Facebook. La révélation de « Phica.net » montre que le problème dépasse largement un seul espace en ligne : il s’agit d’un système de cyberviolence contre les femmes, encore largement impuni.
FRANCE
20 ans de YouTube et encore trop peu de femmes à l’écran
Depuis 20 ans, YouTube transforme notre manière de regarder des contenus à l’écran, au point de remplacer progressivement la télévision traditionnelle. Pourtant, malgré cette révolution numérique, Libération souligne que les femmes restent largement minoritaires parmi les 100 youtubeur·euse·s les plus suivi•es de France, avec seulement une dizaine représentées.
Ces dernières années, la tendance sur YouTube privilégie les vidéos « feat and fun », majoritairement produites par des hommes. Les créateurs de contenus se rendent visite mutuellement pour réaliser ensemble des vidéos humoristiques et accrocheuses. Ce type de collaboration permet de faire croître rapidement l’audience de chacun, tandis que celle des créatrices reste globalement stable.
Parfois, une chaîne YouTube se consacre exclusivement à ce type de contenus, avec des créateurs qui collaborent presque uniquement entre eux. C’est le cas de la chaîne d’Amixem, qui compte trois collaborateurs réguliers regroupés sous le nom de Crew, ou encore de MisterBeast aux États-Unis, plus grand youtubeur du monde, dont le Beast Gang comprend environ cinq membres apparaissant fréquemment dans ses vidéos.
Dans d’autres cas, et de manière plus fréquente, les youtubeurs collaborent ponctuellement pour produire une vidéo et/ou organiser un événement médiatique. C’est notamment le cas du GP Explorer, une course de F4 organisée chaque année en septembre par Squeezie depuis trois ans, qui réunit plusieur·es participant·es, majoritairement des hommes. Cette année, sur les 24 participant·es, seules six sont des femmes, un chiffre encore faible mais en nette progression par rapport à la première édition, où elles n’étaient que trois sur 22.
Interrogée par Libération, Yvette Assilaméhou-Kunz, maîtresse de conférences en psychologie sociale, explique que « la socialisation des femmes » les pousse « à traiter des sujets plus intimes, moins tous publics ». La chercheuse poursuit que « c’est comme si l’on se demandait pourquoi il y a plus de femmes infirmières que d’hommes dans le BTP ». Les femmes se tournent ainsi davantage vers des sujets genrés.
Par conséquent, les créatrices de contenus se trouvent d’emblée désavantagées en termes d’audience potentielle. Sur YouTube, elles ont très régulièrement été confinées aux secteurs de la beauté, du maquillage et du “lifestyle” (filmer son mode de vie). Très peu ont réussi à percer dans d’autres domaines, notamment grâce à l’humour, à l’exception de la youtubeuse Natoo par exemple.
En plus de cela, même s’il existe des moyens de modérer les contenus en ligne des internautes, les femmes sur YouTube sont confrontées à de très nombreux commentaires misogynes, voire victimes de campagnes masculinistes, sous leurs vidéos. C’est le cas de Léna Situations, qui a évoqué à plusieurs reprises ce problème. En 2021, selon une étude de The Economist Intelligence Unit, 85 % des femmes dans le monde étaient exposées à des violences en ligne, notamment au harcèlement.
Parallèlement, d’autres plateformes offrent davantage de visibilité aux créatrices, comme Twitch, une plateforme de diffusion en direct principalement utilisée pour le jeu vidéo. Cependant, les plus grands noms français restent majoritairement des hommes et de nombreuses streameuses subissent régulièrement du harcèlement en ligne, incluant menaces de viol, diffusion d’images non sollicitées et sexualisation constante.
PAYS-BAS
« Je revendique la nuit » : la colère des femmes après le meurtre de Lisa aux Pays-Bas.
Le meurtre de Lisa, âgée de 17 ans, poignardée en pleine nuit aux Pays-Bas par un homme de 22 ans, a suscité une vague d’indignation. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, de nombreuses femmes témoignent de leur peur de circuler la nuit et appellent à des mesures concrètes pour garantir leur sécurité.
Suite au décès de Lisa dans la nuit du 19 au 20 août, de nombreuses femmes ont pris la parole sur les réseaux sociaux et dans les médias pour exprimer leur colère, partager leurs expériences et réclamer des mesures concrètes pour améliorer leur sécurité.
Beaucoup de femmes racontent devoir se rendre invisibles, marcher vite ou encore réfléchir à deux fois avant de choisir leur tenue le soir.
Sur Instagram, l’autrice Nienke Gravemade a publié un texte puissant, liké près de 250 000 fois et republié par le quotidien Het Parool. Elle y déclare : « Je revendique la nuit. Je revendique les rues. J’exige que la peur disparaisse. Je revendique les vingt-quatre heures dans ma journée. J’exige que les filles de 17 ans puissent rentrer chez elles en toute sécurité. »
Nienke Gravemade a accompagné son message du hashtag #rechtopdenacht (« droit à la nuit »), aussi largement relayé. Ce mot-clé fait écho aux mouvements Reclaim the Night, nés dans les années 1970 aux États-Unis et au Royaume-Uni à la suite de plusieurs assassinats de femmes. Les féministes l’utilisaient pour contrer les recommandations policières qui leur demandaient de rester chez elles une fois la nuit tombée, insinuant ainsi que la nuit était réservée uniquement aux hommes.
Peu après, une cagnotte en ligne intitulée « Wij Eisen de nacht » (« Nous revendiquons la nuit ») a permis de réunir plus de 500 000 euros pour financer une campagne de sensibilisation visant à garantir la sécurité des femmes partout. Le but est d’afficher des messages sur les pylônes routiers ou encore sur des écrans numériques dans tous les Pays-Bas.
Au-delà de la seule question de sécurité, c’est aussi la liberté des femmes de circuler dans l’espace public qui est en jeu. Comme le rappelait en 2021 le Guide référentiel sur le genre et l’espace public de la Ville de Paris, une étude de l’Insee indiquait que 25 % des femmes de 18 à 29 ans ont peur dans la rue et que 20 % déclarent y être insultées au moins une fois par an.
En France, pour mieux comprendre ces inégalités, dix marches exploratoires avaient été organisées entre 2014 et 2018 dans plusieurs quartiers. L’objectif était d’identifier les points problématiques et de réfléchir à des solutions concrètes, comme l’amélioration de l’éclairage des rues, des parcs et des arrêts de transport pour réduire le sentiment d’insécurité, ou encore le réaménagement des espaces publics afin d’éviter les zones isolées et propices au harcèlement.
Guide référentiel de Paris, 2021
DANEMARK
Danemark : des excuses historiques pour les stérilisations forcées des Groenlandaises
La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a présenté ses excuses officielles pour les milliers de stérilisations forcées imposées aux jeunes Groenlandaises entre les années 1960 et 1990. Un geste symbolique, attendu depuis des décennies, qui peine à panser les plaies de ses victimes.
« Nous ne pouvons pas revenir sur ce qui s’est passé, mais nous pouvons accepter nos responsabilités. C’est pourquoi je voudrais, au nom du Danemark, dire pardon », a déclaré Mette Frederiksen. Ces excuses constituent une première reconnaissance de la responsabilité danoise dans cette politique de stérilisation forcée. Le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, a lui aussi exprimé ses regrets, puisque ces pratiques ont continué après l’autonomisation du territoire. Pour Copenhague, longtemps réticente à admettre qu’il s’agissait d’une véritable politique d’État, ce geste vise à tourner une page douloureuse des relations avec son territoire arctique.
Entre la fin des années 1960 et 1992, plus de 4 500 adolescentes et jeunes femmes inuites ont été forcées de porter des stérilets contraceptifs. Certaines avaient à peine 12 ou 13 ans. Les autorités danoises, inquiètes du fort taux de natalité de l’île, voulaient limiter les naissances dans la population inuit. Pour beaucoup, ces interventions ont laissé des séquelles irréversibles : stérilité, douleurs chroniques et traumatismes psychologiques. « C’était comme de la torture, comme un viol », a témoigné Naja Lyberth, la première à avoir brisé le silence.
Ce scandale, connu sous le nom de « campagne des spirales », est longtemps resté tabou. Les premiers témoignages, apparus dès 2019, n’ont pas immédiatement suscité de réaction politique. Ce n’est qu’en 2022, après un podcast de la radio publique danoise et la médiatisation de l’histoire de Naja Lyberth, que l’ampleur de ces violences a éclaté. Depuis, les récits se sont multipliés, dénonçant une véritable « colonisation des corps ». Une commission d’enquête indépendante est en cours, mais ses conclusions ne sont attendues qu’en janvier 2026, après plusieurs reports.
Pour les survivantes, ces excuses sont un soulagement, mais elles restent insuffisantes. « Je suis heureuse mais ça arrive peut-être tard », confie Henriette Berthelsen, stérilisée à 13 ans. Elles insistent sur la nécessité de passer des mots aux actes. « Bien sûr, c’est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas la fin de l’histoire », rappelle l’avocate Julie Gronning, qui représente plusieurs victimes.
En parallèle, près de 150 femmes ont porté plainte contre l’État danois. Elles réclament environ six millions d’euros de compensation pour violation de leurs droits humains. Pour l’instant, Copenhague attend la fin de l’enquête avant d’envisager d’éventuelles indemnisations. Les précédents montrent que des réparations sont possibles : en 2022, le Danemark avait déjà versé une indemnité à six Inuits séparés de force de leurs familles dans les années 1950.
Au-delà des stérilisations, ces excuses rouvrent la question plus large des discriminations subies par les Groenlandais. Le placement forcé d’enfants, les adoptions imposées ou encore l’abandon d’enfants « sans père » par des géniteurs danois sont autant de chapitres sombres que Copenhague devra affronter. « Les Groenlandais ont été traités différemment, et de manière inférieure, par rapport à d’autres citoyens du royaume », a reconnu Mette Frederiksen. Ces excuses marquent une étape importante, mais elles ne suffisent pas à effacer la violence des atteintes faites aux corps des femmes. Leur histoire rappelle que la colonisation s’est aussi exercée à travers le contrôle des ventres.