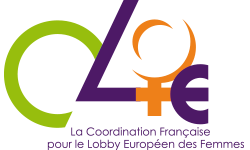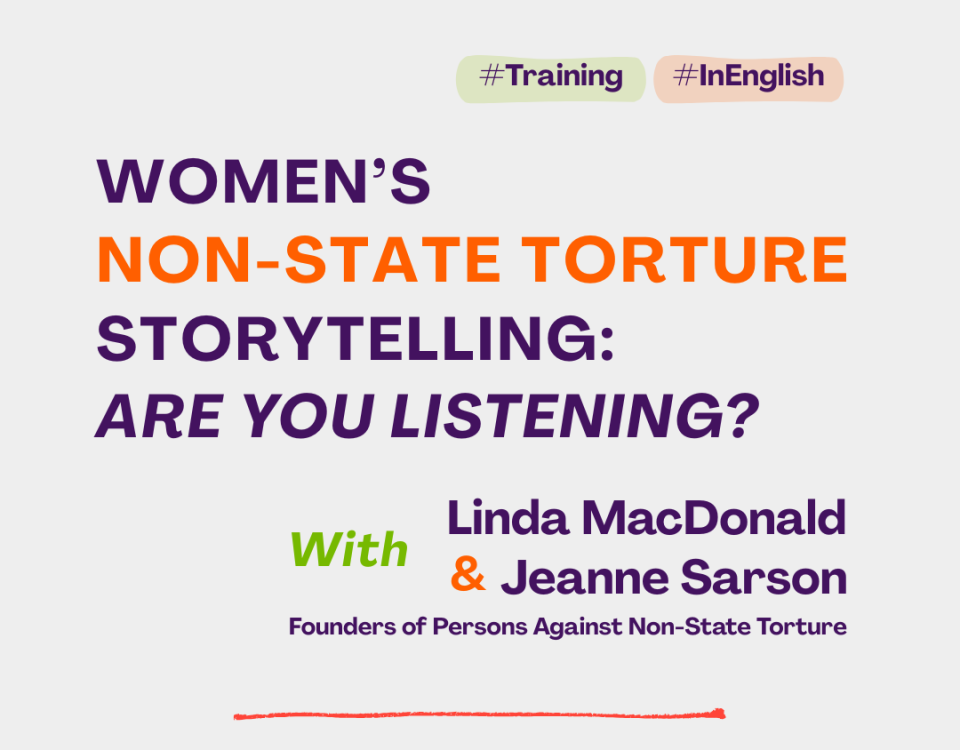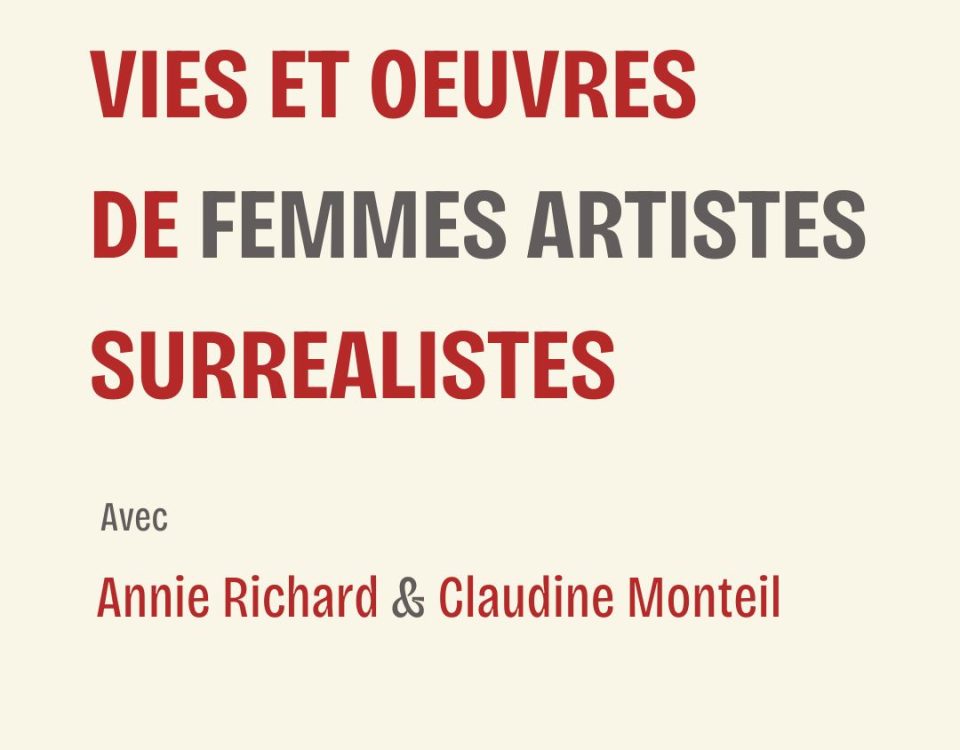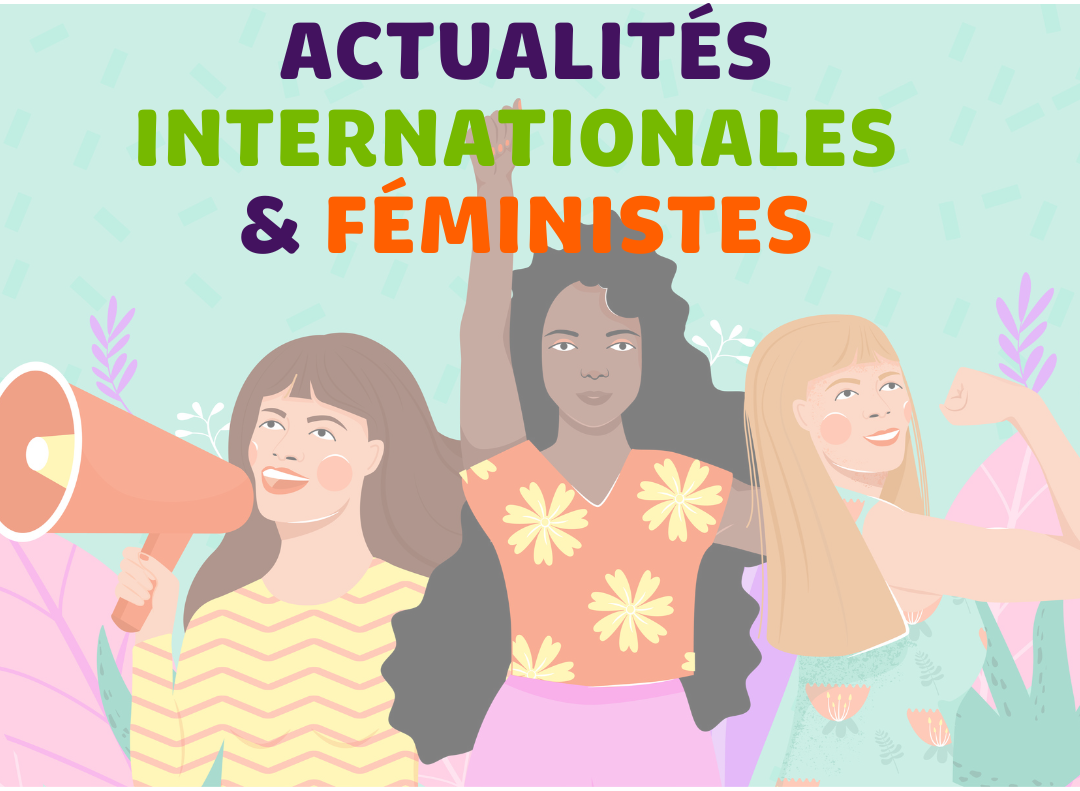
Revue de presse féministe & internationale du 28 avril au 2 mai
2 mai, 2025
Mardi de la CLEF #41 : Résister à la normalisation de la violence sexiste : pour une réponse féministe, abolitionniste et politique à la marchandisation du corps des femmes
20 mai, 2025Revue de presse féministe & internationale du 12 mai au 16 mai
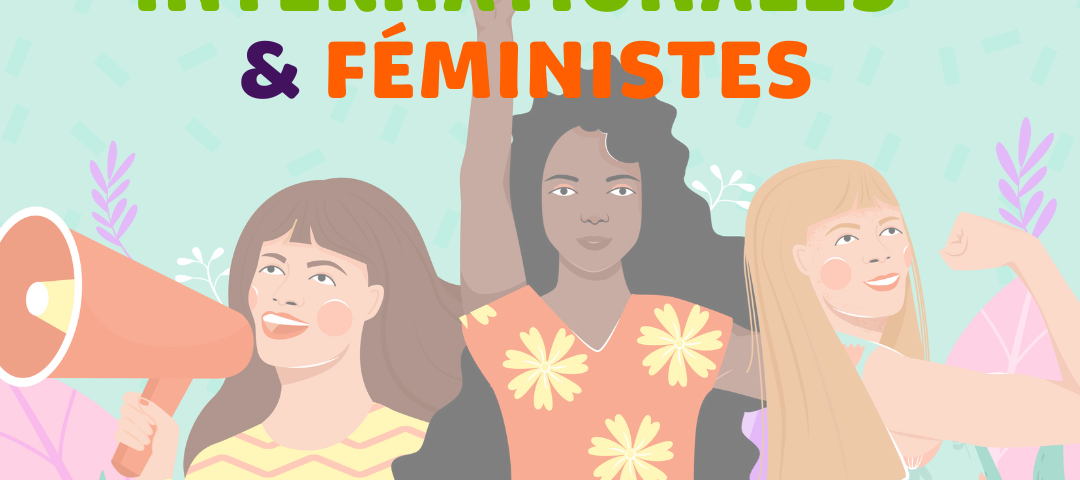
FRANCE
Le rapport sur la soumission chimique publié
Ce 12 mai 2025, la députée Sandrine Josso et la sénatrice Véronique Guillotin ont présenté le rapport parlementaire sur la soumission chimique et ses 50 recommandations. La commission d’enquête a duré 13 mois et a interrogé plus de 100 femmes.
Ce rapport, venant d’une mission gouvernementale d’avril 2024, s’inscrit à la suite des mouvements #Balancetonbar, #MetooGHB, et bien évidemment du procès des viols de Mazan et vient rappeler une vérité : la soumission chimique, vue comme une “facilitatrice de violences” (Libération) nie le consentement, le corps et la mémoire des victimes.
Qu’est-ce que la soumission chimique : La soumission chimique est l’administration d’une substance psychoactive à l’insu des victimes ou sous la menace à des fins criminelles ou délictuelles. Elle se distingue de la vulnérabilité chimique qui désigne un état de fragilité induit par la consommation volontaire d’une substance psychoactive ayant rendu la personne plus vulnérable à une agression.
En 2022, sur 97 victimes de soumission chimique, 82,5% sont des femmes ayant entre 9 mois et 90 ans (Vie Publique).
“Rappelons-le, la soumission chimique n’a pas d’âge et touche toutes les tranches de la population” – Sandrine Josso.
Il est important de rappeler que la soumission chimique se produit souvent dans la sphère intime (9 cas sur 10, l’agresseur se trouve dans l’entourage de la victime).
Sandrine Josso est elle-même victime d’une soumission chimique par le sénateur Horizons Joël Guerriau en 2023, sénateur qu’elle considérait comme son “ami politique”. D’ailleurs, comme l’écrit Mediapart, “l’élu de Loire-Atlantique, contre qui le parquet de Paris a requis un procès devant le tribunal correctionnel, est toujours comptabilisé dans les effectifs du groupe présidé par Claude Malhuret, permettant même à celui-ci d’en tirer un avantage politique.”
La soumission chimique reste largement sous-estimée et mal prise en charge en France, en raison de défaillances systémiques qui entravent l’identification et l’accompagnement des victimes :
- élimination rapide des substances donc besoin d’agir rapidement et efficacement dans les premières heures
- absence d’organisation sur l’ensemble du territoire de capacités de prélèvements biologiques (lié aux déserts médicaux)
- symptôme d’amnésie (partiel ou total) privant la victime de souvenirs : “Dans les cas de soumission chimique, la particularité est qu’une victime sur deux ne se souvient plus de rien” – Sandrine Josso
Toutefois, les chiffres sont en constante augmentation : entre 2016 et 2024, le nombre de faits de soumission chimique en vue d’un viol ou d’une agression sexuelle est passé de 5 à 327 (selon les chiffres de la police et de la gendarmerie nationales). Cette hausse est aussi liée à une meilleure détection et une meilleure connaissance de cette stratégie des agresseurs pour commettre des infractions sexuelles.
Finalement, le rapport dresse un plan d’action tenant 50 recommandations pour combler les lacunes dans la prévention et l’accompagnement des victimes de ce phénomène.
Certaines recommandations :
- Remboursement des analyses sans dépôt de plainte
- Formation des professionnels et du grand public (ex. élaboration de fiches réflexes par la Haute Autorité de Santé
- Ajout d’une circonstance aggravante dans le Code Pénal pour les agressions commises sur une personnes sous l’effet de substances
“Soumission chimique et vulnérabilité chimique”, Arrétonslesviolences.gouv
“Soumission chimique : S. Josso remet un rapport”, Télénantes, 13 mai 2025
“Soumission chimique : des situations en augmentation, largement sous-estimées”, Vie Publique, 13 mai 2025(Communiqué de presse) “Remise du rapport issu de la mission gouvernementale sur la soumission chimique”, Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, 12 mai 2025
BANGLADESH
Manifestations des groupes islamistes à Dhaka contre les droits des femmes
Alors que le Bangladesh traverse une période de transition politique délicate, les attaques menées par des groupes islamistes radicaux contre les droits des femmes prennent une ampleur inquiétante.
Multipliant les pressions, menaces et manifestations, ces mouvances religieuses visent à faire reculer les avancées en matière d’égalité entre les sexes, dénonçant les réformes en cours comme « contraires à l’Islam ».
Depuis le début de l’année, plusieurs événements illustrent cette intensification. Fin janvier, deux matchs de football féminin dans le nord du pays ont été annulés sous la pression de manifestants religieux. Des spectateur·rice·s et des joueuses ont été évacué·e·s, empêché·e·s d’accéder aux stades. Abu Bakkar Siddique, l’un des leaders religieux impliqués, a justifié ces actions par des motifs religieux : « le football féminin est contraire à l’Islam » et qu’il était de leur « devoir religieux » d’intervenir. Ces attaques surviennent alors même que l’équipe nationale féminine, récemment victorieuse au championnat sud-asiatique, avait suscité un élan de fierté nationale et ouvert un espace d’expression aux femmes dans le sport.
Par ailleurs, d’autres actions contre la société civile et la culture se sont multipliées, invoquant des raisons de sécurité ou de « respect religieux ». Des figures comme Pori Moni ou Apu Biswas ont dénoncé ces incidents, nommant une répression ciblée de leurs prises de parole ou de leurs activités publiques.
Des organisations islamistes comme Hefazat-e-Islam ou Jamaat-e-Islami occupent désormais le devant de la scène politique mobilisant, lors d’une manifestation le samedi 3 mai, 20 000 personnes dans les rues de Dhaka pour exiger l’abolition de la Commission de réformes des affaires des femmes (Women’s Affairs Reform Commission). Mise en place par le gouvernement de transition dirigé par Muhammad Yunus, cette instance entend moderniser le droit familial et renforcer les protections juridiques des femmes. Les opposants religieux réclament son démantèlement immédiat, appelant à une stricte application de la charia en matière de mariage, d’héritage ou de polygamie. Dans un communiqué, Mia Golam Parwar, secrétaire général du Jamaat-e-Islami, a déclaré : « Recommander des initiatives visant à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes est une tentative malveillante de déformer l’idéologie islamique ».
La montée en puissance de ces discours intervient dans un contexte politique instable, après la démission de Sheikh Hasina en 2024. La transition menée par Yunus, perçue comme fragile, a laissé la place à une radicalisation des discours religieux et à une baisse de la vigilance institutionnelle.
Face à cette offensive, les associations féministes et les ONG de défense des droits humains tirent la sonnette d’alarme. Human Rights Watch a exprimé sa préoccupation face à la multiplication des intimidations à l’encontre des femmes et des défenseur·e·s des droits humains. Le Bangladesh, longtemps salué pour ses efforts en matière d’éducation des filles et de participation féminine à la vie économique, connaît un tournant.
Dans un pays où la Constitution affirme la séparation entre religion et État, la réponse du gouvernement de transition sera décisive. Entre dialogue avec les sphères religieuses et nécessité de garantir les libertés fondamentales, l’équilibre s’annonce difficile à trouver. Mais pour de nombreuses femmes bangladaises, il est hors de question de renoncer aux droits durement acquis.
Taqbir Huda, “Why does Hefazat fear women’s rights more than usury?”, The Daily Star, 7 mai 2025
The Hindu, “Bangladesh’s Islamists seek abolition of women’s commission”, 22 avril 2025
Roshni Majumdar, “Bangladeshi Islamists protest women’s rights proposal”, DW, 5 mars 2025
INTERNATIONAL
Les ONG de défense des droits des femmes de plus en plus menacées
Entre austérité budgétaire et montée de l’extrême droite, les ONG de défense des droits des femmes sont de plus en plus fragilisées. Le Conseil de l’Europe et l’ONU tirent la sonnette d’alarme.
Dans un rapport publié le 14 mai, le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) s’inquiète d’une « réduction de l’espace accordé aux défenseur·e·s des droits des femmes ».
Le groupe d’expert.es a étudié la place des ONG au sein des pays signataires de la Convention d’Istanbul (2014), premier traité international à fixer des normes juridiquement contraignantes pour lutter contre les violences faites aux femmes.
En conséquence, ce rapport montre que de nombreuses ONG de défense des droits des femmes sont menacées, que ce soit sur le plan financier, social ou politique. Pourtant, le GREVIO rappelle une nouvelle fois aux États l’engagement qu’ils ont pris dans la Déclaration de Reykjavik de 2023 de créer des conditions sûres et favorables pour la société civile.
Quelles en seraient les causes ?
Selon leur analyse, ce rétrécissement est lié à la fois aux mesures d’austérité qui ont entraîné des réductions de financement mais aussi à un contexte de régression des droits des femmes.
En effet, l’étude du GREVIO, fondée sur les rapports étatiques thématiques publiés récemment, montre que, dans certains pays, un climat d’hostilité croissante encourage des discours niant l’existence de la violence à l’égard des femmes et remettant en cause la nécessité d’adopter et soutenir des politiques publiques ambitieuses en vue de réduire les inégalités persistantes.
Ce phénomène ne saurait être dissocié du contexte politique actuel. En effet, ces discours prennent de l’ampleur et s’inscrivent dans un contexte politique marqué par la montée en puissance inquiétante des nationalismes et de l’extrême droite en Europe et dans le monde.
“Ce rétrécissement de l’espace donné aux ONG ne vient pas de nulle part. Le contexte est aussi celui d’un rétrécissement général des droits” – Maria-Andriani Kostopoulou, présidente du GREVIO.
Pour illustrer cette tendance, la présidente du GREVIO cite le gel des financements de l’USAID sous Donald Trump, dont les répercussions se font durement sentir sur les ONG : “En Grèce, par exemple, il y a des ONG de défense des droits des femmes qui fonctionnaient depuis des décennies (…) et qui sont sur le point de fermer”.
Un autre rapport réalisé par ONU Femmes, intitulé “At the breaking point : the impact of foreign aid cuts on women’s organizations in humanitarian crises worldwide”, est venu réaffirmer ce constat.
En effet, cette enquête mondiale, menée auprès de 411 organisations de femmes et de défense des droits des femmes dans 44 contextes de crise, révèle que 90% des organisations interrogées sont touchées par une réduction de leur financement.
Selon l’ONU, “Si près de la moitié d’entre elles s’attendent à fermer dans les six mois si les niveaux de financement actuels se maintiennent, plus de 60% ont déjà réduit leurs interventions, perturbant l’apport d’un soutien vital allant des soins de santé d’urgence et des services de lutte contre la violence fondée sur le genre, à l’aide économique et aux solutions d’hébergement.”
Pourtant, pour rappel, en 2024, seulement 1.3% des fonds humanitaires étaient consacrés à la lutte contre les violences à l’égard des femmes et de toutes les minorités de genre.
GREVIO. “6e RAPPORT GÉNÉRAL SUR LES ACTIVITÉS DU GREVIO”, Conseil de l’Europe, mai 2025
“La baisse des financements humanitaires menace les droits des femmes”, ONU info, 13 mai 2025
FRANCE
Gérard Depardieu condamné et la victimisation secondaire reconnue
Le 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé une condamnation à 18 mois de prison avec sursis à l’encontre de l’acteur Gérard Depardieu, reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement deux femmes lors du tournage du film “Les Volets verts” en 2021.
Cette condamnation marque une étape importante dans la reconnaissance de la justice face aux violences sexuelles dans le milieu du cinéma, tout en révélant des enjeux de victimisation secondaire et de stéréotypes sexistes présents dans le système judiciaire français.
Le président de l’audience, Thierry Donard, a souligné que « les déclarations constantes, réitérées et circonstanciées » des deux plaignantes, Amélie* et Sarah*, ont été déterminantes pour le verdict. Il a ajouté que « leurs témoignages, appuyés par des messages écrits détaillant les faits, ont été corroborés par plusieurs témoins », soulignant la crédibilité de leurs accusations. En revanche, il a insisté sur « les incohérences, les explications non crédibles ou tardives » dans la version de Gérard Depardieu, qui, selon lui, « n’a pas semblé saisir la notion de consentement » et « ignore le mal qu’il a causé ». « Le comportement de l’acteur ne respecte pas la dignité des victimes, ni la nécessité de la prise en compte du consentement », a-t-il conclu.
Le tribunal a également reconnu la « victimisation secondaire » subie par les deux femmes lors du procès, notamment dans le contexte de la stratégie de défense de Depardieu. « Les propos outranciers et humiliants tenus par l’avocat de l’accusé ont douloureusement impacté les plaignantes, ce qui justifie une indemnisation spécifique », a précisé le président de l’audience. Les avocates des victimes, Me Carine Durrieu Diebolt et Me Claude Vincent, ont dénoncé ces attaques, parlant d’« une stratégie de dénigrement visant à salir la dignité de leurs clientes » et « une forme d’apologie du sexisme » dans le traitement de l’affaire. Elles ont aussi évoqué la responsabilité de l’État : « C’est l’institution qui aurait dû assurer un cadre respectueux pour que la justice puisse faire son travail. ». En clair, Gérard Depardieu a été condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes non seulement car elles ont été victimes d’une infraction sexuelle qu’il a commise, mais également un autre montant au titre de la victimisation secondaire. Cette reconnaissance est importante puisqu’elle peut poser un précédent et pourrait bénéficier à d’autres victimes de violences sexuelles qui subissent des victimisations secondaires pendant la procédure pénale.
Amélie*, la première plaignante, a exprimé sa satisfaction : « On peut enfin dire que la justice a fait son devoir. C’est une victoire pour toutes celles qui ont eu le courage de parler. Je pense à toutes les femmes qui n’ont pas pu ou voulu témoigner, et à celles qui ont été dissuadées. ». Sarah*, quant à elle, a confié à Mediapart : « Je ressens un soulagement, c’est important pour moi d’avoir été crue. Que cette victimisation secondaire soit reconnue, c’est aussi un message aux victimes : on ne doit pas laisser passer ça. » Elle ajoute : « Ce procès, c’est pour toutes celles qui n’ont pas pu dire non, ou qui ont choisi de se taire. »
Ce jugement intervient à peine quelques jours après l’ouverture du 78e Festival de Cannes, dans un contexte où le mouvement #MeToo continue à faire écho dans le secteur du cinéma, dénonçant des dysfonctionnements systémiques et une « loi du silence » persistante. Pour l’avocate Carine Durrieu Diebolt, « cette condamnation marque un pas vers la fin de l’impunité d’un acteur très connu : on ne peut plus nier la réalité des faits ».
Le procès a été marqué par la virulence de l’avocat de Depardieu, qui n’a pas hésité à qualifier les plaignantes de « menteuses » et à dénigrer leur crédibilité, alimentant une controverse supplémentaire.
Au-delà du cas Depardieu, cette affaire remette en lumière les problématiques persistantes autour de la protection des victimes et des mécanismes de justice face à la violence sexuelle, notamment dans un secteur aussi médiatisé que le cinéma. Lors de la conférence de presse du jury du 78e Festival de Cannes, Juliette Binoche, a déclaré : « Ce verdict nous rappelle que le pouvoir ne doit pas empêcher la justice de faire son travail, et que personne n’est au-dessus des lois. ». « La justice doit rester un espace sécurisé pour les victimes, insiste Me Vincent. La reconnaissance de la victimisation secondaire est un pas essentiel pour leur redonner confiance en la défense de leurs droits. »