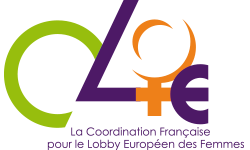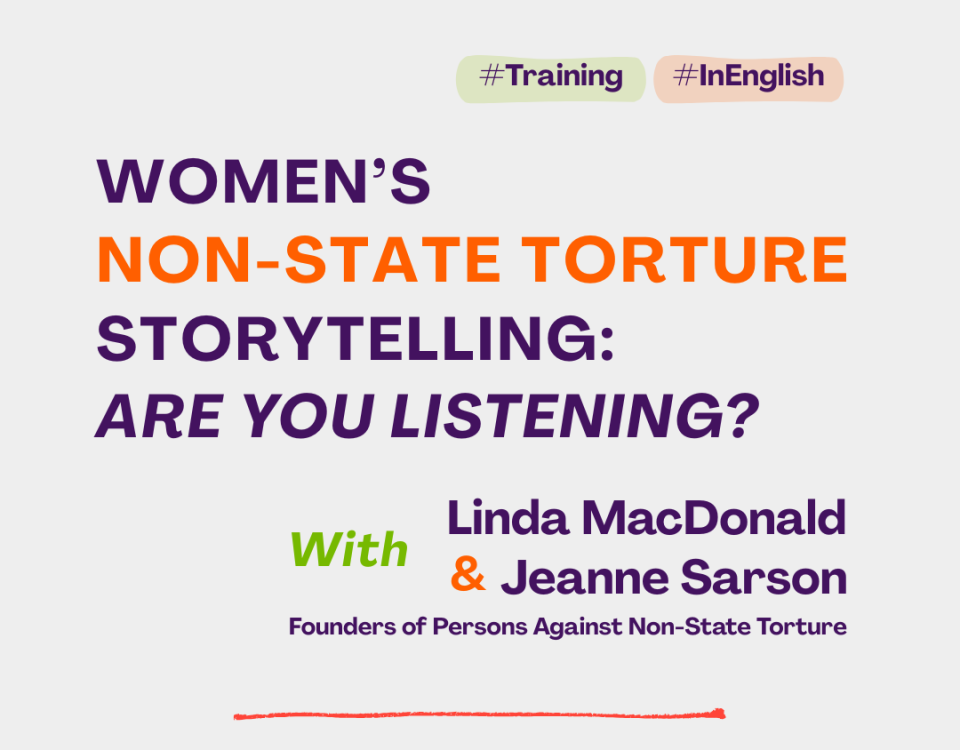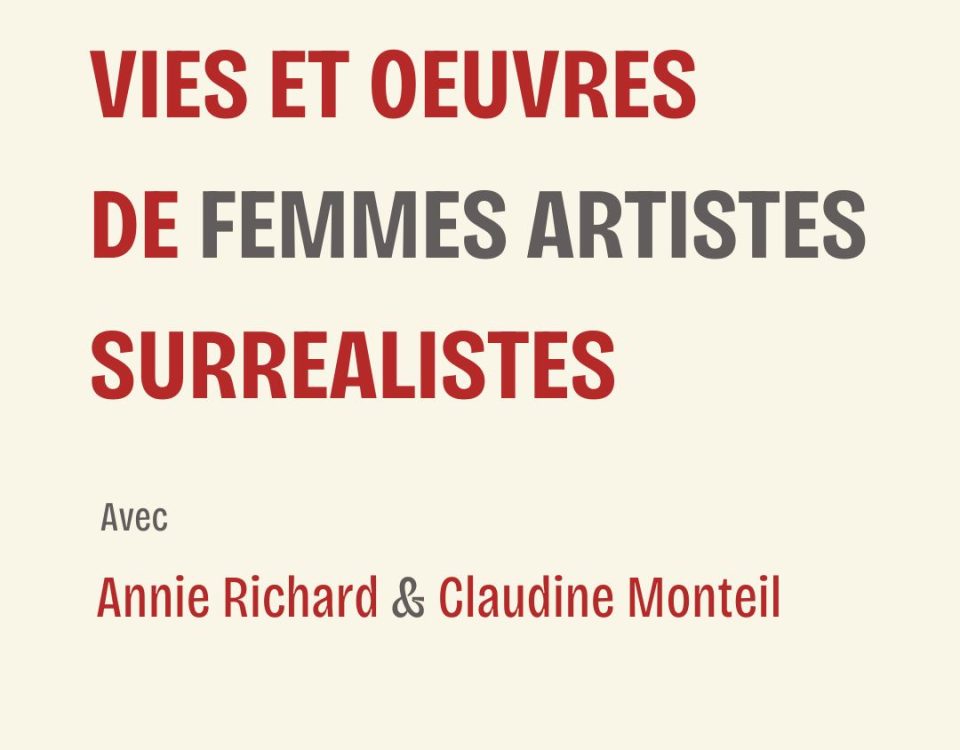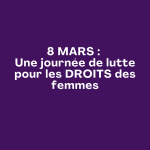
COMMUNIQUE DE PRESSE 07/03/2025 – 8 MARS : Une journée de lutte pour les DROITS des femmes
7 mars, 2025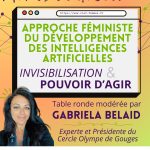
Mardi de la CLEF #40 : Approche féministe du développement des intelligences artificielles
22 avril, 2025Revue de presse féministe & internationale du 14 au 18 avril
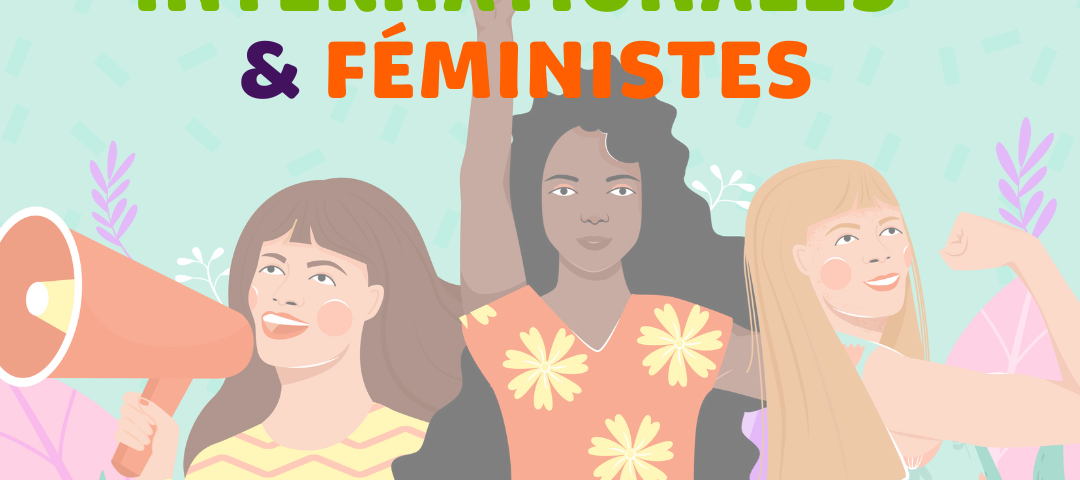
FRANCE
Le rapport sur les violences sexistes dans le monde de la culture a été publié
Ce rapport parlementaire met en lumière une conclusion inquiétante : le secteur culturel français est une “ machine à broyer les talents ”.
Le 9 avril 2025, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, a rendu public un rapport. La commission, présidée par la députée écologiste Sandrine Rousseau et avec comme rapporteur, Erwan Balanant (MODEM), met en lumière les violences systémiques d’un secteur souvent idéalisé. Ce rapport parlementaire met en lumière une conclusion inquiétante : le secteur culturel français est une “ machine à broyer les talents ”. Derrière le rideau, des pratiques généralisées de harcèlement, des agressions passées sous silence, une précarité extrême et un système d’impunité bien rodé. Un univers où le corps, particulièrement celui des femmes, est à la fois outil de travail et objet de domination pour les hommes. « C’est au nom de l’art et de la création que les aspirants artistes sont prêts à tout sacrifier ; c’est aussi au nom de l’art et de la création que d’autres commettent les plus terribles violences. », dénonce le rapport. Sur les plateaux de tournage, dans les salles de répétition, ou derrière les coulisses des défilés, les témoignages recueillis ont révélé des pratiques scandaleuses : enfants, actrices, techniciennes, décoratrices, journalistes, musiciennes, danseuses, toutes et tous sont exposé·es à des rapports de domination.
Le silence est la norme, imposé par la peur de perdre son emploi ou de voir sa carrière ruinée. « Cette minimisation à outrance, intériorisée par les victimes, peut conduire à une forme de déni collectif des violences et de l’omerta qui les accompagne. », indique le rapport. Certaines ont même reçu pour seul conseil de continuer à tourner, malgré les violences, « afin de ne pas mettre en danger leur carrière ». Un constat implacable partagé par les élu·es, résumé par Erwan Balanant : « Fermer les yeux revient à être complice ». La commission dénonce une faiblesse dramatique de l’inspection du travail, quasiment absente dans les milieux culturels : seulement 0,9 % des interventions concernent ces secteurs. En outre, la précarité généralisée des travailleur·euses de la culture rend toute dénonciation encore plus risquée, renforçant les rapports de domination. Dans ce climat, le droit du travail semble parfois inexistant, et les artistes, technicien·nes ou mannequins sont livré·es à eux-mêmes. À cela s’ajoute l’absence de protection des mineur·es, particulièrement exposé·es à la sexualisation précoce à l’écran ou dans les castings. L’accès facilité à l’alcool sur les tournages, la normalisation de comportements déplacés et le manque total de formation des encadrants aggravent encore le risque de violences.
Face à ces constats, la commission formule 86 recommandations pour « assainir et sécuriser » le modèle français de création artistique, telles que :
- L’instauration de formations systématiques pour repérer les situations de violence et de harcèlement dans les écoles d’art, de cinéma et de spectacle vivant,
- Le rééquilibrage paritaire des équipes artistiques (mixtes ou féminines),
- L’interdiction de la sexualisation des mineur·es à l’écran et dans les campagnes de mode,
- L’augmentation des contrôles sur les tournages et la reconnaissance pleine et entière des violences sexuelles (agressions sexuelles, viols, harcèlement…) dans le droit du travail appliqué au monde culturel.
La commission insiste aussi sur la nécessité de produire des données sur les violences sexuelles dans la culture, secteur qui reste à ce jour mal documenté statistiquement. Enfin, une proposition de loi est attendue dans les prochains mois, pour transcrire ces recommandations dans la législation. « Nous devons garantir à toutes les personnes qui œuvrent dans la culture un environnement de travail digne, respectueux et sûr », conclut le rapport.
FRANCE
Le texte sur la parité dans les communes de moins de 1 000 habitants a été adopté : un pas vers l’égalité en politique dans les territoires ruraux
“La parité ne doit plus être une exigence, mais une évidence (…) il est temps que les femmes prennent toute leur place dans la politique locale”, déclarait, dans l’Opinion, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale. Cette allocution fait suite à la publication de son autobiographie, dans laquelle elle revient notamment sur les difficultés qu’elle rencontre en tant que femme en politique.
Ce lundi 7 avril, une nouvelle étape dans l’inclusion des femmes en politique a été franchie : l’Assemblée nationale a définitivement adopté, en seconde lecture après validation par le Sénat, une proposition de loi datant de 2021 imposant la parité sur les listes électorales dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Combien de communes sont concernées ? Près de 25 000, soit environ 70 % des mairies en France (chiffre de l’AFP). Une réforme d’envergure d’autant plus nécessaire que dans les petites communes, les conseils municipaux ne comptent aujourd’hui que 37,6 % de femmes, contre 48,5 % dans les communes les plus peuplées.
Or, comme l’énonce Delphine Lingemann, députée Les Démocrates du Puy-de-Dôme et rapporteure du texte : “La parité ne doit pas s’arrêter aux portes des grandes villes. ” (Le Monde).
Dans cette logique, les équipes municipales devront désormais présenter des listes respectant une stricte alternance femme-homme, afin de garantir un équilibre entre les sexes — un mode de scrutin déjà en vigueur dans les communes de plus de 1 000 habitants depuis 2014. Ce mode de scrutin de liste paritaire vise à favoriser un meilleur engagement local et à améliorer et inciter la représentation des femmes en politique. Il entrera en vigueur dès 2026 c’est-à-dire lors des prochaines élections municipales. Il a également pour objectif de mettre un terme au scrutin dit de » panachage « , qui permettait aux électeurs des petites communes de rayer certains noms sur les listes électorales, notamment ceux des femmes.
Comme pour toutes les questions féministes, cette réforme enflamme les débats dans le monde politique (206 députés ont voté pour et 181 contre). En effet, l’aile droite de l’hémicycle (RN et Les Républicains) s’est presque unanimement opposée à cette loi, estimant qu’elle serait déconnectée des réalités du terrain, invoquant des difficultés rencontrées par les petites communes à trouver des femmes candidates. Cependant, pour Frédéric Roig, président de l’association des maires de l’Hérault, cet argument ne tient pas la route : “ Je ne vois aucune raison d’estimer qu’il est plus difficile de trouver des candidates que des candidats. Quand on cherche la parité, on la trouve. ” (Libération)
Certes, cette loi constitue une avancée en matière de représentativité des femmes dans la politique locale. Toutefois, elle ne suffit pas à lever les obstacles plus profonds et systémiques qui entravent l’exercice effectif des mandats. Comme le rappelle Frédéric Roig dans Libération, le “ manque de disponibilité ”, lié à la charge familiale et professionnelle souvent inégalement répartie, ainsi que le “ machisme ” présent, restent des freins majeurs à l’engagement durable des femmes dans la vie publique locale.
Assemblée Nationale, “Proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité”, 7 avril 2025Lingemann, Delphine. “Engagée pour nos communes rurales”, Delphine lingemann.fr, 8 avril 2025 (communiqué de presse)
INTERNATIONAL
Les femmes catholiques en grève : l’heure de jeûner contre le sexisme
Du 5 mars au 17 avril, durant les quarante jours du Carême, des femmes catholiques du monde entier ont fait grève pour dénoncer les inégalités femmes-hommes dont elles sont victimes au sein de l’institution.
Ce mouvement intitulé “ Catholic Women Strike ” a été initié, à l’origine, par l’association américaine Women’s Ordination Conference basée aux États-Unis. En France, le mouvement a été mené par l’association féministe catholique, Magdala (anciennement connue sous le nom de Comité de la Jupe).
Quelles sont les causes de ce mouvement ?
Ce sont majoritairement les femmes par leur travail bénévole qui assurent le fonctionnement quotidien des paroisses : catéchèse, préparation des célébrations, entretien des églises, etc. Selon l’organisation Magdala, les femmes effectuent plus de 80% des tâches essentielles dans les églises.
Pourtant, malgré leur rôle central, elles demeurent invisibles dans les structures de pouvoir de l’Église, où les responsabilités décisionnelles restent strictement masculines (curés, prêtres, évêques). À travers cette grève, l’objectif est de souligner l’importance de leur rôle et de réfléchir aux manières de réformer, une bonne fois pour toutes, les pratiques de l’Église catholique.
Concrètement, le mouvement a invité chacun·e à exprimer sa solidarité envers les femmes dans l’Église à travers de multiples actions, comme suspendre pendant un temps l’engagement bénévole, prier en dehors de l’Eglise, parler de la question autour de soi, écrire une lettre au diocèse, etc ; Le but étant de remarquer le travail invisibilisé et, surtout, d’interpeller les autorités ecclésiastiques sur l’urgence d’un changement.
Or, même si leur action a été relayée dans de nombreux médias et a pris une certaine ampleur, aucune réponse n’a été donnée par le Vatican à ce jour.
Magdala. “Grève internationale des femmes catholiques”, Magdala, 26 février 2025
UNION EUROPÉENNE
Des nouveaux chiffres sur l’exploitation sexuelle des femmes en Europe
« Près des deux tiers des victimes enregistrées de la traite des êtres humains étaient des femmes ou des filles en 2023. » – Eurostat
Selon les derniers chiffres publiés par Eurostat, la traite des êtres humains a atteint un niveau record en 2023 dans l’Union européenne, avec 10 793 victimes recensées, soit une hausse de 6,9 % par rapport à l’année précédente. C’est le chiffre le plus élevé depuis 2008. Si cette augmentation est en partie attribuée à une meilleure identification des victimes par les systèmes judiciaires et sociaux, elle n’en reste pas moins alarmante : près des deux tiers des victimes sont des femmes ou des filles, soit un taux en légère hausse par rapport à 2022 (+0,5 point). L’exploitation sexuelle demeure la forme de traite prédominante en Europe, représentant 43,8 % des cas où la nature de l’exploitation a pu être identifiée.
Les victimes de la traite d’êtres humains proviennent majoritairement de pays non membres de l’UE (64,1 %). 28 % des victimes sont originaires du pays dans lequel elles sont exploitées, illustrant une préoccupation nationale et transnationale. Cette dimension est au cœur de la stratégie européenne de lutte contre la traite qui repose sur quatre piliers : la réduction de la demande, le démantèlement des réseaux criminels, la protection des victimes et la coopération renforcée entre États membres. C’est dans ce contexte qu’a été démantelé le 1er avril 2025 un vaste réseau de trafic de migrants entre les Balkans et la France.
Au terme de plus de deux ans d’enquête, près de 300 gendarmes ont été mobilisé·es pour interpeller 24 personnes dans plusieurs régions françaises, ainsi qu’en Italie. Les victimes, principalement des femmes et des enfants afghan·nes, syrien·nes, libyen·nes, irakien·nes ou iranien·nes, étaient entassées dans des fourgons, puis convoyé·es clandestinement via les frontières serbo-hongroises et gréco-turques vers la France ou d’autres pays européens.
La France n’échappe pas à cette réalité, comme l’a révélé l’affaire des “ vendanges de la honte ” en Champagne, dont le procès a été renvoyé à juin 2025. Des sous-traitants de grandes maisons de champagne sont accusés de traite d’êtres humains pour avoir exploité des femmes et des hommes travaillant en contrat saisonnier, principalement d’origine étrangère, dans des conditions indignes : logement insalubre, absence de contrats, rémunération aléatoire. Certaines victimes n’avaient ni eau courante, ni accès à des toilettes. Ces personnes ont été exploitées notamment en raison de leur vulnérabilité administratives et de leur sexe. D’autres affaires criminelles sont en cours pour des faits d’exploitation sexuelle et de trafics d’êtres humains.
Si les chiffres alertent, c’est aussi la vulnérabilité structurelle des femmes et des filles qui frappe : elles sont ciblées parce qu’elles sont des femmes (pauvres, migrantes etc) et donc exploitées sexuellement dans un système où la précarité, l’isolement et le manque de moyens de protection contribuent à les mettre en danger. Eurostat souligne que les statistiques ne reflètent qu’une partie de la réalité, tant la traite reste largement sous-déclarée.
Face à cette recrudescence, les États membres sont appelés à renforcer les mécanismes de protection, de prévention et de répression. Malgré les efforts institutionnels, comme la stratégie 2021-2025 de l’Union européenne ou le réseau « Together Against Trafficking in Human Beings » qui fédère les États membres, les dispositifs de protection restent insuffisants, notamment en ce qui concerne la prise en compte des violences fondées sur le sexe. La révision de la directive européenne sur la traite, actuellement en cours, vise à renforcer les sanctions, améliorer l’identification des victimes et obliger les États membres à collecter des données genrées et à offrir un accompagnement spécialisé aux femmes et filles victimes d’exploitation.
Commission européenne. “ EU Countries. Together Against Trafficking in Human Beings”
“Réfugiés & Balkans : les dernières infos”. Le Courrier des Balkans