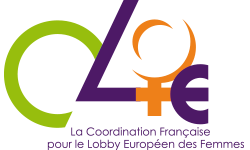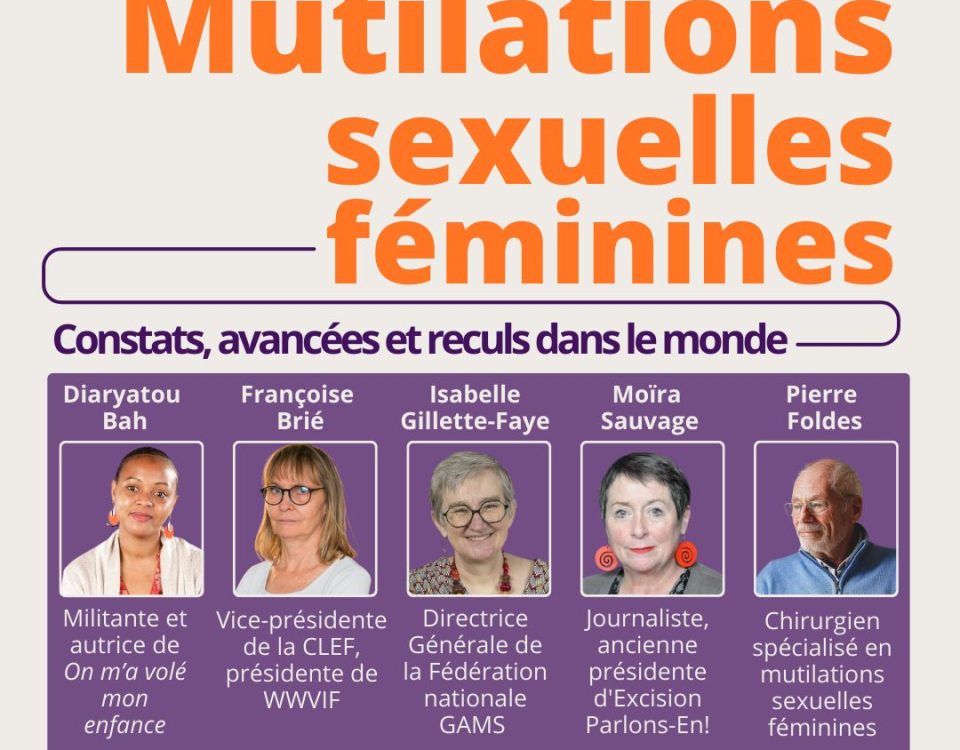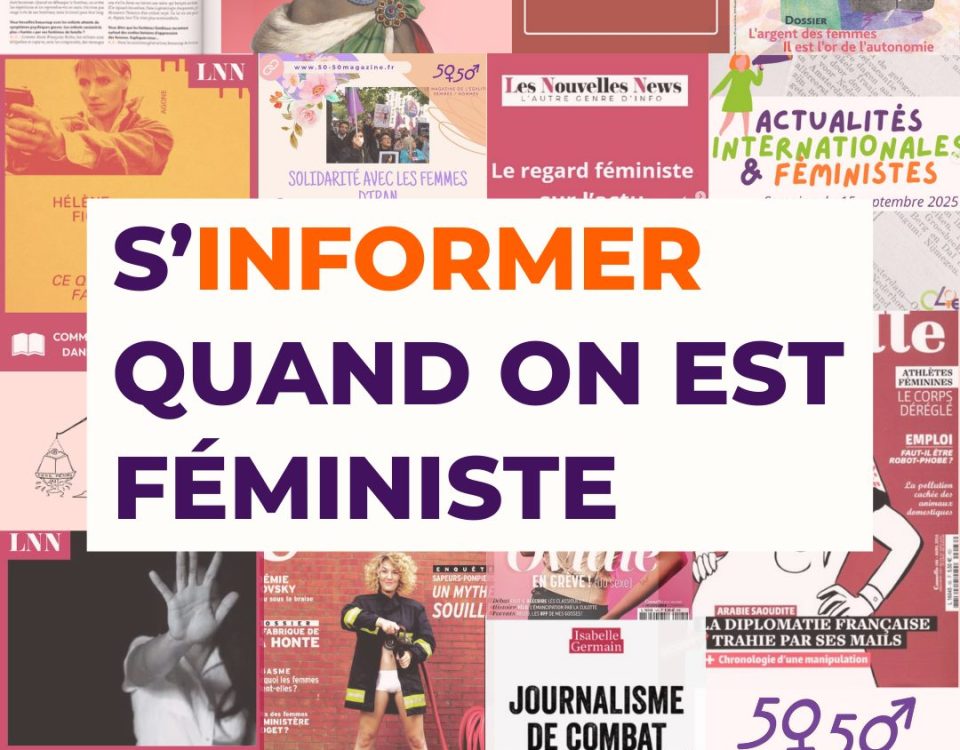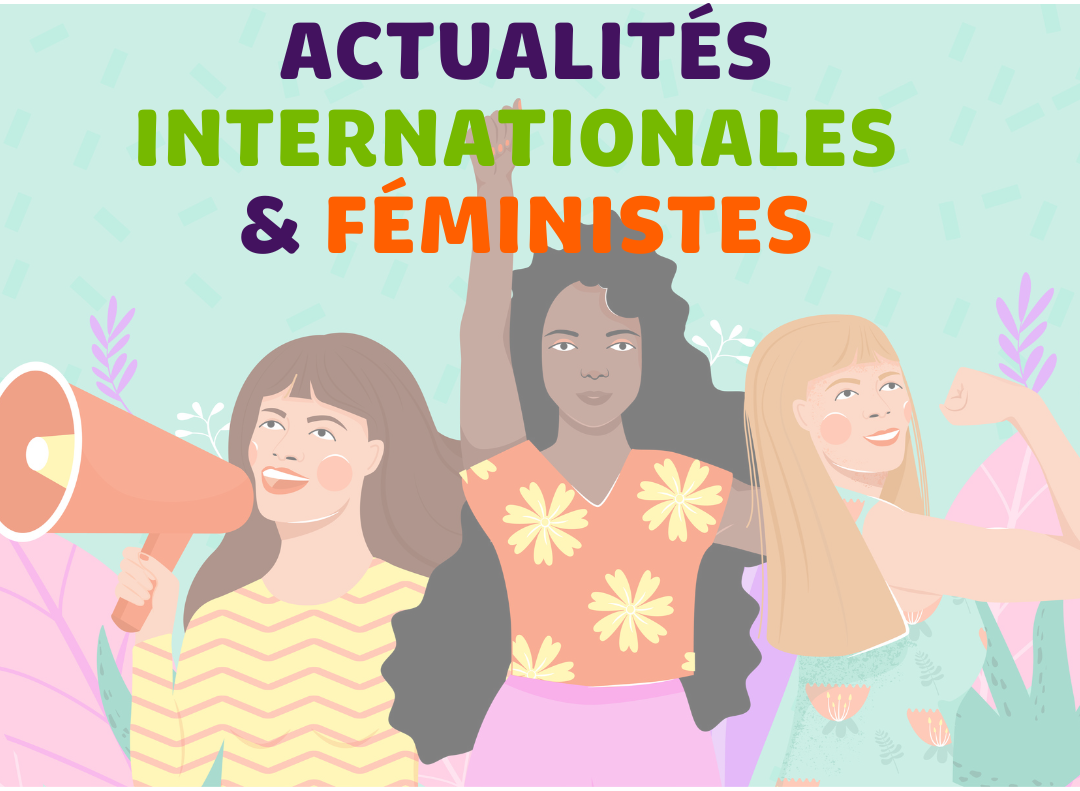
Revue de presse féministe & internationale du 14 au 18 juillet 2025
18 juillet, 2025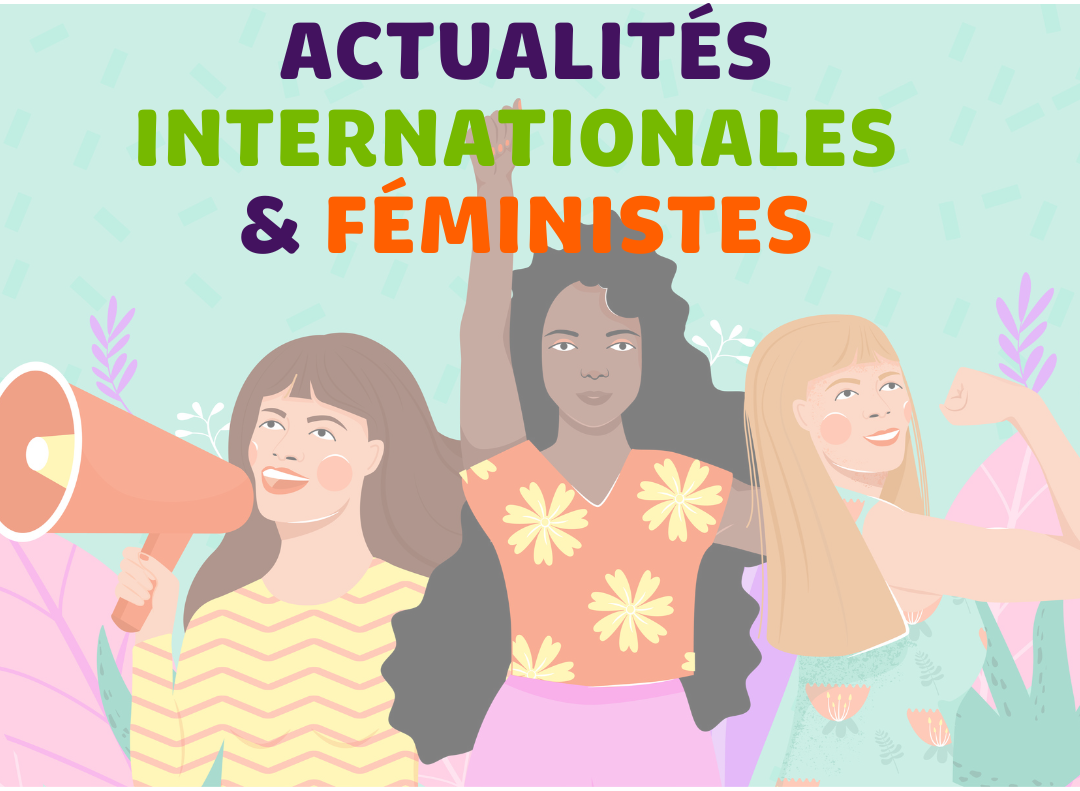
Revue de presse féministe & internationale du 01 au 05 septembre 2025
5 septembre, 2025Revue de presse féministe & internationale du 25 au 29 août 2025
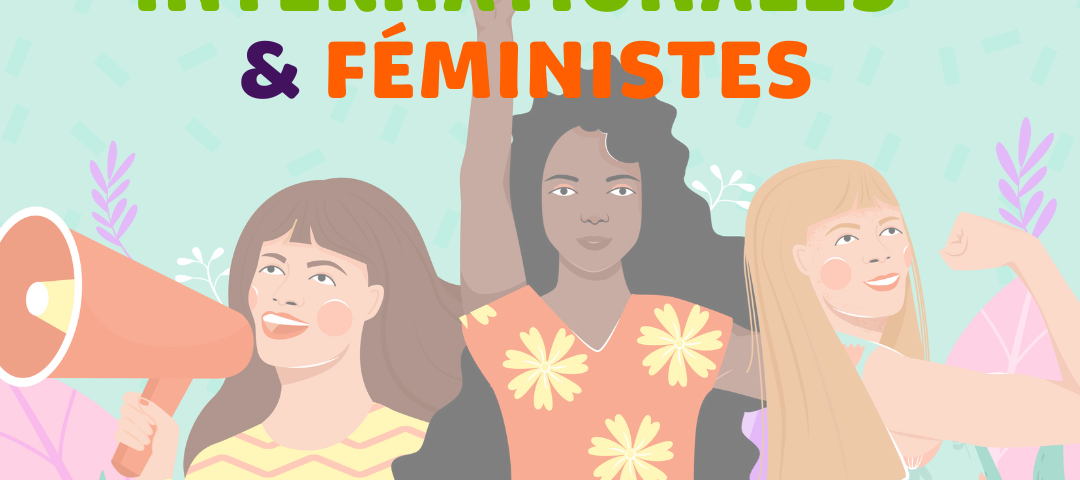
ALGÉRIE
Liberté de résidence : l’Algérie retire sa réserve à la Convention CEDAW
L’Algérie a retiré, par décret présidentiel, sa réserve concernant l’article 15-4 sur le choix de la résidence et du domicile de la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
Que dit l’article 15-4 de la Convention ?
L’article 15 alinéa 4 de la CEDAW stipule : « Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en matière de loi concernant le choix de leur résidence et de leur domicile. »
Cette clause oblige les États signataires à garantir aux femmes les mêmes droits de voyager, de se déplacer et de choisir leur lieu de vie à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs frontières, sans aucune restriction fondée sur leur sexe.
Selon l’agence Algérie Presse Service, lors de la ratification de la CEDAW en 1996, l’Algérie avait formulé une réserve sur l’article 15-4 en raison de son incompatibilité avec l’article 37 du code de la famille en vigueur à l’époque. Or, cet article a été abrogé en 2005, ce qui a privé la réserve de tout fondement juridique dans le droit national.
Ainsi, aucune disposition du droit national n’imposait encore de restrictions aux femmes dans ce domaine, ce qui rendait la réserve caduque. Comme le déclare l’APS, la levée de celle-ci ne traduit donc aucun changement immédiat : l’Algérie a pour habitude d’adapter d’abord sa législation avant de retirer, dans un second temps, les réserves formulées sur le plan international.
Dans les faits, les femmes en Algérie ont la liberté de résidence et de circulation. Selon les statistiques officielles, les Algériennes d’aujourd’hui représentent plus de 60 % des effectifs universitaires et 40 % du corps de la magistrature. La décision a au moins le mérite d’inscrire cette réalité dans un cadre juridique
Ainsi, ce n’est que 20 ans plus tard, depuis le 4 août 2025, que la réserve a été officiellement retirée, par décret présidentiel.
Il est important de souligner que la décision récente de l’Algérie de lever sa réserve concernant l’article 15-4 a provoqué de vives réactions, alimentant les débats sur les réseaux sociaux et jusque dans la sphère politique.
Pour certains, cette décision représente une avancée supplémentaire dans la consolidation des droits des femmes, alors que pour d’autres, elle constitue une concession aux normes internationales perçues comme éloignées des traditions nationales.
L’ancien président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri, a critiqué cette décision, estimant que la CEDAW est « dangereuse » car elle « contribue à fragmenter les familles et à soumettre les sociétés au modèle occidental » et que l’Algérie aurait cédé aux « pressions occidentales ».
De son côté, le Rassemblement national démocratique (RND) a défendu la décision. Dans un communiqué, il a répondu aux critiques et affirme que « (…) la liberté de circulation et de résidence n’est pas un concept étranger. Elle est au cœur des objectifs de l’Islam, qui sont fondés sur la justice et la dignité ».
MAYOTTE – FRANCE
Les sages-femmes dénoncent des conditions de travail indignes
À Mayotte, la plus grande maternité de France, près de 10 000 naissances chaque année, fonctionne aujourd’hui dans des conditions que les sages-femmes qualifient d’« enfer ».
Depuis le 14 août 2025, elles exercent leur droit de retrait au centre hospitalier de Mayotte (CHM), tout en assurant les urgences vitales. Épuisées et en sous-effectif chronique, elles alertent sur les dangers qui pèsent autant sur leur santé que sur celle des patientes et des nouveau-né·es.
Déjà fragilisé par le manque de soignant·e·s et l’isolement du territoire, l’hôpital de Mamoudzou a vu sa situation s’aggraver après le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Toitures éventrées, plafonds effondrés, salles insalubres et les dégâts matériels s’accumulent avec une pénurie de personnel. Selon l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes, le service ne compte plus que 43 professionnel·le·s, dont sept réservistes, alors qu’il en faudrait au minimum 120 pour assurer la sécurité des patientes.
« Nous suivons parfois dix à quinze femmes en même temps aux urgences », témoigne Stéphanie, sage-femme au CHM (Le Monde). « Nous faisons jusqu’à seize gardes par mois. Avec des plages horaires de quarante-cinq à cinquante heures par semaine. C’est un rythme effréné et un non-respect des règles de sécurité. La fatigue s’accumule. Dans ces conditions, il est difficile de se concentrer et de ne pas se louper.»
Le manque d’espace et de matériel conduit à des situations inimaginables en France. Seulement sept salles d’accouchement pour une activité qui en nécessiterait au moins seize, des femmes qui accouchent sur des brancards dans les couloirs, derrière des draps suspendus que les soignantes appellent leurs « tipis ». Certaines patientes sont hospitalisées dans des chambres triples, parfois sans berceaux ni sonnette pour alerter en cas d’urgence. « En métropole, jamais on ne tolérerait cela », s’indigne Fanny, sage-femme de 30 ans.
À Kahani, centre périphérique réalisant plus de 1 400 accouchements par an sans gynécologue ni anesthésiste, le cyclone a détruit les faux plafonds, laissant entrer chauves-souris et makis jusque dans les salles d’accouchement.
Depuis 2023, la fermeture des maternités de Dzoumogné et Mramadoudou a encore accru la pression sur Mamoudzou. Le turn-over reste massif : « C’est un cercle sans fin. Les collègues préfèrent ne pas renouveler leur contrat de courte durée en raison des conditions de travail et de l’épuisement. Je suis en poste depuis deux ans. C’est très long ici pour une sage-femme. », témoigne Aline. (Le Monde)
La direction du CHM promet des renforts rapides, vingt-trois recrutements annoncés en septembre, ainsi que l’arrivée de douze réservistes, et des mesures financières pour rendre le poste plus attractif. Mais pour Cloé Mandard, présidente du conseil départemental des sages-femmes de Mayotte, ces annonces sont insuffisantes : « Dix à quinze recrutements ne changeront rien. Cela ne peut plus continuer.
Alors que la natalité à Mayotte reste la plus élevée de France, les sages-femmes craignent que la crise, si elle perdure, mette durablement en péril la sécurité des mères et des bébés. Pour l’ONSSF, « les conditions d’accueil sont indignes pour les patientes et présentent des « risques graves pour la sécurité des mères et des nouveau-nés » et appellent à des mesures immédiates.
FRANCE
Marine Rosset contrainte à la démission de la présidence des Scouts et guides de France
Élue le 14 juin 2025 à la tête des Scouts et guides de France (SGDF) à la quasi-unanimité (22 voix 24), Marine Rosset, conseillère socialiste du 5e arrondissement de Paris, a annoncé sa démission le 6 août, après seulement quelques semaines de mandat. Homosexuelle et défenseuse du droit à l’avortement, cette femme de 39 ans a été la cible d’attaques répétées de la part de personnes d’extrême droite et de milieux catholiques conservateurs.
Dans un entretien accordé à La Croix, elle se dit « en colère » et profondément blessée par les critiques visant à la fois son engagement politique et sa vie privée : « On a parfois pu remettre en cause ma foi, du fait de mon homosexualité. C’est blessant. » Elle dénonce également l’instrumentalisation de ses prises de position, assimilées à tort à celles du mouvement scout, et la violence des attaques subies : « J’ai été attaquée tous les jours sur les réseaux sociaux, avec des messages souhaitant ma disparition. »
Si sa démission est motivée par le souhait de « protéger le mouvement », elle s’explique aussi par un contexte politique, une élection législative partielle doit se tenir cet automne dans sa circonscription, où Mme Rosset a déjà été candidate. Craignant que ses engagements personnels soient exploités pour discréditer le scoutisme, elle a préféré se retirer.
Les SGDF, première organisation de scoutisme en France avec plus de 100 000 adhérent·es, ont fermement condamné les « propos violents, discriminants ou déshumanisants » ayant visé leur présidente et rappelé que « ces violences, notamment homophobes, sont profondément contraires à notre éthique éducative et associative ». L’association soutient la plainte déposée par Mme Rosset début juillet, et envisage de se constituer partie civile.
Cette affaire illustre les tensions persistantes dans l’Église catholique face à l’intégration de responsables homosexuel·le·s. Malgré un mouvement reconnu pour son ouverture, les soutiens institutionnels à Marine Rosset ont été rares, et certains aumôniers du scoutisme ont exprimé leur opposition à sa nomination.
Marine Rosset reste administratrice des SGDF, tandis qu’une gouvernance collégiale a été mise en place, sous la présidence de Pierre Monéger. À gauche, de nombreuses voix, notamment du PS, ont exprimé leur solidarité, dénonçant une « vague d’homophobie » et un « harcèlement inacceptable ».
MADAGASCAR
Céline Ratsiraka, figure du féminisme malgache, est décédée
Ce vendredi 22 août 2025, l’ancienne Première dame malgache, Céline Ratsiraka, s’est éteinte à l’âge de 87 ans. Épouse de Didier Ratsiraka, président de Madagascar de 1975 à 1993 puis de 1997 à 2002, elle s’est engagée pour les droits des femmes malgaches, notamment sur la question du divorce.
En effet, l’ancienne Première dame a joué un rôle actif dans la promotion de la loi Zara-Mira, adoptée en 1990, qui a modifié le régime des biens du couple : auparavant, la femme ne recevait qu’un tiers des biens, alors qu’après cette loi, le partage s’est fait à parts égales.
En outre, elle était également dirigeante politique, ayant créé et dirigé la branche féminine du parti Arema de l’ancien président Ratsiraka. Elle a notamment créé un réseau de crèches communautaires appelées Akanin-jaza, afin de permettre aux mères de travailler.
Interrogée par RFI, Marie Christina Kolo, co-fondatrice du mouvement féministe malgache Women Break the Silence déclare : « C’est une branche qui a permis de mobiliser et de former des femmes à la politique, pour les inciter à avoir cette conscience politique, à adhérer à cette révolution socialiste, une révolution qui prônait justement l’égalité. C’était innovant pour la période. Avec sa sœur Hortense, elles représentaient une aile plus progressiste du parti et tenaient tête aux personnes les plus conservatrices ».