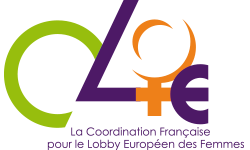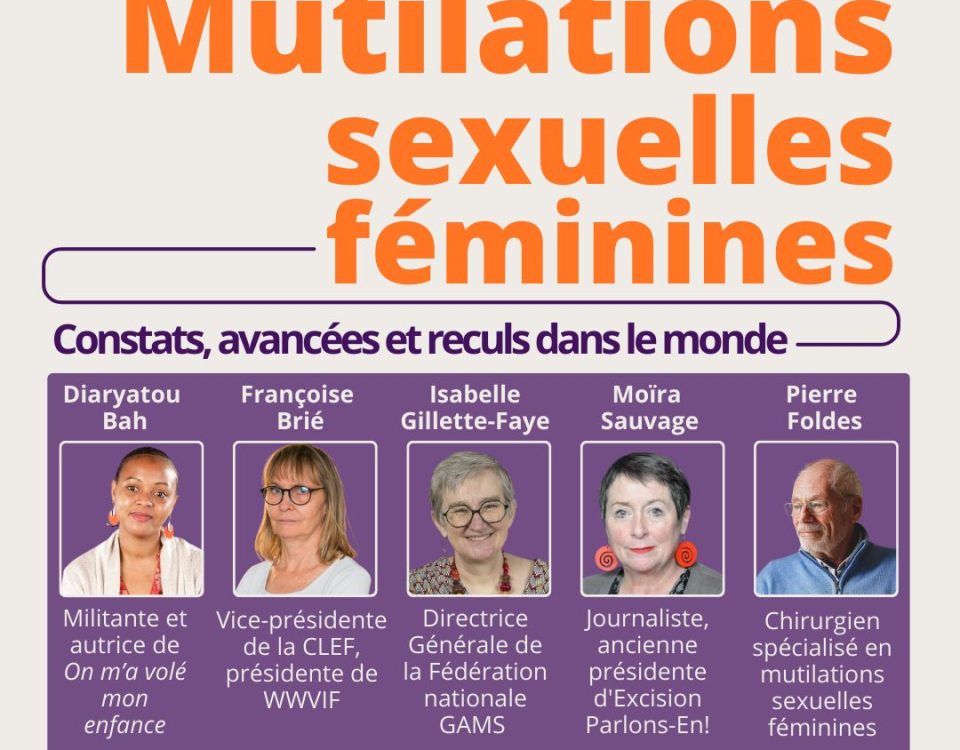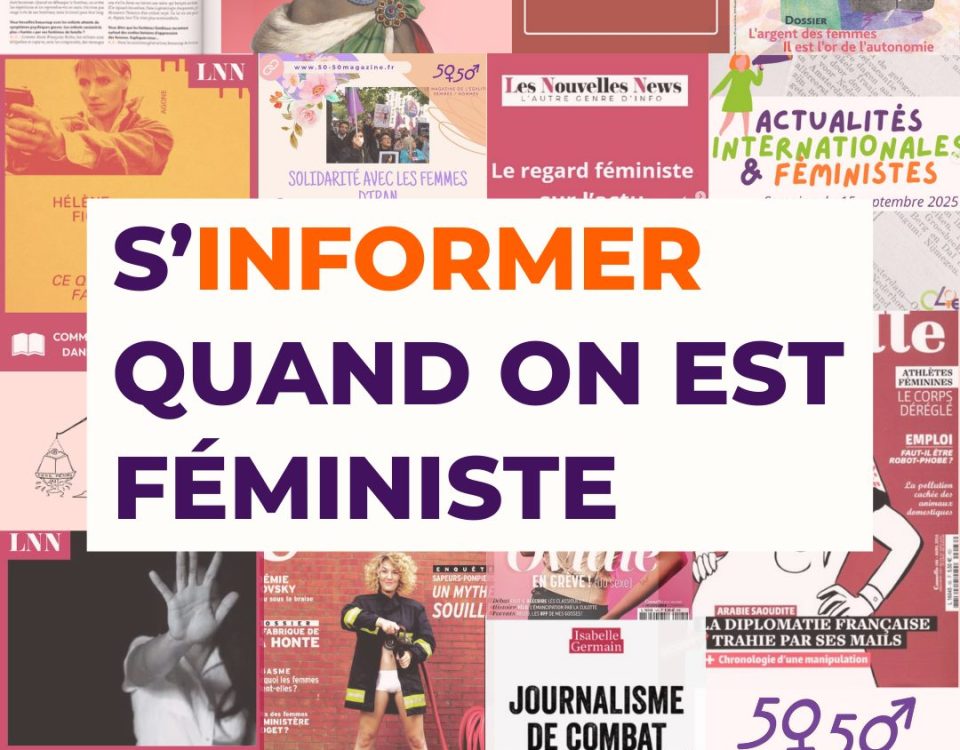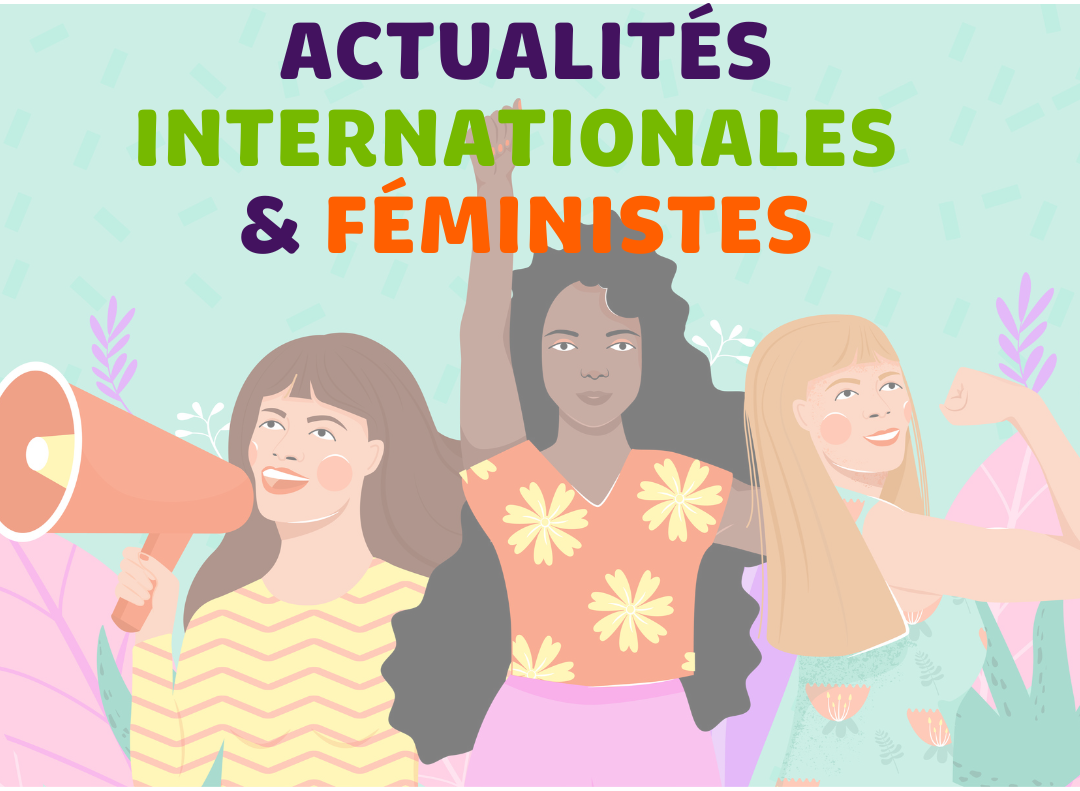
Revue de presse féministe & internationale du 30 juin au 4 juillet
4 juillet, 2025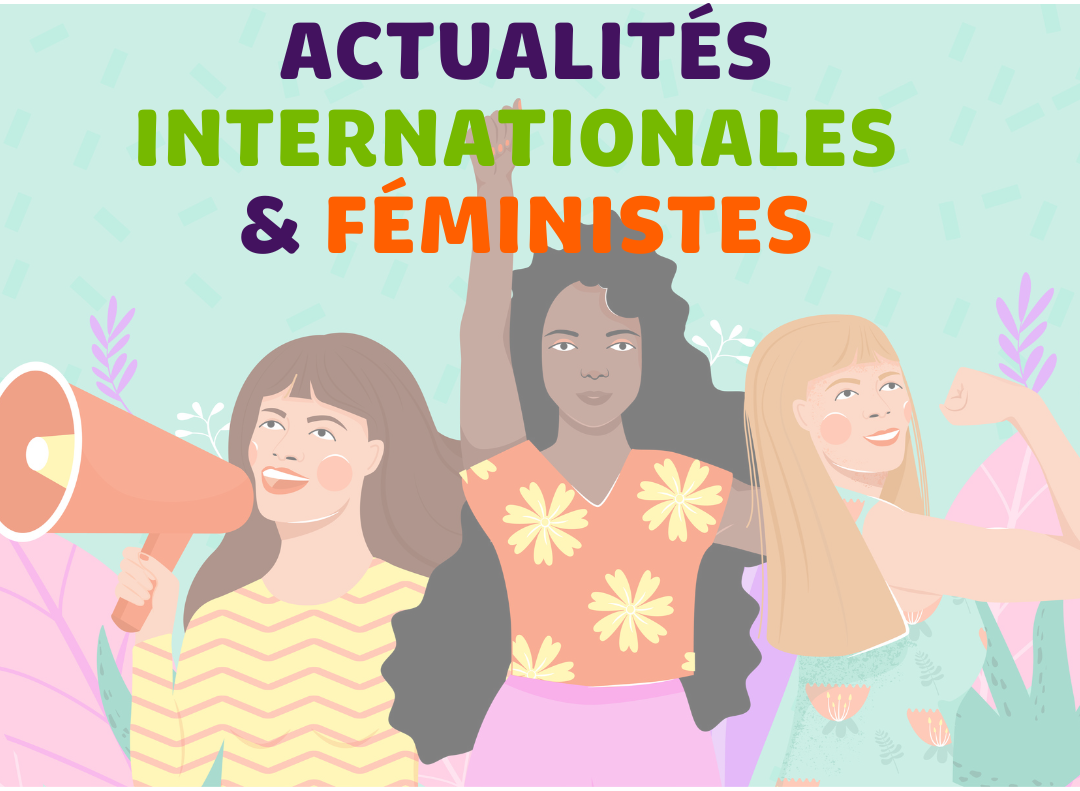
Revue de presse féministe & internationale du 14 au 18 juillet 2025
18 juillet, 2025Revue de presse féministe & internationale du 07 au 11 juillet 2025
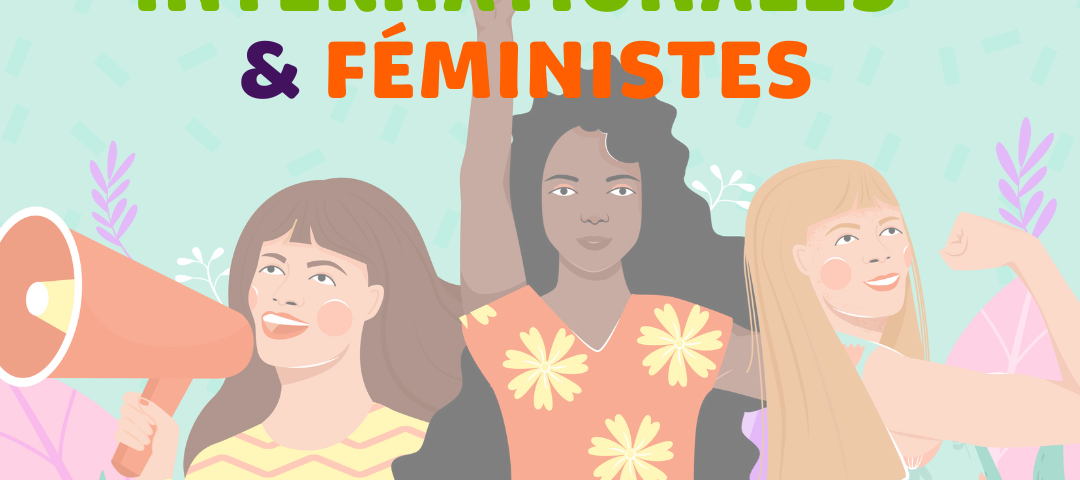
EUROPE
Le Conseil de l’Europe adopte une résolution pour renforcer les droits des femmes face aux défis grandissants
Le 26 juin, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a débattu des avancées et des défis des droits des femmes en Europe. Le débat a permis de mettre en lumière les défis persistants et l’érosion de ces droits dans un climat de polarisation en Europe mais aussi à l’international.
La tenue de ce débat s’est imposée dans le sillage de la CSW à New York et à la suite de la publication d’un rapport deux jours plus tôt réalisé par Mme Petra Bayr du Groupe des socialistes, démocrates et verts au sein de la commission sur l’égalité et la non-discrimination.
Lors de ce débat d’urgence, l’Assemblée parlementaire a exprimé son inquiétude face à l’instrumentalisation des valeurs familiales contre les droits des femmes, à la désinformation sexiste, à la montée des discours masculinistes, à la hausse des féminicides, ainsi qu’aux violences, menaces et (cyber-)harcèlements visant les femmes politiques, les défenseur·es des droits et les professionnel·les de santé, ainsi que les personnes qui cherchent à bénéficier de soins liés à l’avortement.
L’ancienne présidente de la CLEF, Céline Thiébault-Martinez, députée à l’Assemblée nationale et porte-parole du groupe des socialistes, démocrates et verts au Conseil de l’Europe, a déclaré : “Alors oui, ce débat est urgent. Urgent, car en 2024, selon l’ONU, les droits des femmes ont reculé dans un pays sur quatre. Urgent, car les conflits armés se multiplient et les violences sexuelles en zone de guerre ont augmenté de 50 % en dix ans. Urgent, car partout sur la planète, en Europe comme ailleurs, les femmes sont prises pour cible, et l’exaltation de la famille traditionnelle est à la mode.”
L’Assemblée parlementaire, sur la base du rapport de Petra Bayr, a adopté une résolution proposant des mesures pour lutter contre la violence faite aux femmes et la violence domestique, en ciblant notamment le faible taux de signalement et l’impunité. Elle a aussi insisté sur l’importance de garantir l’accès aux droits sexuels et reproductifs, et a affirmé que toute entrave à l’accès légal à l’avortement devait être interdite et sanctionnée pénalement.
La résolution du Conseil de l’Europe, intitulée « Droits des femmes en Europe – Progrès et défis », appelle les États membres et les États observateurs à prendre une série de mesures concrètes pour faire face aux reculs constatés en matière de droits des femmes.
Elle demande en premier lieu la ratification de la Convention d’Istanbul, considérée comme un instrument clé dans la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique. La résolution note que « le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul constitue un signal d’alerte, d’autant plus que les organisations de la société civile turque ont signalé que cette décision a été précédée de réactions hostiles de plus en plus vives contre le concept de genre et, par conséquent, de l’égalité de genre. »
Elle insiste sur la nécessité de protéger les droits sexuels et reproductifs, en garantissant un accès sûr, légal et effectif aux soins de santé reproductive, y compris à l’avortement.
Elle appelle à renforcer la représentation des femmes dans la vie politique, en particulier dans les fonctions dirigeantes et les postes de prise de décision. D’ailleurs, dans le même temps, la résolution 2615, intitulée « Promouvoir la participation inclusive dans la vie parlementaire : égalité de genre, accessibilité et politiques inclusives », a été adoptée. Elle vise, quant à elle, à inciter les parlements à créer les conditions nécessaires pour garantir une participation inclusive, l’égalité de genre et d’autres formes d’égalité et d’inclusion (inclusion des femmes, des parents, des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite).
La résolution souligne l’urgence de lutter contre le sexisme, la misogynie, les stéréotypes sexistes, ainsi que les mouvements et discours antisexistes qui remettent en cause les acquis en matière d’égalité. Par exemple, il est demandé aux Etats de prendre des mesures pour prévenir et combattre les formes en ligne de violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes (art. 20.1.6) notamment en « [renforçant] la lutte contre l’exploitation sexuelle en ligne, en portant une attention particulière aux risques posés par le développement de l’intelligence artificielle » (amendement déposé par Céline Thiébault-Martinez).
Elle recommande aux États de garantir un financement pérenne et suffisant pour soutenir les politiques publiques et les initiatives en faveur de l’égalité.. Par exemple, la résolution demande aux États de lancer des programmes éducatifs sur la prévention et la lutte contre les stéréotypes sexistes à l’école, dès le plus jeune âge (art. 20.4.3). Elle encourage également à considérer la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes comme une problématique qui doit être transversale dans toutes les législations et politiques nationales.
Enfin, la résolution invite les États à organiser régulièrement des débats sur les droits des femmes, pour maintenir ces enjeux au centre du débat public et politique.
Rapport et Résolution, “Les droits des femmes en Europe – Avancées et défis”, APCE, 26 juin 2025
FRANCE
Un attentat incel déjoué à Saint-Etienne : vers une prise de conscience du mouvement ?
Le 2 juillet 2025, un jeune homme de 18 ans a été interpellé par la police de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et mis en examen à Saint-Étienne alors qu’il projetait une attaque ciblant des femmes dans un lycée, armé de deux couteaux. Il se réclamait du mouvement masculiniste « incel » (célibataire involontaire).
Pour la première fois en France dans une affaire liée à l’idéologie masculiniste, le parquet national antiterroriste (PNAT) s’est saisi du dossier. Cette décision est lourde de sens : la menace masculiniste entre désormais dans le viseur de l’antiterrorisme français.
La politologue Marion Jacquet-Vaillant définit le groupe incel comme un groupe d’hommes qui considère qu’ils sont célibataires involontaires, à la fois par la faute des femmes — en tant que personnes et en tant que groupe — mais aussi par la faute de l’évolution de la société : la libération des femmes a rendu les structures traditionnelles du couple, dont elles se sont affranchies, moins nécessaires pour elles. En intégrant ce groupe, ces hommes rejoignent ce que Stéphanie Lamy appelle « une identité politique, victimaire » ainsi qu’« un corpus structuré, avec ses martyrs, ses manifestes, ses rites, ses codes, ses références communes ».
En France, même s’il n’existe pas de chiffres officiels concernant le nombre d’hommes faisant partie de la communauté des incels (300 à 400 selon Libération), le chiffre est en croissance notamment en ligne, sur des réseaux sociaux tels que Telegram ou TikTok. Déjà l’année dernière, en 2023, un homme avait tenté de réaliser un projet d’action violente lors du passage de la flamme olympique à Bordeaux. Comme le dit Marion Jacquet-Vaillant pour le Monde, cet homme est désormais considéré comme une figure emblématique, car il voulait perpétrer l’attentat le jour de la mort d’Elliot Rodger, auteur du premier attentat incel en 2014 aux États-Unis.
L’enjeu ici dans la traitement de l’information est selon Stéphanie Lamy de ne pas « minimiser la nature politique de ce type d’attentat » car comme elle le rappelle « l’objectif stratégique des mouvances masculinistes est de minorer leur propre dangerosité, dans le but de normaliser les violences à l’encontre des femmes et des minorités de genre et ainsi asseoir la domination totale des hommes cis ». Comme le rappelle la spécialiste, outre la promotion et l’utilisation de la violence, le mouvement vise à « transformer les normes sociales, à remodeler les valeurs collectives, souvent en instrumentalisant les biais qui structurent la production de l’information (…) et les médias peuvent en devenir des relais, parfois involontaires. »
En conséquence, minimiser la portée idéologique et politique de ces actes violents viendrait à prolonger leur stratégie et reviendrait à leur faire de la publicité. Ainsi, Stéphanie Lamy appelle les journalistes et les responsables publics à comprendre les mots et l’impact du sujet pour pouvoir « commencer à désamorcer son pouvoir de nuisance ».