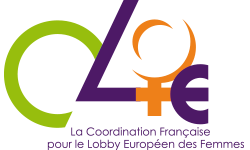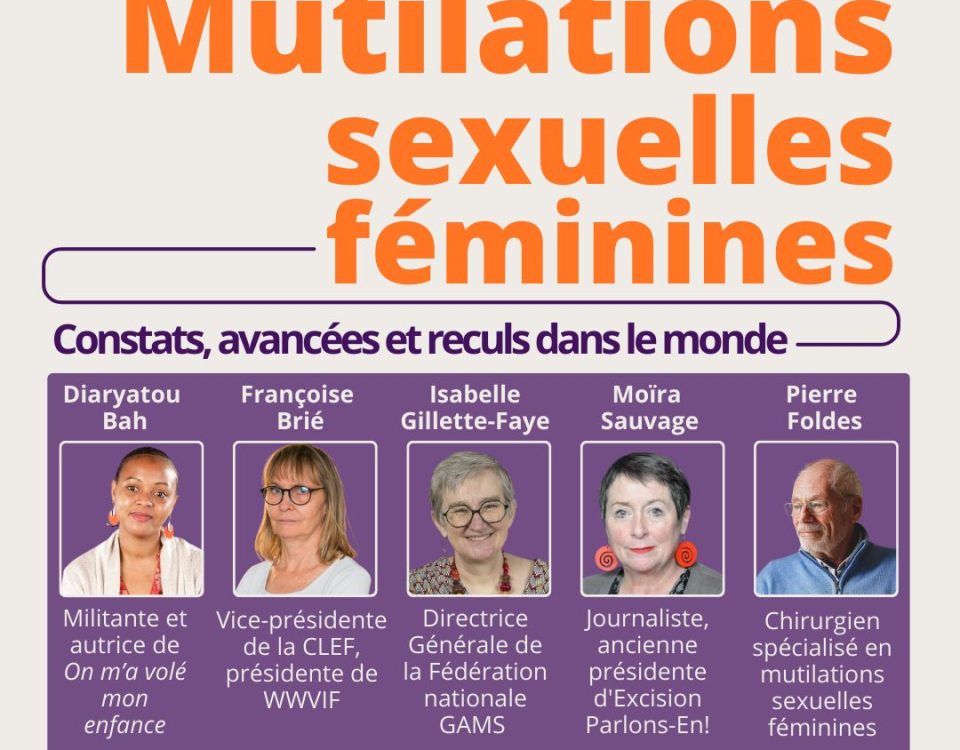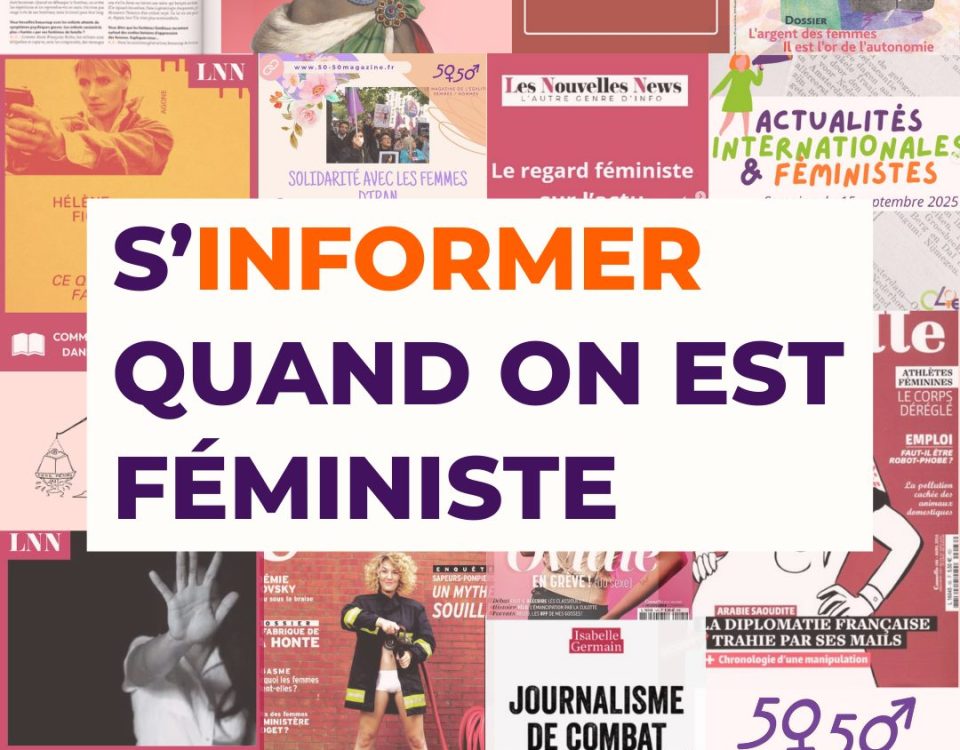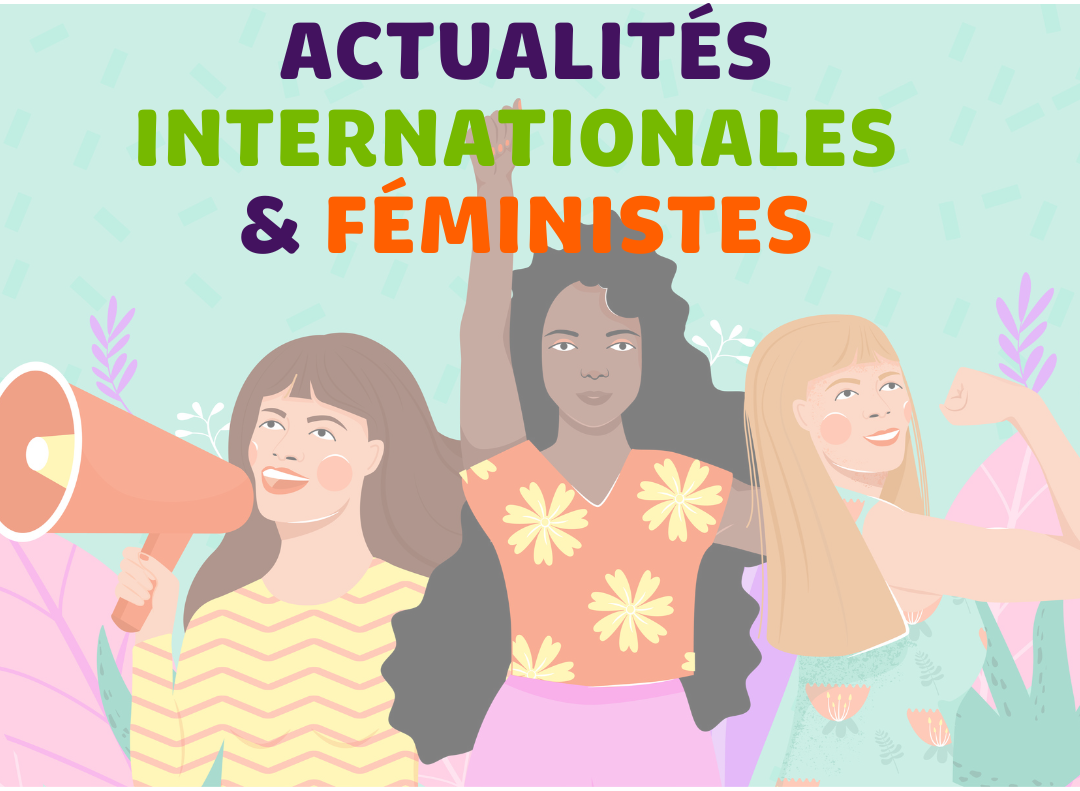
Revue de presse féministe & internationale du 23 au 27 juin
27 juin, 2025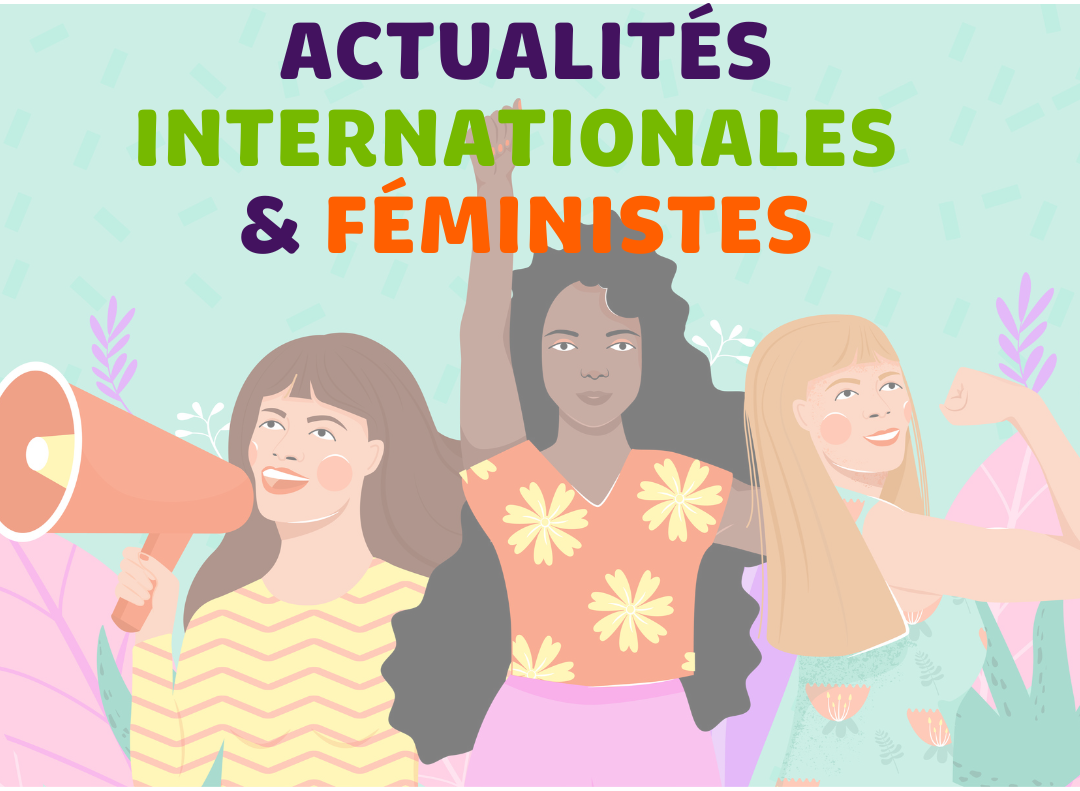
Revue de presse féministe & internationale du 07 au 11 juillet 2025
11 juillet, 2025Revue de presse féministe & internationale du 30 juin au 4 juillet
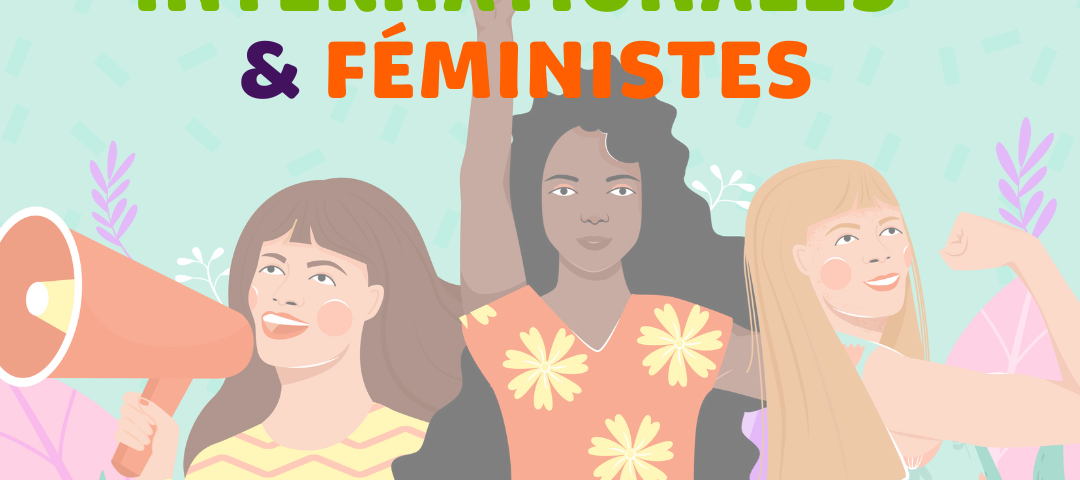
ÉTATS-UNIS
La Cour suprême autorise la Caroline du Sud à supprimer le financement de Planned Parenthood (le Planning familial)
Le jeudi 26 juin, la Cour suprême américaine, dominée par une majorité conservatrice, a rendu une décision favorable à la Caroline du Sud, qui souhaite retirer le financement de Planned Parenthood, l’équivalent américain du planning familial à but non lucratif. Cette mesure pourrait encourager d’autres États opposés au droit à l’avortement à adopter des mesures similaires.
Depuis 1976, la loi fédérale américaine interdit que les fonds Medicaid servent à financer des avortements, sauf dans certains cas exceptionnels (viol, inceste, complications potentiellement mortelles). Medicaid, un programme public de santé financé par le gouvernement fédéral et les États, offre une couverture médicale aux personnes à faibles revenus. Bien que Medicaid rembourse tous les prestataires médicaux qualifiés pour les soins non liés à l’avortement, la Caroline du Sud, qui manque de médecins de soins primaires, voit Planned Parenthood South Atlantic jouer un rôle clé en fournissant des soins de santé essentiels, notamment des examens et dépistages du cancer.
Tout commence en 2018, lorsque le gouverneur républicain Henry McMaster décide d’exclure Planned Parenthood du programme Medicaid, en invoquant sa participation à la réalisation d’avortements.
«Les contribuables ne devraient pas être contraints de subventionner des fournisseurs de services d’avortement qui vont à l’encontre de leurs convictions.»
Par la suite, Planned Parenthood et une femme atteinte de diabète avaient intenté une action en justice contre la décision du gouverneur Henry McMaster. Le tribunal leur avait donné raison, estimant que la mesure violait une loi fédérale qui garantit à chaque patient·e la liberté de consulter le prestataire de soins qualifié de son choix.
Cependant, ce jeudi 26 juin, la Cour suprême a statué en faveur de l’État par six voix contre trois, conformément aux affiliations idéologiques de ses membres, estimant que la loi fédérale ne donnait pas explicitement le droit aux patient·es de contester en justice le refus de leur prestataire de soins.
Bien que cette décision ne remette pas directement en cause le droit à l’avortement, elle vise l’organisation qui le défend : Planned Parenthood, désormais privée de financements publics en Caroline du Sud. Or, réduire ces financements ne limite pas seulement l’accès à l’avortement, mais compromet aussi l’accès à d’autres soins essentiels proposés par les cliniques, tels que le dépistage des IST et du cancer ou encore de maladies chroniques comme le diabète, la contraception, les vaccinations et le soutien en santé mentale.
Avec cette décision, la Caroline du Sud ne restera sûrement pas le seul État touché. Cela pourrait désormais permettre aux autres États conservateurs de suivre le mouvement, ce qui risque d’avoir un énorme impact sur la santé de milliers d’américain·es. Et cela pourrait même avoir des répercussions dans les États où l’avortement est légal. Cette décision judiciaire, bien que ciblant un État, ouvre une brèche juridique à l’échelle nationale.
Comme le rapporte HuffPost, la sénatrice démocrate Patty Murray s’inquiète des « conséquences catastrophiques pour les femmes à travers le pays, qui comptent sur les centres de Planned Parenthood pour recevoir des soins essentiels ». Selon elle, « cette offensive contre Planned Parenthood est motivée uniquement par la volonté des extrémistes républicains opposés à l’avortement de restreindre au maximum son accès, peu importe les répercussions ».
Près de la moitié des patient·es de Planned Parenthood sont assuré·es par Medicaid, selon l’organisation elle-même. L’exclusion de ce réseau de soins reviendrait, de fait, à un désengagement financier majeur, une volonté de longue date des conservateurs, formulée ouvertement dans le projet politique Project 2025, publié pendant la dernière campagne de Donald Trump.
Medina v. Planned Parenthood South Atlantic (06/26/2025)
HONGRIE
Une Pride historique malgré l’interdit de Viktor Orbán
La Marche des fiertés de Budapest, qui s’est tenue samedi 28 juin, restera dans les mémoires comme un tournant majeur pour la communauté LGBT+ hongroise et un puissant acte de défiance contre le gouvernement de Viktor Orbán. Malgré l’adoption en mars d’une loi visant à interdire l’événement, près de 200 000 personnes ont défilé dans la capitale hongroise, une participation inédite qui a transformé cette 30e édition de la Pride en manifestation géante contre les dérives autoritaires du Premier ministre.
Le contexte était explosif : le 6 juin, le gouvernement hongrois a publié un décret interdisant l’affichage de symboles LGBT+ sur les bâtiments publics, confirmant sa volonté de « lutter contre la propagande LGBT+ destinée aux enfants ». La mairie de Budapest, dirigée par l’élu écologiste Gergely Karácsony, a bravé cette interdiction en arborant le drapeau arc-en-ciel sur son fronton. Dans un climat de forte incertitude juridique, la police nationale menaçait les participant.es d’amendes allant jusqu’à 500 euros, voire de peines de prison, tandis que des caméras de surveillance dotées de reconnaissance faciale avaient été déployées le long du parcours.
Malgré ces intimidations, la mobilisation a dépassé toutes les attentes. De nombreux.ses Hongrois·e·s, parfois venu·e·s pour la première fois, ont rejoint le cortège, accompagné·e·s par une soixantaine d’eurodéputé·e·s, l’ambassadeur français pour le droit des personnes LGBT+ Jean-Marc Berthon, ainsi que la commissaire européenne à l’égalité, Hadja Lahbib. Le maire de Budapest a pu maintenir la marche en la rebaptisant « festival municipal », échappant ainsi à l’interdiction policière.
L’affluence record a fait de cette Pride la plus grande jamais organisée en Hongrie et la plus importante manifestation contre Viktor Orbán depuis son retour au pouvoir en 2010. « Ce n’est plus seulement une Pride, c’est une manifestation anti-Orbán », témoignait un participant. En face, de petits groupes d’extrémistes ont tenté de bloquer le cortège, sans succès.
Cette démonstration de force intervient alors que le Fidesz, le parti de Viktor Orbán, est donné derrière son nouveau rival conservateur Péter Magyar dans les sondages pour les législatives de 2026. Ce dernier, qui a quitté le camp Orbán début 2024, a refusé de soutenir ouvertement la Pride, de peur d’aliéner un électorat de droite peu favorable aux droits LGBT+. « La Pride est très impopulaire dans l’électorat de droite hongrois et un message de soutien serait contre productif », selon le politologue Robert Laszlo, du think tank Political Capital.
Pour beaucoup, cette Pride a également révélé l’inaction de la Commission européenne face aux attaques répétées du gouvernement hongrois contre les droits LGBT+ et l’État de droit. « Viktor Orbán n’a rien inventé : il suit le chemin tracé par la Russie, le Bélarus, la Serbie », alerte Akos Hadhazy, député d’opposition, qui craint que la loi interdisant la Pride ne serve surtout à tester des technologies de surveillance en vue des prochaines élections.
Au-delà des menaces et des tentatives d’intimidation, la marche de Budapest a montré la résilience et la détermination d’une société civile hongroise décidée à défendre ses libertés face aux dérives autoritaires. Comme le clamait une participante, sourire aux lèvres : « Vous sentez cet air, qu’on respire à Budapest ? C’est la liberté. »
KENYA
La jeunesse en première ligne face à la répression, entre rue et réseaux sociaux
Au Kenya, la jeunesse ne désarme pas. Un an après les manifestations massives de juin 2024, qui avaient fait au moins 60 mort.es et vu le Parlement brièvement pris d’assaut, la « génération Z » continue de contester la politique du président William Ruto, élu en 2022 sur des promesses de justice sociale mais accusé depuis de dérive autoritaire, de corruption et de violences policières.
Ce dernier mois, la colère s’est ravivée avec la mort suspecte d’Albert Ojwang, enseignant et blogueur de 31 ans, retrouvé dans un commissariat avec des blessures laissant penser à un homicide. Des milliers de jeunes ont de nouveau manifesté, bravant une répression brutale : le 25 juin, 16 personnes ont été tuées et 400 blessées, selon les ONG, et des cas de viols organisés pour terroriser les manifestantes ont été documentés pour la première fois par l’association kenyane de lutte contre les violences sexistes Usikimye. Selon Njeri Migwi, cofondatrice et directrice générale d’Usikimye : « Ces agressions étaient de la violence organisée. L’objectif était clairement de dissuader les femmes de manifester – et une manifestation sans femmes n’est pas une véritable manifestation. ».
Née avec les réseaux sociaux, la « Gen Z » kényane articule lutte de rue et contestation numérique, défiant la censure que le gouvernement tente d’imposer en coupant les signaux des télévisions refusant de se plier à ses ordres. L’autorité de la communication a même tenté d’interdire la diffusion en direct des manifestations, provoquant un tollé et des accusations de dérive autoritaire.
Derrière la protestation initiale contre des hausses d’impôts jugées injustes, les revendications se sont élargies : dénonciation de l’impunité policière, des disparitions d’opposant·es, de la corruption, mais aussi de l’ordre politique fondé sur le clientélisme ethnique (système où des avantages sont accordés selon des critères ethniques en échange de soutien politique, détournant les ressources publiques au détriment de l’intérêt général). « Rien n’effraie plus les politiques que le déclin de la mobilisation tribale dans la révolution actuelle. Ils se nourrissent de la colère ethnique, car ils ont rarement des solutions aux problèmes et aux défis auxquels sont confrontés les Kényans », analyse le journaliste Darius Okolla, qui souligne que ces jeunes urbain.es revendiquent un engagement au-delà des appartenances communautaires.
Cette génération remet également en question le rôle des institutions religieuses, autre pilier historique de la vie publique au Kenya. Jadis fers de lance de l’opposition sous la dictature de Daniel arap Moi, les églises sont aujourd’hui perçues comme trop proches du pouvoir. « Nous questionnons tout, y compris nos leaders religieux désormais, car l’Eglise est le miroir de la société », affirme Linet Nyambura, 26 ans, manifestante. En mars dernier, un don public de 20 millions de shillings kényans offert par William Ruto à une église a suscité une polémique et illustré la défiance grandissante envers le mélange de religion et de politique.
Dans ce contexte, une figure inattendue a émergé comme symbole d’intégrité pour la jeunesse : l’ancien juge David Maraga, 74 ans. Connu pour avoir annulé l’élection présidentielle de 2017 pour cause d’irrégularités, Maraga a acquis une aura de probité inébranlable. Défilant aux côtés des manifestant.es le 25 juin, il a dénoncé sans détour les violences des forces de l’ordre : « Ils pensent pouvoir faire ce qu’ils veulent, y compris tuer les enfants comme des rats », a-t-il fustigé. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027, suscitant l’espoir d’un renouveau politique hors des logiques clientélistes.
Alors que la prochaine élection présidentielle est prévue pour 2027, beaucoup de jeunes s’organisent. Nombre d’entre elleux rejoignent des petits partis politiques et appellent à s’inscrire massivement sur les listes électorales, même si le gouvernement semble ralentir cet enregistrement. « La crise actuelle exige une solution politique, et non policière », martèle Irũngũ Houghton, directeur exécutif d’Amnesty International Kenya, qui pointe la nécessité urgente de s’attaquer aux racines de la crise : chômage massif, dégradation des services publics et corruption.
Mais, pour l’instant, le président Ruto semble avoir opté pour la fuite en avant autoritaire, profitant du silence des partenaires occidentaux. La jeunesse, elle, entend maintenir la pression, convaincue que le 25 juin 2024 a marqué “ le début de quelque chose ” et qu’elle peut, en 2027, faire basculer l’histoire politique du Kenya.
INTERNATIONAL
Les femmes sont plus exposées aux effets des vagues de chaleur
En 2023, Le Monde rapportait que les décès lors des épisodes de chaleur extrême étaient plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, notamment en Europe.
Une étude publiée en 2021 par l’Université libre d’Amsterdam identifie plusieurs facteurs. Les femmes transpirent moins que les hommes, ce qui fait que leur corps surchauffe plus vite, et leur tension cardiovasculaire est plus fragile. À cela s’ajoutent des réalités sociales, comme le fait qu’elles sont plus souvent seules chez elles ou actives dans le foyer, donc plus exposées aux températures élevées.
Le changement climatique ne se contente pas d’augmenter les températures : il agit comme un amplificateur de tensions déjà existantes dans nos sociétés. L’une des manifestations les plus alarmantes de ce phénomène est la hausse des violences faites aux femmes durant les épisodes de chaleur extrême.
En effet, d’après un rapport publié en avril 2025 par l’Initiative Spotlight des Nations Unies, les féminicides augmenteraient de 28 % durant les épisodes de fortes chaleurs.
L’étude révèle un lien direct entre la hausse des températures et les violences conjugales : chaque augmentation d’un degré de la température mondiale serait associée à une hausse de 4,7 % de ces violences. À ce rythme, les projections sont alarmantes : d’ici la fin du siècle, un cas de violences conjugales sur dix serait lié au changement climatique.
Plusieurs facteurs physiologiques et sociaux permettent d’expliquer cette corrélation : la chaleur extrême intensifie l’irritabilité, perturbe le sommeil, réduit le contrôle de soi, et accroît la consommation d’alcool. Par ailleurs, en période de canicule, les personnes sortent moins, voient moins leurs proches, ce qui accentue l’isolement des femmes victimes, enfermées avec un conjoint violent.
Face à cette montée des violences, certains gouvernements commencent à réagir. Le journal Sud Ouest rapporte que l’Espagne a décidé de renforcer son système de protection durant l’été. Le dispositif VioGén 2, basé sur des algorithmes, permet d’évaluer le niveau de risque auquel les femmes sont exposées et de cibler les interventions. Selon le ministère espagnol de l’Égalité, plus de 40 % des féminicides en 2023 et 2024 ont eu lieu pendant l’été.
Au-delà des violences directes, le rapport de l’Initiative Spotlight met en lumière un phénomène plus large : le changement climatique exacerbe les tensions économiques et sociales qui pèsent déjà sur les femmes et les filles. Les plus touchées sont celles qui vivent dans la pauvreté : petites agricultrices, habitantes de quartiers urbains précaires, femmes autochtones, personnes en situation de handicap, seniors ou issues de la communauté LGBTQ+. Toutes cumulent les vulnérabilités, avec un accès limité aux soins, aux refuges et aux dispositifs de protection.
C’est pourquoi l’Initiative Spotlight appelle à intégrer la prévention des violences sexistes dans toutes les politiques climatiques, du niveau local aux mécanismes de financement internationaux. Des pays comme Haïti, le Libéria, le Vanuatu ou le Mozambique ont déjà développé des programmes qui allient lutte contre la violence et résilience climatique.