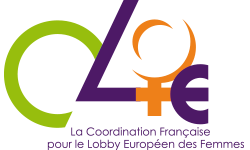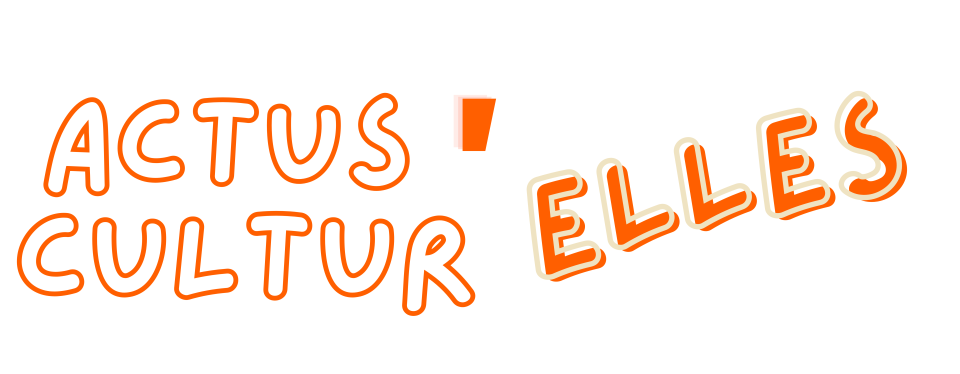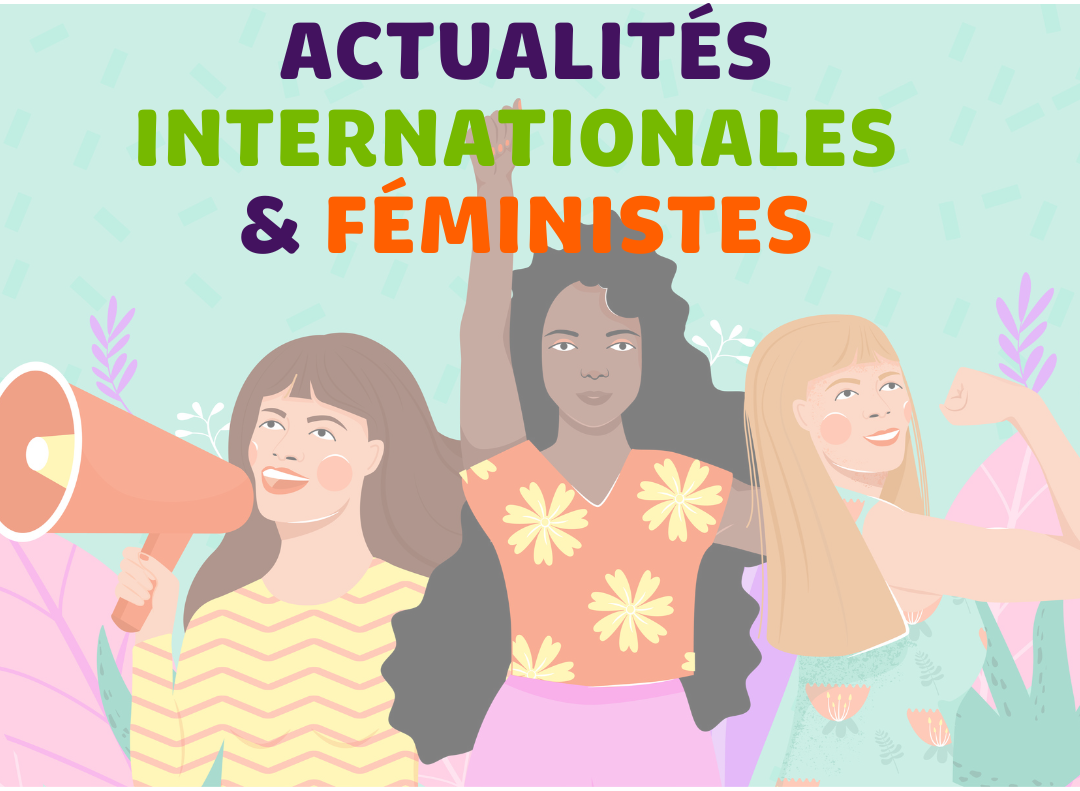
Revue de presse féministe & internationale du 25 août au 1er septembre
1 septembre, 2023
COMMUNIQUE DE PRESSE – Le Parlement européen reconnaît la prostitution comme une violence contre les femmes
14 septembre, 2023Revue de presse féministe & internationale du 1er au 8 septembre

MEXIQUE
La Cour Suprême dépénalise l’avortement dans tout le pays.
Ce mercredi 6 septembre, la plus haute juridiction du pays a déclaré inconstitutionnelle la pénalisation de l’avortement dans une décision historique célébrée par le mouvement féministe.
Dans une décision unanime, la Cour Suprême a déclaré l’inconstitutionnalité du « délit d’avortement » dans le Code pénal fédéral, qui était défini à l’article 329 comme « la mort du produit de la conception à tout moment de la grossesse ». Les juges ont estimé que la criminalisation de l’IVG « viol(ait) les droits humains des femmes », et notamment leur droit à décider. Le communiqué a également ajouté que la pénalisation de l’avortement « constitue un acte de violence et de discrimination pour raison de genre ». Concrètement, cette décision oblige les institutions fédérales de santé publique, telles que l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), l’Institut de sécurité et de services sociaux pour les travailleurs de l’État (ISSSTE) ou Pemex, de proposer ce service gratuitement. Elle interdit également de sanctionner le personnel médical qui pratiquerait une interruption de grossesse, alors que le Code pénal fédéral prévoyait jusque là une peine de un à trois ans pour toute personne pratiquant un avortement, et une suspension de deux à cinq ans pour les médecins qui en feraient de même.
Cette décision historique est une véritable victoire pour le mouvement féministe surnommé la Marea Verde (« la vague verte »), en raison de sa couleur représentative, qui se bat à l’échelle nationale et latino-américaine pour la légalisation du droit à l’avortement à travers le continent. C’est d’ailleurs une organisation féministe, Gire, qui lutte pour la défense des droits reproductifs des femmes, qui a saisi la Cour suprême l’année dernière afin qu’elle statue sur la loi désuette, qui datait de 1931. Gire a par ailleurs déposé une vingtaine de recours devant les tribunaux régionaux, afin qu’ils modifient également leur Code pénal. En effet, la lutte pour l’accès à l’IVG pour toutes est loin d’être finie. La décision de mercredi interdit désormais le délit d’avortement, mais de nombreux états fédérés n’ont pas de loi sur l’IVG. Quant aux provinces qui avaient déjà dépénalisé l’avortement, l’accès à ce service reste partiel, le délai maximum étant en général de 12 semaines.
La dépénalisation de l’avortement au Mexique est en effet un long processus, qui a commencé en 2007, lorsque Mexico City a autorisé l’IVG, devenant la juridiction précurseure dans le pays et toute l’Amérique latine. Depuis, onze états ont suivi les pas de la capitale et ont décriminalisé à leur tour l’avortement. Il y deux ans, en septembre 2021, la Cour suprême a jugé inconstitutionnel un article du Code pénal de l’État du Coahuila qui prévoyait une peine de prison pour les femmes qui avortaient. Néanmoins, la décision, prise au niveau fédéral, a été respectée de manière très inégale par les différentes juridictions fédérées. Enfin, en juin 2023, la Cour suprême a autorisé toutes les femmes, enceintes ou pas, à contester devant les tribunaux les lois pénalisant l’IVG dans les états fédérés qui n’avaient pas encore dépénalisé l’avortement, ouvrant ainsi la porte à la décision de mercredi. La décision unanime de la Cour reflète les grands changements en cours dans la société mexicaine, marquée par l’action des nombreuses organisations féministes depuis plusieurs décennies. Quelques heures avant le jugement de la Cour suprême, il a d’ailleurs été annoncé que les deux candidats à l’élection présidentielle de 2024 seraient deux candidates : Claudia Sheinbaum et Xóchitl Gálvez, toutes deux en faveur de la dépénalisation de l’IVG.
Le quotidien New York Times a écrit que cette décision historique au Mexique mettait en évidence le « leadership » des pays latino-américains dans la lutte pour l’élargissements des droits reproductifs des femmes. En Colombie, le mouvement féministe a réussi à dépénaliser l’IVG dans le pays jusqu’à 24 semaines. L’accès à l’avortement, partiel ou total, est désormais autorisé dans de nombreux Etats, à l’instar de l’Uruguay et de l’Argentine. Il reste cependant interdit dans plusieurs pays d’Amérique centrale, tels que le Salvador, le Honduras, la République dominicaine ou encore le Nicaragua. La décision de la Cour Suprême mexicaine apparaît également en contre-sens de l’arrêt de la Cour Suprême américaine, qui, en 2022, a annulé la décision Roe v. Wade qui garantissait le droit à l’avortement dans tout le pays.
EL PAÍS, « La Suprema Corte despenaliza el aborto en México a nivel federal », 6 septembre 2023.
Le Monde, « Mexique : la Cour suprême dépénalise l’avortement », 7 septembre 2023.
New York Times, « La Suprema Corte de México despenaliza el aborto en todo el país », 6 septembre 2023.
FRANCE/AFGHANISTAN
La France accueille des réfugiées afghanes alors que l’apartheid des sexes s’intensifie en Afghanistan.
Lundi 4 septembre, la France a accueilli cinq femmes afghanes qui avaient fui le régime taliban. Dans le pays le plus répressif au monde envers les femmes et les filles, les restrictions de plus en plus dures nourrissent le désespoir des Afghanes.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a annoncé ce lundi, l’arrivée de cinq femmes et trois enfants afghans à Paris, après leur évacuation du Pakistan où elles avaient trouvé refuge après avoir fui l’Afghanistan. Elles ont été choisies pour leur position importante, qui en faisaient des cibles pour le régime taliban, qui interdit aujourd’hui l’accès des femmes à la plupart des métiers. Ainsi, parmi les cinq réfugiées, on compte une directrice d’université, une consultante en organisation non-gouvernementale (ONG), une enseignante, une présentatrice de télévision et enfin Naveen Hashim, une militante pour les droits des femmes en Afghanistan. Les associations françaises, notamment France terre d’asile, ont néanmoins expliqué que cette opération ne venait pas d’une volonté politique forte mais plutôt d’une grande mobilisation d’associations de terrain, qui revendiquent par ailleurs que ces missions d’exfiltration ponctuelles deviennent un « programme d’accueil ad hoc plus large » qui pourraient inclure toutes les femmes afghanes actuellement exilées au Pakistan.
Depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, près de 16 000 personnes ont été évacuées vers la France, notamment à l’aide du dispositif Apagan, qui a rapatrié les ressortissants français en 2021. Mais les demandes d’asile ne diminuent pas : depuis le début de l’année, 12 000 demandes ont été déposées en France. La majorité des demandes d’asile sont cependant déposées par des hommes, qui peuvent encore circuler librement dans le pays. La situation est plus difficile pour les femmes, qui n’ont plus le droit de circuler à plus de 72 kilomètres de leur domicile sans être accompagnées par un mari, un père ou un frère. La libre circulation est loin d’être le seul droit fondamental dont les talibans ont privé la moitié de la population. Interdiction d’aller à l’école après le primaire, de travailler dans une ONG ou un salon de beauté, de sortir sans burqa, ou encore de simplement se promener aux lacs de Bamyan depuis le 28 août, l’Afghanistan est aujourd’hui le pays le plus répressif en matière de droits des femmes au monde. L’ONU, à travers la cheffe d’ONU Femmes, Sima Bahous, a qualifié ce système d’ « apartheid de genre ». Un terme également revendiqué par l’ancienne Rapporteure spéciale de l’ONU et chercheuse algérienne Karima Bennoune, qui dénonce un système de discrimination institutionnalisé, fondé sur l’oppression et la subordination des femmes et des filles.
Privées de tout, laissées sans droits, les Afghanes sombrent dans le désespoir : en plus d’être le pays le plus discriminatoire du monde, l’Afghanistan est désormais un des rares États où le taux de suicide est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. En effet, alors que deux fois plus d’hommes se suicident dans le monde selon l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), cette tendance s’est vue inversée dans le pays depuis 2021. Les autorités afghanes interdisent le partage de ces données, mais des médecins ont pu partager des chiffres au journal The Guardian. Les données recueillies témoignent d’une réelle augmentation de suicides chez les femmes, qui représentent plus de trois quarts des suicides et tentatives de suicides enregistrés dans la majorité des provinces.
Le seul espoir des Afghanes reste donc la fuite, par leurs propres moyens, vers les pays limitrophes, à l’instar du Pakistan, pour ensuite tenter d’obtenir l’asile en Europe. La France, qui a accueilli cinq d’entre elles cette semaine, reste cependant loin derrière l’Allemagne. Le pays a en effet déjà accueilli 30 300 Afghans depuis l’arrivée au pouvoir des talibans. Environ 2885 femmes ont obtenu le statut de réfugiées en Allemagne entre janvier et mai 2023, ce qui représente la moitié des demandes dans le monde. Le Danemark, depuis le début de l’année, accorde systématiquement l’asile aux femmes et aux filles d’Afghanistan sur la seule base de leur genre, comme c’est le cas en Suède.
Le Monde, « La France accueille cinq Afghanes « menacées par les talibans » », 4 septembre 2023.
France Info, « Afghanistan : « On espère qu’il y aura plus de femmes à l’avenir » lors des opérations d’évacuation vers la France, indique l’Ofii », 4 septembre 2023.
Info Migrants, « Running from the Taliban: More Afghan women granted refugee status in Germany », 13 juillet 2023.
ETHIOPIE
Les violences sexuelles comme arme de guerre, même en temps de paix.
Une nouvelle enquête d’Amnesty International, publiée le 5 septembre, révèle le caractère systémique des violences sexuelles qu’ont continué à faire subir les forces de défense érythréennes (FDE) aux femmes tigréennes, alors qu’un accord de paix a mis un terme au conflit en novembre 2022.
Le rapport, intitulé « Tôt ou tard, ils devront être traduits en justice », démontre que les atrocités commises contre la population civile au Tigré, qui pourraient s’apparenter à des crimes de guerre, ont continué pendant plusieurs mois après la fin du conflit. Le 3 novembre 2022, un accord de paix avait mis un terme à la guerre civile qui opposait le gouvernement éthiopien, allié à l’Érythrée, et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), après deux années de conflit. Malgré ce traité de paix, qui ordonne la cessation de toute forme d’hostilité, les soldats érythréens, qui reste aujourd’hui une force d’occupation dans la région du Tigré, ont poursuivi leurs attaques contre les Tigréens, notamment les femmes.
L’enquête d’Amnesty, publiée ce mardi, a été menée de la fin du conflit, en novembre 2022, à janvier 2023. Elle est basée sur de nombreux témoignages de civil·es de la région, notamment dans le sous-district de Kokob Tsibah. Malgré la difficulté des conditions d’enquête (les organisations de défense des droits de l’Homme sont interdites d’entrée dans le pays), l’organisation non gouvernementale (ONG) a pu s’entretenir avec une cinquantaine de témoins et victimes. L’enquête a révélé la continuation des atrocités commises contre les Tigréens pendant les trois mois suivants la cessation des combats, et de manière genrée : selon Tigere Chagutah, directeur de cette région à Amnesty, les femmes ont été soumises à des terribles violences à caractère sexuel (viols, esclavage sexuel…), tandis que les hommes étaient visés par des exécutions extrajudiciaires. Les témoignages des victimes ont indiqué que les soldats des forces de défenses érythréennes (FDE), alliées au gouvernement éthiopien, ont détenu des femmes dans un camp militaire de Kokob Tsibah pendant trois mois. Les quinze femmes, réduites en esclaves sexuelles, ont été victimes de viols et de viols en réunion pendant cette longue période, simplement à cause du fait que les soldats soupçonnaient leurs maris et fils de faire partie des forces tigréennes.
Selon Amnesty, ces cas de viols et d’esclavage sexuel peuvent être considérés comme une attaque généralisée contre la population civile et illustrent à ce titre l’usage systématique du viol comme arme de guerre au Tigré, pendant et après le conflit. En effet, entre 2020 et 2022, les autorités sanitaires éthiopiennes estiment qu’au moins 120 000 femmes ont été violées au Tigré. Les violences sexuelles ont été utilisées comme arme stratégique sous toutes leurs formes : les populations civiles ont subi des viols, mutilations sexuelles, grossesses forcées, esclavage sexuel… commis par les forces occupantes dans le seul but de détruire les communautés et affaiblir les individus. Le Conseil de sécurité de l’ONU, dans sa Résolution 2467 de 2019, a établit l’utilisation de la violence sexuelle comme un « objectif stratégique » en temps de guerre. D’un point de vue plus juridique, les violences sexuelles utilisées comme tactique de guerre peuvent être qualifiées de crime de guerre ou de crime contre l’humanité.
Les crimes commis contre les femmes tigréennes pourraient donc être jugés comme crimes de guerre dans le futur. Cependant, il faudra sûrement attendre longtemps avant de voir une quelconque justice être rendue. Si le gouvernement éthiopien a fait un pas important en janvier, en publiant un document sur une potentielle justice transitionnelle, condition phare de l’accord de paix de 2022, la tâche sera difficile, au vu du nombre de victimes d’un des conflits les plus meurtriers au monde. De plus, le document lui-même reconnaît que les initiatives précédentes de justice transitionnelle ont toutes échouées dans le pays. La Commission de réconciliation, dont le mandat a expiré en 2022, n’a de son côté produit aucun résultat notoire. Le gouvernement a également d’autres priorités, notamment dans la région d’Amhara, où des combats ont éclaté en août, et où un état d’urgence a été déclaré. Dernier obstacle à une potentielle traduction des responsables devant le justice : l’Erythrée, dont les troupes ont commis des crimes sexuels au Tigré, n’a pas signé l’accord de paix et refuse de reconnaître les atrocités dont sont accusées ses soldats.
Le Monde, « « Ça ne sert à rien de crier, personne ne viendra te sauver » : en Ethiopie, le calvaire des Tigréennes », 5 septembre 2023.
Amnesty International, « Malgré l’accord de paix, les crimes de guerre ont continué en Ethiopie », 5 septembre 2023.
Justice Info, « L’Ethiopie promet une nouvelle fois la justice transitionnelle« , 2 mars 2023.
ETATS-UNIS
Au Texas, la législation anti-avortement se renforce.
Dans cet État conservateur, qui possède déjà une des législations les plus restrictives du pays sur l’avortement, de nouveaux projets de loi anti-IVG proposent d’interdire l’accès aux routes texanes aux femmes voulant aller avorter dans d’autres Etats.
Depuis l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade en juin 2022, qui protégait le droit à l’IVG au niveau fédéral, de nombreux États conservateurs ont légiféré pour tenter de restreindre, voire interdire, l’accès à l’avortement à l’intérieur de leurs frontières. C’est le cas du Texas, dont les deux chambres du Parlement sont sous contrôle républicain, et dont le programme de droite radicale est largement soutenu par la population. Le droit à l’IVG est actuellement régi par la Texas Heartbeat Bill (« loi sur le battement de coeur ») de 2021, qui interdit tout avortement dès qu’une activité cardiaque peut être détectée, ce qui correspond approximativement à la sixième semaine de grossesse, date à laquelle la plupart des femmes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes. L’État est même allé ressusciter une loi de 1925 qui expose tout individu pratiquant un avortement à des poursuites judiciaires et des sanctions. Ces lois continuent cependant d’être contestées régulièrement par une minorité. Ainsi, le 4 août 2023, suite à une action en justice intentée par des femmes qui s’étaient vu refuser des avortements en dépit d’urgences médicales, une juge texane a accordé une dérogation temporaire, en clarifiant que les avortements dus à des problèmes médicaux, comme des grossesses dangereuses, étaient autorisés. Mais quelques heures plus tard, le bureau du procureur général a fait appel pour bloquer l’ordonnance. Finalement, le 25 août, le Parlement a modifié sa légisaltion, interdisant de fait tous les avortements dans l’État.
Malgré ce carcan législatif, certains défenseurs anti-avortement ne le juge pas satisfaisant, et innovent avec de nouvelles stratégies. La dernière en date : une nouvelle ordonnance proposée par des militants anti-IVG visant à interdire ce qu’ils ont surnommé le « trafic d’avortements », c’est à dire le fait de transporter une femme enceinte pour qu’elle puisse aller avorter légalement dans un autre État. En effet, les femmes qui le peuvent se rendent désormais dans des cliniques d’avortement dans d’autres États limitrophes, notamment au Nouveau-Mexique. Concrètement, le texte prévoit que tout citoyen peut poursuivre un individu ou une organisation qu’il soupçonne d’avoir utilisé les routes de la ville pour aider une femme à avorter dans un autre État. Si cette nouvelle loi paraît démesurée, elle a pourtant déjà été adoptée dans plusieurs villes et comtés texans à la rentrée, selon le quotidien Washington Post. Mark Lee Dickson et Jonathan Mitchell, les hommes à l’origine de cette ordonnance, expliquent que l’expression « trafic d’avortements » se définit par « le fait d’aider une femme enceinte à franchir les frontières d’un État pour mettre fin à sa grossesse, en la transportant, en la finançant ou en lui apportant toute autre forme de soutien ». Selon eux, l’utilisation du terme « trafic » est légitime, étant donné que « l’enfant à naître est toujours pris contre sa volonté ». Leur objectif est désormais de faire adopter la loi à un maximum de juridictions locales.
Quant à la constitutionnalité de la loi, qui semble à premier abord violer le droit constitutionnel des personnes à voyager, protégé aux États-Unis, elle est difficile à contester. En effet, le texte peut être appliqué par n’importe quel citoyen, ce qui rend compliqué la poursuite d’un·e représentant·e du gouvernement afin d’annuler la loi. De la même manière, cela rend également l’ordonnance difficile à appliquer en pratique. Néanmoins, l’objectif des législateurs semble être plutôt d’instaurer un climat de peur, afin de décourager les femmes qui voudraient avorter. Il est important de noter que dans ces conditions, de nombreuses femmes ont en réalité recours à l’envoi de pilules abortives, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi.
Retrouvez une carte interactive de l’interdiction de l’IVG aux Etats-Unis : cliquez ici.
The Washington Post, « Highways are the next antiabortion target. One Texas town is resisting. », 1 septembre 2023.
Varghese Summersett, « What Is The Texas Abortion Law? (2023) », septembre 2023.
Slate, « The Texas Bans on Abortion “Trafficking” Are Even Scarier Than They Sound », 6 septembre 2023.
Le groupe de femmes motardes indigènes roule à travers les Etats-Unis pour sensibiliser l’opinion publique à la cause des femmes autochtones disparues.
Les membres de Medicine Wheel Ride, montées sur leurs Harley-Davidson, ont un objectif commun, celui de dénoncer les disparitions et féminicides des femmes indigènes et de lutter contre l’invisibilisation du problème dans les tribus. Leur méthode de travail est assez originale : les motardes sillonnent les routes et organisent des rallyes afin de lever des fonds pour venir en aide aux familles des disparues.
Les victimes, connues aux Etats-Unis sous l’acronyme MMIW (Missing and Murdered Indigenous Women), les femmes indigènes disparues et tuées, sont en effet souvent oubliées, par leurs propres tribus, et effacées, par les médias. Le collectif se bat pour sensibiliser l’opinion publique aux violences faites aux femmes autochtones, un problème réellement endémique. En effet, bien que les statistiques soient souvent incomplètes, le National Crime Information Center a décompté 5 712 signalements de disparitions de femmes indigènes en 2016. Les féminicides représentent la troisième cause de décès chez les femmes natives.
Face à l’invisibilisation des victimes et de leurs familles, le rôle de Medicine Wheel Ride est d’accompagner les proches dans leurs procédures juridiques, en réclamant des enquêtes, ou en demandant la réouverture des dossiers, qui sont généralement classés sans suite.
Les réalisatrices Prairie Rose Seminole et Katrina Lillian Sorrentino ont récemment tourné un film, intitulé We Ride For Her (« On roule pour elle »), sur le groupe des motardes. Le film, qui devrait sortir cette année, souhaite donner une plateforme aux victimes et à leurs familles, afin qu’elles puissent partager leurs histoires et sensibiliser l’opinion publique et les politiques à leur cause.
Retrouvez le site des Medicine Wheel Ride : cliquez ici.
Le Monde, « Dans l’Ouest américain, des motardes contre les violences faites aux femmes indigènes », 29 août 2023.
Exposition – JO 1922
Organisée par la mairie du 11ème arrondissement de Paris, l’exposition JO 1922 revient sur les « premiers jeux olympiques féminins » qui ont eu lieu à Paris il y a un siècle. A travers le parc Majorelle, le public peut découvrir de nombreux panneaux retraçant cet événement historique et pourtant encore méconnu.
L’exposition, qui est en place jusqu’aux JO 2024, rend également hommage à Alice Milliat, la fondatrice de ces jeux féminins. En 1922, face au refus de Pierre de Coubertin d’accepter la participation d’athlètes féminines aux JO officiels, elle décide d’organiser une compétition réservée aux femmes. Les jeux olympiques féminins, pour leur première édition, rassemble 77 athlètes de 5 pays, et recueille l’attention des médias et des curieux·ses. Forts de ce succès, l’événement sportif sera réorganisé lors de trois éditions en 1926, 1930 et 1934.
Un rappel historique particulièrement important à quelques mois des JO 2024 de Paris, qui marqueront eux aussi l’histoire de la compétition en étant les premiers jeux à atteindre une parité totale : autant d’athlètes masculins que féminins y participeront !
L’exposition se déroule au parc Louis Majorelle, 30 rue de la Forge Royale, 75011 Paris. Les panneaux sont également accessibles en ligne : cliquez ici.